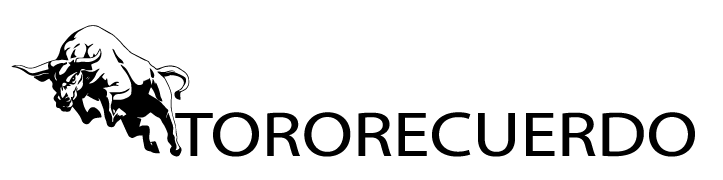Arles, samedi 26 mars 2016- Castella, Manzanares, Lopez Simon/ Garcigrande
Jolie corrida entretenida. Mais entretenida par notre aficion impatiente, le désir d’en finir avec un hiver sans toro et l’attente exaspérée de quelques frissons d’arène. Alors tout vaut mieux que rien et on se réchauffe au pas grand-chose.
Juan-Bautista dont c’est la première saison en tant qu’impresa n’a pas mégoté sur sa corrida d’ouverture : neuf toros sont sortis en piste pour six combats, dont deux faibles, très faibles (le 1 et le 2, celui-ci quasi-invalide). La plupart anovillados, de 510 à 535 kgs, sans trapio, sans grande présence, sans beaucoup de cornes (celles du cinquième bis, échu à Manzanares sont honteuses en dépit de la joliesse de ce novillo au port altier). Seul le sixième ressemblait à un toro ; hélas un incident à la patte durant le tercio de banderilles contraindra au changement. Le 3 avait un brin de jeu et le 4, très noble, du gaz.
L’arène, d’abord éclaboussée de soleil, sera bienveillante, affectueuse et patiente : la corrida a duré 3 heures et nous avons fini transis au son de l’angélus, dans un crépuscule glacial.
Sébastien Castella a été, et de très loin, le torero du jour. Un torero dans sa maturité, au geste sûr et plein d’aisance, que l’on se régale de regarder, épaté par l’évidence de tout ce qu’il entreprend, son intelligence et sa sérénité. Et avec un changement majeur depuis deux ans : il habite désormais le milieu de sa faena qui a longtemps été, entre entame saisissante et final dans les cornes, son point faible. Ce tunnel, cette dépression en cours de faena, gestes mécaniques et séries répétitives, ont disparu.
Nous avons vu deux faenas, complètes, construites, liées, pleines d’agrément et même de fantaisies talavantesques insoupçonnées. La première, adaptée et agréable jusqu’au miracle compte tenu de la faiblesse de l’adversaire, fut certes de peu de poids (une oreille où une jolie vuelta aurait largement suffi). La seconde, sur le meilleur toro du jour, fut limpide, en dépit de quelques incidents d’entame (muleta accrochée, torero gentiment bousculé), allant a mas, avec de très belles choses, du temple, de la variété dans les cites, dans les séries, dans les enchaînements, de la verticalité et des séries finales ramassées dans un terrain étroit où la corne rode, et où un poignet soudain s’impose. A l’aguante que nous lui connaissions, mais qui est une disposition plus qu’un programme, s’ajoutent désormais profondeur et toreria qui donnent une épaisseur nouvelle à son trasteo. Une épée hasardeusement al encuentro suivie d’un descabello moyen cantonne la récompense de cette œuvre épatante à une seule oreille. Mais on ne s’étonne plus que Madrid offre 4 contrats pour la San Isidro à un torero désormais à ce point accompli.
La contrefaçon ne va guère à Manzanares. Hélas, il a l’air de s’en accommoder. Toujours lointain et déchargeant la suerte plus qu’il n’est tolérable, il lui reste le temple – mais désormais celui d’un Matias Tejela- , les pechos toujours voluptueux, et l’épée, le plus souvent en place. Mais le tout irrite. Ne reste de ses gestes aucun souvenir ni de la muleta ni du toro ; seule imprime l’image envahissante et saturée d’une statue grecque habillée qui se déploie pour rien. Nous l’avons connu Apollon ou Jupiter. Il traverse sa période « Secret Story », narcissique et déprimée.
Soyons justes : Lopez Simon plaît aux gradins et on est tout falot de se sentir exclu de la fête. Mis à part un physique légèrement dégingandé de post-ado têtu et mélancolique et ce pas à la lenteur outrageusement affectée, je n’ai rien vu ce jour qui m’ait porté à l’enthousiasme. Inapte à la véronique, toujours déployée à l’extérieur, peu convaincant aux quites, je ne lui concède que cette résolution fugace, généralement aux deux premières séries, de se placer, muleta en main, dans le terrain du toro d’où il se fait généralement déloger dans une averse d’enganchones. Après, généralement, il quitte ses zapatillas et donne des passes rapides, sans art, sans jamais se croiser, jouant quelquefois avec le toro en rentrant les reins quand il le cite par derrière, arrucina, cambio ou passe à l’envers, figures dont il se fait hélas une spécialité. Mais même quand on boude, il faut être beau joueur : son entame de faena sur le troisième, doblones un genou en terre, derechazo, changement de main, pecho et le final enchaîné sur le même, brouillon mais spectaculaire, avaient de l’allure (oreille et oreille). Ce jeune torero qui s’épuise à être porté si haut est à la fois résolu et indécis. Il aime manifestement jouer avec le feu puis ne sait plus qu’en faire. Il lui faudra choisir, et sans doute s’ouvrir un peu, se désentêter de soi et songer qu’un combat, comme l’amour, se fait mieux à deux.
Arles, dimanche 27 mars- Juli, Roca Rey/ Daniel Ruiz
Mis à part le premier, à la robe rousse et au fort morillo et peut être le sixième qui ressemblait à un toro, la corrida fut comme un canard sans tête : ça marche tout seul, mais il y manque l’essentiel et bientôt ce sera terminé.
Impression pénible pour l’aficionado qui voit El Juli absolument parfait, pas un geste de trop face à ses « adversaires », rien à jeter, moins penché qu’à l’habitude, le julipié moins manifeste, dominant, templant, s’enivrant de son « poder ». Qui voit tout cela et s’en afflige.
Ce torero aura tué la corrida, banni le trapio et les cornes, l’émotion et l’aléa, imposé sa loi aux éleveurs et aux empresas et fermé la porte à ses petits camarades. Il faut lire son interview, généreusement distribuée à l’entrée des arènes, où il ose expliquer que si les cartels paraissaient un peu répétitifs ces dernières années, c’est qu’il manquait de jeunes toreros pour concurrencer les figuras. Jeunes ou pas, les Juan Mora, les Curro Diaz, les Diego Urdiales, les Paco Urena, les Morenito de Aranda, condamnés aux maigres restes du festin, ont dû apprécier…
Et tout d’impudence, loin de reconnaître que ce monopole qu’il avait construit et imposé avec la complicité d’un G5 ou autre G10 avait fini par vider les arènes par épuisement des meilleurs volontés, il adoube désormais la jeune génération que l’aficion et les nécessités du commerce lui imposent, comme un vieux roi sort d’ultimes atouts de sa manche quand l’ombre de la cabale approche ( deux oreilles sur le cinq).
Roca Rey est une comme une fleur miraculeuse sur ce tas de cendres. Capeador largo et inventif, muletero varié et à la main basse, il surprend et plait à raison. Il y a chez ce jeune torero de vingt ans une maturité, une aisance, un savoir-faire et une fraîcheur qui épatent. On aimerait certes le voir devant des bêtes à cornes… plus conséquentes, mais pour l’heure il est une consolation inattendue à nos peines et à nos désespérances. Un baume bienfaisant sur nos plaies ouvertes (oreille, oreille, salut).
Arles, lundi 28 mars- Escribano, Thomas Joubert, Juan de Alamo/ Pedraza de Yeltes
A Julie, en aficion et en amitié
Bien sûr, ce jour les toros sont des toros. Bien présentés, du trapio, des cornes, de la mobilité. C’en est presque exotique.
Mais le ciel est gris, il fait froid et l’arène est à demi-désertée.
Bien sûr, ce premier qui sort à petits pas du toril se ruera sur le piquero avec puissance, mais c’est surtout un manso qui fuit le châtiment puis, à la muleta, vers les tablas ; le second ne pousse pas et se laisse châtier en carrioca ; le troisième sera économisé à la pique ; le quatrième, le moins joli du lot, sera mis en valeur par Escribano qui demande à son piquero de se placer face au toril, il accourt de loin mais en zigzag, et le picador est si sûr que c’est lui que l’on applaudit, plus que le toro.
Bien sûr Escribano assure face à un lot qui s’éteint et suscite comme souvent l’enthousiasme aux banderilles (la plupart de ses poses sont exposées et le quiebro al violin sur le premier est saisissant). Bien sûr nous sommes heureux de voir reparaître Thomas Joubert dans une si grande arène, émouvant et approximatif face à un bel adversaire plein d’énergie. Bien sûr Juan de Alamo nous épate de tant de volonté en égrenant les naturelles, une à une mais en allant a mas. Bien sûr l’ami Rudy et la banda Chicuelo nous régalent de nouveaux morceaux, dont l’un, plein d’une fantaisie romantique, un peu cocotte (aux banderilles sur le premier), semble promis à un brillant avenir à Nîmes.
Bien sûr tout ça et tout le reste que vous pouvez imaginer. Mais au vrai, pour moi c’était horrible ! Taraudé par le remords de ne pas goûter autant que je l’espérais le lot au triomphe annoncé, doutant de mon aficion ( « Mais quel froid, bon Dieu ! »), sage comme un image à mon rang mais ne songeant qu’à fuguer en maudissant mon absence de force d’âme à le faire. Je me lève, fais quelques pas, me rassois, descends à la buvette, reviens. Ah, voilà Thomas pour son second. « Je regarde puis je file en loucedé. Ni texto ni couronne » me dis-je.
Mais en voyant Thomas Joubert sur ce beau toro brave, d’une vive noblesse et d’une grande classe, nous voilà soudain foudroyés par le miracle : on n’a plus envie de partir, on n’a plus froid du tout, le ciel n’est plus gris et on voudrait continuer à fréquenter les arènes et leur magie des années et des années encore.
On le voit s’avancer à pas lents vers le centre de la piste depuis le toril. Pourquoi le voit-on venir de là plutôt que du burladero des toreros ? On ne sait pas. Il y a de l’irréalité chez ce torero. Sa démarche, légère, comme en suspension au-dessus du sol, sa manière de saluer la foule comme s’il voulait se souvenir de tous les visages, son long physique fragile… Quand il lève sa montera il n’y a dans son geste ni l’affectation d’un Lopez Simon, ni la religiosité d’un José Tomas. Comme écrasé par le ciel, le torero paraît un fétu de paille s’en remettant au vent. Bien sûr, le physique aidant, on songe à Manolete, à ce que l’on en sait et à ce que l’on en imagine. A l’émouvant et déchirant charisme d’un Nîmeno aussi. Mais, les salutations faites, montera lancée et muleta repliée sur le bras, on devine chez le jeune arlésien comme chez son aîné nîmois une résolution intense et bientôt irradiante.
Droit, centré, le bras le long du corps, la main basse, très basse, citant le toro d’un souffle de tissu, Thomas aimante le fauve, l’aspire tout entier au plus près, lie les passes avec le charme vénéneux des fleurs carnivores. Temple, toreria, une toreria folle, rythme et liaison. Tout y est. La première série est parfaite et inspirée, la deuxième inspirée et profonde, passe du cambio, muleta à nouveau repliée sur le bras, elle est déployée cette fois-ci à gauche et ce toro qui joue, qui joue encore et de plus en plus, donne les plus belles et vibrantes naturelles du cycle, et de loin. Dessin, rythme, relâchement complet, abandon du geste. Repos. Les naturelles reprennent, le torero se repositionne, la muleta loin en arrière du corps qui fait face, et ce geste pour citer de verdad en s’exposant tout entier est également une merveille. Le voici maintenant les jambes écartées, de profil mais exactement entre les cornes, d’où il se libère d’un geste, puis d’un autre et d’un autre encore. Le toro sert, c’est sûr, mais lui le domine à chaque passe, de sa position et de son geste, dans un art consommé de l’économie et de la profondeur. Manolete ? Non, je ne crois pas, plutôt l’austérité fiévreuse d’un Viti. Et en dépit de quelques scories ici ou là, une faena de la famille des celles qu’affectionne Madrid, celle d’un Cid inspiré, d’un Urena miraculé. Aux saveurs de toreo grande.
Une demi-épée un peu chanceuse assure à Thomas Joubert deux oreilles qui en valent dix. Des oreilles qui ne sont plus une récompense – ah le vilain mot- mais une onction, un baptême, les langues de feu sur les apôtres. « Allez de par le monde dire la Bonne Nouvelle : ce jour un torero est né en Arles ». Et c’est vrai qu’il est né Thomas Joubert, né à lui-même, transfiguré plus encore qu’irradiant. Ce n’est pas la joie qui l’habite, c’est un sentiment d’accomplissement.
Et voilà qui change tout. Etait-il tout à l’heure écrasé par le ciel ? Il le dévore maintenant tout entier. Un fétu de paille ? A cet instant, il sature la piste de sa présence. Fragile et le pas mal assuré ? Désormais plein de décision, il organise sa vuelta et refuse de se laisser porter par les événements ; il les ordonne. Se faire applaudir, interminablement, mais ne rien oublier. Aller chercher Paquito Leal à la talanquera et le contraindre à l’accompagner au centre du ruedo. Le patron de l’Ecole taurine d’Arles résiste, on l’imagine dire à son ancien élève : « Déconne pas, c’est ton triomphe, profite, lâche-moi ». Mais Thomas ne lâche pas. Il sait ce qu’il veut. « Viens, viens, fait pas ch… , viens je te dis». Au centre, ils s’embrassent, ils s’agrippent, ils tanguent ensemble, ils ne font plus qu’un. Deux hommes, deux destins, une histoire. C’est à vous couper le souffle, à vous faire chialer toutes les larmes de l’aficion. Mais Thomas veut autre chose, il veut qu’on voie autre chose, il veut nous dire autre chose. L’image de ces deux hommes dans los medios, dans ce chaudron d’émotions ne lui suffit pas. Il lui faut un autre geste. Et ce geste inouï, insoupçonné, renversant, c’est celui-ci : ces deux oreilles comme un miracle si chèrement acquis, de ceux qui peuvent sans doute relancer une carrière mais qui vous inscrivent déjà dans l’histoire de cette arène, il les offre à Paquito, il ne les conserve pas sur son cœur, il s’en fout de les avoir dans son salon, il les donne, il les remet. En cet instant de triomphe absolu dont tant d’autres s’enivreraient, il abandonne le talisman de la gloire et nous dit vouloir payer sa dette. Cette leçon est proprement bouleversante.
A la sortie en triomphe par la grande porte, juché dans le tumulte, on voit la manche de son habit de lumière, un peu flottante sur un bras maigre, les passementeries d’or maculées de sang. Descente de la Croix et résurrection d’un torero un lundi de Pâques à Arles.
On pourrait s’arrêter là, mais rengorgés par ce que nous venions de voir, il serait injuste de ne rien dire du dernier combat de Juan de Alamo, si petit, bellement croisé face à un adversaire très haut sur pattes et incommode, croisé sur toutes les séries et quasiment sur chaque passe, toréant dans les canons, avec sérieux et courage. La faena a peu porté sur le public, et c’est bien dommage. Et l’impossibilité pour le petit torero, l’épée en main, de passer le bras au-dessus des cornes, encore si hautes en fin de combat, avait quelque chose de beau et de tragique.
Allez, pour sûr, on en a repris pour quelques saisons encore.