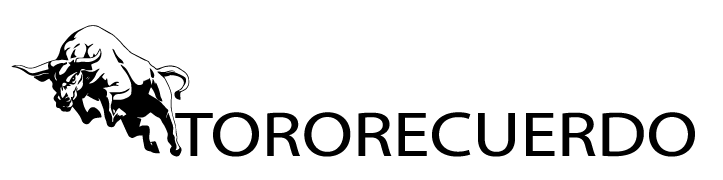Jeudi 13 septembre, novillada Fuente Ymbro
Le Conseil constitutionnel est saisi de la conformité à la Constitution de l’immunité légale dont bénéficient les corridas au titre des « traditions locales ininterrompues ». Le Conseil d’Etat qui se trouve à l’origine de cette initiative s’interroge sur le respect du principe d’égalité en évoquant des «faits commis selon des pratiques traditionnelles locales ». Le choix de mépris du mot «pratiques », associé à une accusation de prétoire (« faits commis »), laisse songeur. On ne sait pas encore ce qu’en pense le Conseil constitutionnel mais, s’agissant du Conseil d’Etat, la messe est dite ! Réponse le 21 septembre. Un ami tranche dans un éclat de rire : « L’égalité entre les bêtes ? Un nouveau droit de l’Homme ! »
Les novillos de Fuente Ymbro ont tout -sauf l’âge- de vrais toros : le poids (trois d’entre eux de plus de 470kgs), le trapio (l’allure générale, le volume) et les cornes. Applaudis pour la plupart à leur sortie, intéressés au combat, mobiles et réagissant vivement aux cites – y compris du piquero quand ils sont bien mis en suerte– ils offrent une belle noblesse, tout sauf fade, avec ce rien de piquant qu’irrigue la caste. Le sixième, un brave, ardant à la pique. Tous d’une belle présence et luttant contre la mort.
Hélas, il y a du vent, ennemi de la corrida plus encore que le Conseil d’Etat.
On annonce l’alternative de Fernando Adrian depuis de nombreux mois, et depuis de nombreux mois on la diffère. Ce novillero est à l’art taurin ce que les énarques sont à la politique. Bagage technique et charme des produits en série ! Il n’a plus l’envie des novilleros et, tout à l’esprit de sérieux et de responsabilité d’un torero d’alternative, il répand l’ennui comme la conversation d’un jeune homme en costume trois pièces. Alors rien n’y fait, ni les passes de cape à genoux lors de l’entame à son premier, ni les passes hautes à la muleta, immobile près de la talanquera, ni encore les manoletinas exposées de la fin de faena. L’impression de fade labeur sera plus forte encore sur son second. Et il a dû faire face à un troisième novillo, son compagnon de cartel, Roman, étant annoncé blessé. Ce novillo
était le plus brave et le plus encasté du lot. Pour Adrian, c’en était trop. Complètement débordé – mais beaucoup de toreros plus aguerris l’auraient été aussi- la main tremblait sous l’épée, le bras manquait d’énergie et Adrian de force d’âme. Ces longues minutes d’échec à l’acier face à une corne droite qui toujours menaçait étaient comme un siège désespéré, faits de vains assauts, toujours recommencés, une guerre de tranchées où le premier soldat sans réflexe sera tué, un corps à corps qui ne peut faire qu’un seul vainqueur. Et à cet
instant de vérité, noble et tragique, on aimait Fernando Adrian. Un beau geste au quite est à retenir de son cartel : immobile face au toro, comme le Don Tancrède de Camillo José Cella, enveloppé dans sa cape jusqu’au col, il cite et se découvre au passage, toujours sans bouger, en déployant un revers de percale vers l’extérieur avant de pivoter sur lui-même pour dessiner une tafallera. Ca c’était beau !
Cette même passe n’a pas réussi à Juan Léal, dernier rejeton de la famille arlésienne qui, s’exposant avec candeur, s’est fait méchamment bousculer, balloter entre les pattes, tenailler entre les cornes. Plus de peur que de mal ! Juan se relève aussitôt, débordant d’énergie guerrière, fait face à son toro, l’aguante, dessine une passe puis dérobe la muleta sans bouger d’un pouce, s’exalte entre les cornes et sous le vent, l’habit déchiré, les broderies dorées qui pendouillent le long de sa cuisse, son caleçon blanc à découvert. L’épée en main, il plonge phénoménalement sur sa bête, comme libéré de toutes les peurs. C’était « Vaincre ou mourir » et beau comme l’Espagne ! Perd la récompense aux descabellos. Vuelta. Juan sera moins convaincant sur son second, le vent et l’inexpérience du jeune novillero ramenant souvent la flanelle sur la jambe…
Roman, de Valencia, a montré certaines dispositions sur le seul novillo qu’il aura finalement combattu. Très dans le sitio, le plus souvent croisé et, sur l’injonction de sa cuadrilla derrière le burladero, baissant la main. Très jolies séries de la droite. Se trouve dépassé sur la corne gauche, et termine, comme Adrian par des manoletinas très exposées, en hommage à José Tomas. Mais le toro passe et part avec la muleta…
Vendredi 14 septembre 2012, mano a mano Javier Castano/Julien Lescarret- Margé
Un mano a mano est un événement normalement exceptionnel au cours duquel deux toreros acceptent de se confronter. Généralement les deux meilleurs. On se dispute alors la première place sur le podium. Competencia dit-on en espagnol. Le mano a mano du jour est tout sauf cela, qui voit s’affronter un torero très digne mais de second ordre, que son spectaculaire un-contre-six de la Pentecôte nîmoise a tiré de la grisaille, à un jeune torero qui a décidé de se retirer du circuit ! Ce mano a mano n’est, en tant que tel, qu’une affiche incomplète, un cartel au rabais. Ils sont deux toreros, le troisième fait défaut. C’est une corrida avec arrêt maladie !
Bon ! Il faut se motiver. Alors j’ai lu cet été le si joli livre d’Yves Charnet « Miroirs de Julien L ». Le journal à cœur ouvert d’un aficionado qui a décidé de suivre Julien Lescarret, mais qui vit, hélas, sa crise de la quarantaine. Du coup l’auteur évoque assez peu Julien L. , torero discret, lucide, intelligent, et souvent malheureux à la mort. Je ne l’ai vu, avant ce jour, qu’une fois, à Arles, face à des Miuras, en avril 2009. Sa force d’âme m’avait beaucoup impressionné. Trois ans après, il se retire. Cette saison est la dernière, et cette corrida celle de sa despedida.
La despedida en espagnol, ce sont les adieux, mais aussi le congé – comme dans « donner son congé à quelqu’un » pour s’en débarrasser- ou, pire encore, le licenciement, avec sa brutalité et le sentiment d’injustice qui s’y attache. C’est quitter contre son gré son boulot, son monde et ses copains. Devoir passer à autre chose. Pôle emploi, amertume et nostalgie.
Despedir – le verbe- c’est jeter, renvoyer, mettre à la porte, mais c’est aussi reconduire quelqu’un, le raccompagner et, à la forme pronominale, se dire au revoir ou faire son deuil.
Eh bien, la despedida en tauromachie, c’est cela tout ensemble : la décision d’un torero d’en finir, parce qu’il le souhaite mais plus fréquemment parce que les circonstances le lui dictent. Une résolution soudaine (Aparicio à Madrid cette année) ou réfléchie comme celle de Julien L. ce jour, mais dans tous les cas un renoncement et une cérémonie des adieux.
Mais de cérémonie, au vrai, il n’y a pas. La despedida, dans l’arène, c’est un geste discret et silencieux en fin de corrida : les compagnons du torero lui coupent la coleta, cette mèche de cheveux tressée sur un bouton, le tout le plus souvent postiche, à l’arrière de la tête. Un clic et c’est fini ! Témoins de ce geste subreptice, nous devinons sous ce postiche qu’on arrache, le poids de l’attente et des doutes, les
triomphes trop rares et les nuits d’insomnie, les jours sans contrat et le miroir qui grimace.
Une despedida est triste et pénible comme une illusion qui se dissipe ou un rêve brisé. C’est un deuil du vivant de celui qui nous quitte.
Voilà pourquoi, offrir, ce jour, un toro de plus à Julien L. quand il a décidé de n’en plus combattre, est une faute de goût. Mais l’autre n’est pas en reste qui d’arène en arène badigeonne sa despedida de fuchsia. C’est la « Pink corrida » explique-t-il ! Et des tee-shirt rose sont en vente devant les arènes. On fait aujourd’hui « marketing/buzz » de tout, même de la fin.
Le vent souffle en rafales puissantes et chacun craint le pire : les toreros bien sûr, que la cape qui s’entorchonne et la muleta qui se dérobe mettent en danger à chaque instant ; l’éleveur, frustré que les circonstances soient contraires et les aficionados le spectacle gâché.
Reste alors la lidia hors le vent, c’est-à-dire piques et banderilles. Et là fut le meilleur d’un après-midi de peu, que l’absence de classe des toros a encore plombé. Tête sérieuse, mais une pénible impression de la peau sur les os en dépit des 510 kgs annoncés en moyenne, mansos et décastés pour la plupart.
Le piquero Tito Sandoval nous aura ébloui sur le troisième, par le brio de sa manière, citant avec sûreté, toujours mobile sur sa monture et, lors de la rencontre, debout sur les étriers, la hampe à l’oblique, toro, cheval et picador paraissant taillés dans un même bronze. En ce seul geste, quatre fois recommencé, les deux dernières en provoquant, depuis la présidence, le toro au centre de l’arène, le hélant à grands cris, la pique tenue à l’horizontale au-dessus de la tête, Sandoval nous a inventé un toro.
Et Dieu sait si cette chose blanchâtre (cardeno claro), qui errait andarin et sans âme dans le ruedo, paraissait dépourvue de bravoure !
Eh bien, en trois piques sûres et puissantes – la quatrième, inutile, faisait système-, Tito Sandoval a contraint ce toro à s’employer. Poussant alors avec puissance, la tête contre le caparaçon, les reins creusés, se tendant, s’étirant, se ramassant dans des ondulations de
guépard, ce toro devenait un toro. Il le fut, hélas, à ce seul instant et entre ces seules mains-là. Une fois repris dans la muleta de Castano, nous n’avons vu qu’une mule, qui marchait en crabe et donnait de temps en temps de mauvais coups de cornes.
Et puis, il y eût David Adalid, le banderillero, l’autre star de la cuadrilla. Une lame. Long et sec. Tout en jambes. Ficelle et avide de gloire. Un cite patient et obstiné avant un por dentro de feu au premier, un quiebro devant une chaise basse au deuxième – « mais elle sert à rien la chaise », marmonne-t-on à mes côtés -, un quiebro extraordinaire d’exposition sur le troisième, et l’arène d’applaudir
debout sa nouvelle coqueluche, qui salue trois fois, montera en mains, sûr de son talent et nullement embarrassé par son triomphe : le maître n’est pas ombrageux !
Un autre banderillero, de la cuadrilla de Lescarret, vêtu de rose comme le maestro, court et ramassé, jambes arquées, plante les bâtons à la El Boni, père et fils, en s’avançant à petits pas, crâne, vers le toro, qu’il cite au dernier moment, comme par inadvertance.
Pour le reste, peu de choses et l’inavouable impression que Castano, hors sa cuadrilla, n’était pas un lidiador parfaitement accompli.
La corrida s’est achevée sur le brindis émouvant de Julien L., banderilleros, piqueros, valet d’épée faisant cercle autour de lui dans le ruedo avant son ultime combat. Ce sixième était le plus toréable du lot et Julien s’est appliqué à le citer de loin, bien campé sur ses jambes, dans une jolie petite faena où il a pu déployer son répertoire, de beaux pechos, des molinetes gracieux, des passes de la firma et
deux trincheras.C’était entre chien et loup. La banda jouait un paso doble un peu triste de kiosque à musique sur place déserte. Voilà, c’était fini. C’était une despedida. Les dernières journées sont rarement les plus réussies.
Samedi 15 septembre 2012, mano a mano Morante, Manzanares/ Victoriano del Rio
Voici un vrai mano a mano. Deux stars et deux toreros qui ont chacun leur manière, et leurs fidèles.
Une confrontation de deux personnalités, de deux artistes.
Morante, dense, sombre, dans une tauromachie qui pèse et assujettit l’adversaire, aux effets baroques et voluptueux.
Manzanares, élégant, déployé, dans une tauromachie qui aimante et aspire le toro, aux lignes fluides, mélangées d’exhibition romantique de soi.
Morante paraît d’un autre siècle quand Manzanares est plus contemporain, les deux un peu dandy mais chacun à sa manière. Le premier entre Baudelaire et Barbey d’Aurevilly, le second entre James Dean et Marlon Brando.
Morante est quelquefois fragile dans l’arène ; on devine Manzanares pouvoir l’être au-dehors.
La corrida sort quelconque de présentation, mais mobile et avec du jeu en dépit de quelques signes de faiblesse. Plusieurs exemplaires avec un rien de piquant : le lot de Morante et le quatrième, pour Manzanares. Un grand toro, le sixième qui pousse le piquero avec une énergie sauvage, violent et encasté aux banderilles, beaucoup de transmission dans la muleta de Manzanares.
Et à l’arrivée, peu de choses.Une faena d’une grande douceur de José Maria sur son très soso premier : il fallait aimer les sucreries ! Les choses se sont compliquées sur son suivant qui s’est récupéré en cours de faena ; José Marie, à toujours flatter l’élégance, a toréé du pico en se tenant à bonne distance. La première moitié était plus convaincante quand, citant de trente mètres, il embarquait le toro dans des passes plus dessinées que profondes mais templées et au tracé infini. Deux merveilleuses passes à chaque fois avant que le toro
ne se rebelle, dont José Marie se libère alors d’un pecho interminable et lointain. Le dernier, sans aucun doute le toro de la feria. Le torero l’embarque, le geste d’une élégance toujours souveraine, mais à la fin (un très vilain bajonazo, l’épée aussitôt retirée, le toro tombe ainsi, orphelin de l’acier) on se souvient davantage de Condor- c’est le nom du toro- que du précieux condottiere.
Et Morante. Dix mille personnes vous diront «Rien », « Le salaud ! », « Il se moque de nous ! » et au vrai, la bronca finale, pour prix
de son œuvre du jour, ne manquait pas d’intensité et lui, d’une inouïe toreria dans ces circonstances, traversant le ruedo à pas lent, majestueux et sûr de son fait. Un capitaine à la Joseph Conrad, seul à ne pas douter face aux paquets de mer et au typhon qui menace.
Car Morante ne doute pas. Il sonde. Il sonde son toro comme une jeune vierge la liste de ses fiancés et s’il ne s’accommode pas, pas plus qu’elle il ne se livrera à un mariage forcé. Il ne sait pas aimer quelconquement et si son partenaire ne le convainc pas, ce n’est pas une affaire, c’est la vie ! La vie romantique. Moi je l’aime ainsi et, comme lui, j’attends. Cela s’appelle l’aficion.
Mais même les jours sans, sa toreria affleure, au moins un peu. L’avez- vous vu templer dans les doblones d’entame de son premier ? Et cette demi-véronique si lente, ce repliement de soie au quite sur le toro de Manzanares ? Et ces véroniques de réception sur le troisième : « Eso es mandar » dit mon voisin espagnol qui, un instant auparavant, répliquait à une aficionada s’extasiant sur José Marie d’un admiratif « No mueve », d’un définitif « No manda ! ». Lui encore, après le plus gros de la tempête lors du tercio de banderilles sur le dernier de Manzanares, présent, attentif aux peones face à ce toro, alors violent, se replaçant systématiquement en recours possible, paré, prêt à intervenir pour le quite en cas de danger.
Si, eso es un torero ! Fut-ce avec parcimonie…
Dimanche matin 16 septembre 2012, un contre six, Jose Tomas/ 6 exemplaires de luxe
Voilà trois jours que l’on fait semblant d’être indifférent aux légendes ; que l’on réprime, non sans mal, tout signe trop manifeste d’impatience. Trois jours que l’on joue à l’aficionado « normal » pour qui une corrida est une corrida, avec son lot de surprises et d’impondérables, peu importe le cartel, pourvu qu’il y ait des toros. Voilà trois jours qu’on joue au con !
La présence de José Tomas à Nîmes, en cette saison où il n’aura toréé que trois fois, et ce un-contre-six si spectaculaire, est un
immense événement, que j’attends depuis des semaines avec joie et appréhension, comme un enfant le jour de Noël : pourvu que la journée soit réussie, les parents généreux et moi en forme ! Un jour pareil pour un gosse, y en a pas deux dans la vie. Et on ne songe pas alors à l’année suivante.
Eh bien, je suis ce gosse. Taisant depuis trois jours pour ne rien provoquer qui pourrait briser le rêve ou me gâcher le plaisir de l’attente. Trois jours que je songe à l’image ce torero entrant dans l’arène, à sa seule présence ici, à son magnétisme et à son mystère, à ses silences, à sa muleta ramassée, et aux lignes épurées de son toreo. Trois jours que j’imagine qu’il pourrait toréer dans le silence, qu’on
interdirait la musique comme à Madrid, et que ce serait mieux. Trois jours que je redoute l’inépuisable abattage du producteur de spectacle qui pourrait encore nous inventer quelque chose, comme si la présence de Jose Tomas ne se suffisait pas à elle-même. Il flatte la rumeur qui chuchote que cette corrida pourrait être la dernière du torero, escomptant sans doute tirer des miettes de gloire d’une si funeste perspective. Se boursoufflant quand on s’afflige. Simon, je t’en prie, ne nous gâche pas ce cartel que tu nous offres ! Tu as fait
l’essentiel, merci ! mais aujourd’hui, pitié, tais-toi !
Voici ce que je pensais en allant aux arènes. Mais Simon Casas n’a rien eu à faire !
11h30. Clarines ! Plein soleil sur l’amphithéâtre et frise de silhouettes qui se détachent sur le ciel au dernier gradin : c’est la dentelle des grands jours. José Tomas à cet instant est encore dérobé à nos regards, pris dans les obscurités du patio de caballos. On ne le voit
pas ! Sol y sombra et le sol est partout ! Quand les aguaziles à cheval ouvrent le paseo en traversant à pas lents le ruedo pour aller saluer la présidence, toujours rien. Et ce paseo si lent qui retarde encore les présentations est à peine supportable. Puis il paraît,
salue sobrement ses compagnons, et traverse, marmoréen, le visage très pâle, la clameur immense, sans rien manifester d’une nature qui nous serait commune.Onze mille aficionados, debout, applaudissent à tout rompre, dans un face à face étrange où la manière du torero nous tient malgré tout à distance.
Et de cette manière, il ne se départira jamais, en six toros. Concentration, sûreté, économie de geste surtout -pas un de trop, rien d’inutile. Ajoutez la lenteur, la variété des suertes, des enchaînements et des recortes, et vous comprendrez que sa tauromachie, ce jour, était un traité de toreo, une leçon à livre ouvert, mais ce livre serait un incunable. Un exemplaire unique, une relique. Lidia et pureza sans copie ni postérité possible.
Tomas choisit le sitio, toujours différent d’un combat à un autre, et le toro n’aura jamais le choix ; d’un toque, parfois d’un souffle de muleta, il viendra à juridiction. Et de cet emplacement que le torero lui impose, le toro ne s’échappera plus. Mais là n’est pas encore le plus saisissant. Ce qui l’est, c’est l’effacement du corps du torero sous la perfection du sitio et du geste, la limpidité de la passe, le tissu qui dessine des lignes lentes, et on ne voit plus que ce tissu et le toro. Un vrai mirage ! Il n’y a chez Tomas, aucune trace de manifestation de dominio, aucune volonté de vaincre, aucun geste pour la galerie, peu de desplantes où le torero composerait la figure. Il y a un corps qui s’absente et, comment dire ? un extrait de toreo, comme il y a des extraits de parfums : une évaporation de classicisme et d’art. La recherche ultime d’une émotion intacte où seul le toro serait en scène.
Six toros de trapio correct mais aux cornes commodes, sauf le sixième, un Victoriano del Rio plus armé que les autres, et j’aime que ce toro sorte en dernier.
Le premier, un Victoriano del Rio (564 kgs), bravote, manque de présence au dernier tiers, mais José Tomas sait le mettre en valeur, par statuaires, derechazos pieds joints sans bouger d’un pouce, et une série de naturelles épurées et lentes, des passes de cartel, avant deux aidées par le bas. Vingt, trente passes au maximum, toutes de perfection. Epée phénoménale, en la crux, le toro s’effondre dans une arène déjà commotionnée. Tomas se fait remettre ses trophées (2 oreilles d’évidence), sans sourire, impassible, comme si
rien dans tout cela n’était exceptionnel, ni l’œuvre accomplie ni l’ébullition dans l’amphithéâtre.
Le deuxième est un Jandilla (515kgs) désordonné, manso, à peine piqué au deuxième picotazo. La faena sera exclusivement droitière pour ce toro qui proteste à vous arracher le cœur : il ne mérite rien d’autre ! Mais après trincherillas et passes par le bas pour le réduire, les derechazos seront profonds, hondos, bâton à l’oblique, changement de main dans le dos, passe du mépris. Le toro s’en va vers la barrière à la faveur d’un molinete ? Tomas, jamais en échec, le rattrape, recommence, lui apprend cette fois-ci à rester dans la muleta. Suivent trois derechazos énormes de tout, de domino, de temple, de toreria. Manoletinas dans un face à face de silence et de clameurs, puis une mise en suerte inouïe, dans une alegria d’enchaînements de vuelos de muleta, trigonométrie de fantaisie et de mystère qui laisse le toro et le torero, chacun à son exacte place, celle de l’épée et celle de la mort. Epée que je vois un peu delantera. Deux oreilles ; une seule eût été parfait.
Mais la féerie taurine- il n’y a pas d’autres mots- sera sur les deux suivants. La lidia sur le toro d’El Pilar, le toreo puro sur le Palarde.
Le premier (542kgs) est exigeant et sans doute le plus brave du lot. C’est d’abord à la cape, une larga cordobesina pleine de toreria pour la mise en suerte au cheval, puis au quite une cape qui s’envole, tenue à bout de bras, lancée par le torero au-dessus de sa tête, en une figure gracieuse, un étirement élégiaque : faroles mexicanos ? Un début de faena à couper le souffle de toreria, par doblones des lignes au centre, dessinés et dominateurs, des jets de muleta, secs comme fouets, reptiliens et limpides, où le toro s’aimante. La leçon est saisissante et le toro est désormais à la main du torero pour une tempête de sept ou huit derechazos templés, liés, rythmés, très toréés. Le mouvement lent peut suivre, de naturelles enchaînées, le bras relâché, très relâché, et la main basse, très basse ; un soupir de faena, aux douceurs de consolation. Passes hautes derrière le dos qui ne sont pas des manoletinas mais autre chose, farol élégant et, soudain, José Tomas s’immobilise en un orgueilleux desplante. Est-ce le tout ? Est-ce ce desplante ? Cette image orgueilleuse de contentement de soi, si rare chez José Tomas, qui nous autorise enfin à exprimer notre admiration ? Nous sommes alors onze mille à nous lever et à crier « Torero ! Torero ! Torero ! ». Cinq aidées par le haut clôturent cette merveille de faena qu’une épée parfaite conclut sur deux oreilles.
Le Palarde qui suit (510kgs) est d’une très grande noblesse et s’emploie avec alegria et codicia. La cape de Tomas est de soie, et non de percale, nous l’éprouvons à l’instant, tenue à bout de doigts, pour des véroniques pleines de desmayo, d’une lenteur émouvante – les plus belles passes de cape de son solo- et une demie dans laquelle le torero s’enveloppe. Mais la symphonie est loin d’être achevée : suit un quite majestueux que je ne sais pas décrire – on me dit qu’il s’agit de caleserinas-, une mise en suerte au cheval par largas puis, après la pique- comme la première, symbolique-, une cape ramassée en une seule main, dont le torero se joue comme d’une muleta suspendue pour des « naturelles » et un « pecho ». C’est inattendu, souple, aérien. Raphaëlique. On est soudain au paradis, c’en est trop : « Torero ! Torero !Torero ! ».
José Tomas est maintenant au centre, la muleta repliée sous le bras. Il hèle à peine le toro et le toro accourt ; la muleta est déployée au dernier moment pour une naturelle et une autre et une autre encore. Une fugue de naturelles. C’est la faena sans épée, la flanelle et elle
seule, que la muleta soit tenue de main droite ou de main gauche. Est-ce la douceur, la lenteur, la suavité des lignes sur le sable, ce torero qui parle à voix basse à sa bête ou celle-ci qui jamais ne se lasse ? Tout paraît irréel, sauf les larmes d’émotion sur nos visages.
On imagine que c’est ainsi que José Tomas aime toréer, en abandonnant les armes, en s’en remettant au sort, à la recherche des harmonies intimes où il ne ferait qu’un avec son toro. Les aficionados le sentent qui demandent grâce, tout à coup, non parce que les qualités du toro le justifieraient, mais parce que le toreo de Tomas, avec ce toro-là, le commande. L’arène exige que le toro ait la vie
sauve parce qu’elle répugne aux amputations. Et nourrit peut-êrtre la superstition païenne que cette vie sauve d’un toro épargnera de nouvelles épreuves au torero qui s’est trop fréquemment vidé de son sang.
José Tomas se dirige vers la callejon, s’empare de l’épée, paraît un instant surpris par les réactions partagées de l’arène, hésite, voit le mouchoir d’indulto, dessine quelques passes, puis jette l’épée à terre et fait le geste du simulacre, la main sur le garrot. Un geste furtif, comme une caresse pudique, retenue, mais que l’autre a su comprendre. Le soleil est à l’aplomb et le toril encore loin, désormais refuge de son partenaire de triomphe. Tout autre se serait alors livré sans retenue à l’admiration de la foule, croyant en avoir terminé en
beauté. Pas Tomas qui de quelques passes de muleta raccompagne encore le toro vers les chemins retrouvés du campo, jusqu’à la porte du toril. Et quand on lui remettra les deux oreilles et la queue postiches, il s’en trouvera embarrassé, comme d’une incongruité, d’une récompense de mauvais goût. Il les pose sur le sable et fait un salut mystérieux vers le toril, comme à un ami.
Il y a deux toros encore, un Garcigrande (495kgs) de moindre classe, et à nouveau un festival de cape (mariposas, chicuelinas, une
demi-véronique de gala) suivi, à la muleta, de naturelles, citées de 20 mètres puis comme expirées, une épée parfaite et deux oreilles où une aurait suffi. Un Victoriano del Rio pour finir (514kgs), plus armé que les précédents, à la charge brutale et courte. Des gaoneras serrées puis José Tomas se met dans les cornes et provoque la charge avec aguante, immobile sous la menace constante des cornes, en une citation de sa tauromachie d’avant, qui n’a pas été celle du jour. Autre épée décisive -ce qui fait cinq sur cinq- et une oreille en
récompense que personne n’avait songé à demander.
Voilà, c’est fini ; on demeure longtemps dans le firmament taurin où cet homme nous a amenés. Un torero non pas retrouvé, mais dans sa plénitude. Ni celui qu’il était avant sa retirada, ni celui qui est revenu l’an passé après la blessure majeure d’Aguascalientes. Nulle recherche d’exposition de soi dans le sitio du plus grand danger comme jadis, plus de dépouillement janséniste comme l’année dernière. Ici, une des plus belles pages taurines vient de s’écrire. Un José Tomas nouveau est arrivé.
Et chacun, tout au long de la corrida, de signifier qu’il en était, par des cris de ralliés : « Cataluna taurina presente! » et la foule de répondre « Viva ! » ; « Coruna taurina ! » « Viva ! » ; « Viva Colombia ! » « Viva ! » ; « Viva Mexico », « Viva ! ». Et dans les clameurs, soudain ce cri : « Tu eres el numero uno ». Ma voisine, de Santander, de murmurer, comme pour elle-même : « No! Este no esta sobre la lista !».
Dimanche 16 après-midi, mano a mano Juli/ Castella- Daniel Ruiz
Là encore, l’affiche paraît incomplète, mais nos deux hommes sont des compétiteurs, alors pourquoi pas ?
Juli a cette année mauvaise presse en dépit de son cartel incontesté, et il a eu la mauvaise idée de twitter son amertume après avoir été sifflé à Dax, il y a dix jours. Pendant ce temps, Sébastien Castella tentait, à terre, de repousser la corne d’un taureau qui lui pesait sur la carotide, dans une arène de village en Espagne. Et il s’est abstenu de faire part de ses états d’âme sur les réseaux sociaux.
Soyons justes, nous étions encore dans le songe du matin, et l’arène toujours KO debout. Nous avons vu que les toros de Daniel Ruiz étaient mieux armés que le mesclum d’élevages choisis par José Tomas, contrairement à ce qu’indiquait la rumeur, et qu’il fallait s’en
occuper avec sérieux, en dépit de l’insignifiance des piques et de leur absence d’engagement.
Juli est arrivé le pas martial, comme si le seul mano à mano qui l’intéressait était par procuration un mano a mano avec Tomas, cherchant à préserver son cartel et sa place de numero uno sur la liste qu’évoquait ma voisine de Santander. Concentré, compétiteur, mais se trompant de corrida et de challenge, il en a perdu son latin. Technique, certes, surtout sur le cinquième (une oreille), mais curieusement pueblerino, ne parvenant pas à dominer son premier qu’il a tué d’une vilaine épée à la fois trasera et basse – laquelle n’a pas dissuadé la présidence de lui accorder une oreille, aussitôt protestée-, il a été méconnaissable sur son deuxième dont
il n’aurait fait qu’une bouchée en début de saison.
Castella, lui, a un mental de guerrier et ne s’est pas trompé de combat. Le seul qui l’intéresse : celui contre les toros. Et ne se laissant ce jour distraire par rien d’autre. Une faena maison, très agréable à regarder, bien menée, avec aguante, rythme et liaison, gorgée de sève, comme un arbre jeune qui ne demande qu’à grandir, sur son premier. Sans grand intérêt face au flojo et manso quatrième, qui saute pattes en avant, puis gratte le sol, le mufle sur le sable, avant de s’éteindre. Bordant le toreo sur son dernier, la faena variée, inspirée et lumineuse, allant a mas, merveilleusement servie par le pasodoble « Concha Flamenca » et ses solos de trompette à vous soulever l’âme. Deux oreilles, et une sortie par la Porte des Consuls aux couleurs de l’évidence.