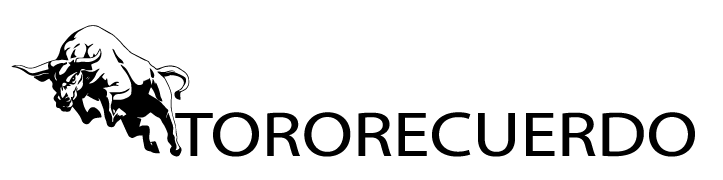Jeudi 20 mai 2010, Julio Aparicio, Sebastien Castella, Alejandro Talavante- Nunez del Cuvillo
Il y a de drôles de jours où l’on se réveille le matin à Paris, la lumière est belle, la ville toute d’un soleil d’août, et l’air léger comme un désir de fuite : partir dans le sud, retrouver les arènes, les amis, les toros. Vive la féria ! Et puis il y a le train et ce ciel soudain gris, ce temps qui change, cul par-dessus tête, moins beau au fur et à mesure que l’on file vers le Midi. A l’arrivée, Nîmes pommelé de nuages, pas très chaud, du vent. Très fort hier, lit-on dans la presse, durant la course des Miuras. Aïe.
Je suis ici un jeudi parce que José Tomas avait été annoncé. Très grièvement blessé au Mexique, aujourd’hui convalescent, et durant encore de nombreux mois, malgré la légende qui frappe à la porte des chiqueros annonçant déjà son retour, il est remplacé par Talavante, torero vertical comme lui, proche des cornes lui aussi, à la recherche d’une tauromachie intérieure que l’autre a trouvée. Talavante admire Tomas, il le raconte sur tous les tons, et c’est une oreille que lui aurait lancée Tomas, à lui enfant de Badajoz venu aux arènes avec son oncle, qui aurait décidé de sa carrière. On ne sait pas ce que Tomas pense de Talavante.
Mais les aficionados sont mieux éduqués qu’on ne le dit. Ce jour, nul n’évoque Tomas – alors que chacun y pense- faisant mine de se réjouir de l’affrontement Castella /Talavante. On ne parle guère du vent – sinon pour constater qu’il est moins fort, beaucoup moins fort, qu’hier- et on oublie Julio Aparacio, parce qu’on s’en fout.
Julio Aparicio est chef de lidia, il en faut bien un, un torero plus ancien qui veille sur ses plus jeunes compétiteurs et remplace, le cas échéant, celui qui tombe. C’est un rôle ingrat dont de nombreux toreros punteros, tel Tomas, ne veulent pas – tuer deux toros est déjà une épreuve, en affronter trois en cas de blessure d’un compagnon de cartel, non merci ! Alors on trouve un torero qui n’a d’autre choix que d’accepter le poste, et cet emploi si déserté peut faire une nouvelle carrière. C’est le cas de Julio Aparicio et de quelques autres.
Ce « moins chaud qu’à Paris », ce voyage en train qui a paru un peu long, ce léger vent, l’absence de José Tomas – au vrai cette privation inconsolée pour un aficionado-, Castella que l’on peut voir trente fois la saison si l’on veut, et vingt cinq fois pareil en ce cas, le discret Julio Aparicio, bon…l’humeur est atone.
Et dès la fin du premier toro Nunez del Cuvillo, petit comme le seront les suivants – on ne le sait pas encore mais on le devine-, sans présence, aux armures plus que commodes, faible sous la pique, une impression de lassitude gagne, comme à un cinquième toro de la sixième corrida d’un cycle. Et comme à un cinquième toro de la sixième corrida, on se distrait d’un rien. Et ce jour, ce rien qui divertit, ce sera, par deux fois, le train de mules d’arrastre qui partent, capricieuses et impatientes, avant que les areneros n’aient arrimé la dépouille du toro mort, qui reste abandonnée sur le sable quand les mules s’éloignent. Sifflets, retour des mules idiotes, arrimage et départ, tout en un cette fois, sous les applaudissements du public sevré d’autres triomphes.
Nous en étions là, ou à peu près, quand sort le 4ème , Ropalimpia, un joli toro noir de 520 kgs, le seul aux armures convenables de la course, ce qui, par contraste, paraît beaucoup pour le prudent Aparicio. On soupire…
Aparicio est un torero gitan. On se garde depuis Hemingway d’y revenir mais le préjugé est tenace : le torero gitan serait peu conventionnel, tout d’inspiration, couard ou bravache selon les jours, les deux le plus souvent à la même minute, irrégulier, très gravement irrégulier, à tous les sens du mot, mais c’est aussi, c’est surtout, un immense artiste. Rafael de Paula, Curro Caro, Aparicio, et tant d’autres avant eux. Le préjugé est si tenace qu’il cimente une forte complicité entre le torero gitan et les aficionados. On n’attend rien d’un torero gitan, on sait qu’il ne faut rien en attendre. On attend seulement que ce soit son heure, qu’il en décide ainsi, quand il le voudra, aujourd’hui devant un toro astifino, ou dans trois ans devant cet autre con casta, sans qu’aucune rationalité n’ait sa part dans le choix de l’instant, si longtemps différé, mais alors de grâce. On attend comme on le fait pour un guitariste ou un cantaor flamenco. Ca peut venir, ou pas, ça peut venir un peu ou surgir soudain, comme l’eau que découvre le sourcier. Mais alors, d’un coup, tout se met à trembler.
La certitude de ce mystère apaise les aficionados que jamais l’échec du torero gitan ne déçoit. Les plus toristas des afionados ne font pas exception à la règle. Ils n’aiment pas moins que les autres le torero gitan, parce que, comme tous, ils savent que le jour « où ça veut»….. Les aficionados goûtent aussi les déroutes du torero gitan, parce qu’elles sont souvent grandioses, et au vrai, chaque fois différentes, aussi insoupçonnées que ses triomphes. Ils s’amusent de sa frousse, de ses mimiques, de cette tête qui dodeline, des ses bras grands ouverts qui prennent le public à témoin que c’est impossible, là vraiment impossible ! Ils s’en amusent, pas par méchanceté mais par mimétisme.
Car c’est un autre mystère de l’irradiation gitane que le public finisse par ressembler au torero, irrévérencieux là où l’autre néglige la convention, braillard et persiffleur quand l’autre gesticule en courant sans façon vers ses peones qu’il injurie comme un charretier, n’hésitant pas, lui le public, à interpeller le maestro avec familiarité, dans une complicité de registre où il faudrait commencer par le vulgaire.
Notre homme, Aparicio ce jour- dans un habit couleur revers de cape gitane à parements noirs-, avait déjà essuyé d’affectueux quolibets quand à la cape, sur le toro de Talavante, il s’était ridiculement précipité pour livrer un quite baroque en prenant la pose, quasiment dans les pattes du cheval du piquero, lequel était en train de sortir de l’arène, comme s’il y allait de sa vie de ne pas perdre une telle chance et de son honneur de refuser d’y renoncer au motif qu’il était trop tard. L’injonction d’une telle inspiration intérieure fut, bien sûr, maladroitement exécutée. Mais inspiration intérieure il y avait, songions-nous in peto, et pour peu qu’une seconde injonction lui soit faite, de même nature mais plus opportune…
Ropalimpia, donc, la lui offrira. Dès les passes d’entame, Aparicio prend la pose du combattant inspiré pour, cette fois-ci, offrir quatre véroniques de complet envoûtement, à la fois puissantes et aérées, dans une cape fleurie, toute de respiration, qui fait oublier le tissu pour ne laisser voir que le geste.
Le public, encore goguenard mais déjà saisi, hurle sa joie, dans une même complicité exaltée avec le torero gitan, où l’on se moque ensemble du code et de la convention – lui, en manifestant un volontarisme vulgaire, comme un catcheur qui se jette sur son adversaire en hurlant, avant de dessiner un lance souverain d’exposition de soi et d’enveloppante douceur ; nous, en nous moquant quand même, comme pour faire augmenter la température. Mais ce sont, pour nous comme pour lui, dans ce fatras de bruits, de cris et d’exclamations mêlés, des éléments en fusion, comme une forge où la lame s’aiguise.
Encore étourdis par la scène, nous voyons Aparicio mettre en suerte son toro par chicuelinas marchées très allurées, puis crier au piquero, sur le ton d’une marchande de poissons à son nigaud de mari « saca lo ! », « saca lo ! » pour que l’autre économise le toro à la pique. Mais le « fauve » est brave et pousse jusqu’à renverser la cavalerie, avant d’y revenir avec classe pour un second châtiment, celui-là plus discret, sous les cris, les objections et les ordres que le torero intime à son subalterne d’en finir sous peine de licenciement. Sans aucun souci du paraître, majestueux de vulgarité.
Tout ceci nous fait bouillir davantage encore, lui et nous, car lui comme nous devinons que « ça peut » mais que ce n’est pas encore sûr.
Et puis tout s’enchaine très vite, un banderillero brillant invité à saluer le public, Julito qui offre son toro à une jeune femme en fauteuil roulant, puis citant son toro…à genoux, dessinant trois passes avant de se relever-non sans peine, et cet âge qui ankylose donne plus de prix encore à cette volonté de jeune homme- pour livrer deux passes par le bas, abandonnées.
Après c’est un toreo de ceinture à droite, le bras le long du corps, très relâché, dans une grande économie de geste, la main qui avance peu, comme s’il suffisait de donner le toque quand on est bien placé – de trois quarts-, la muleta à l’oblique du sol dans une passe dix fois plus courte que celles que nous servent les toreros du temps, dix fois plus courte mais riche de toutes les émotions du toreo, la lenteur, le dessiné, la domination de la bête. Une passe vaporeuse à regarder- commencée aérienne, de ceinture, puis dense de domination, le bras très lent, la main plus basse, avant de relâcher la pression, rematant en revenant à la ceinture-, mais vipérine de tout le venin du monde pour le toro. Une passe. Et une passe de poitrine kilométrique et templée en terminaison. Autre série, le toro cité à 15 mètres, deux derechazos de la même eau, changement de main, et une naturelle templissime, de tout le temps suspendu du monde. Une série gauchère de grande suavité et à mi-distance -et cette distance est belle de l’attente assurée du torero, du pari sur l’embestida du toro, de la certitude de leur rencontre. Puis une dernière série de la main droite, les pieds joints, d’un grand classicisme et de très puissante allure. Voilà, c’est tout. Quinze passes, vingt peut-être, dont chacune était une leçon de toreo fondamental, sans autre fioriture qu’un changement de main et des terminaisons par le bas, qui laissent le toro aux pieds du torero.
Une belle entière, un peu en avant, ne parvient pas à nous réveiller d’un tel songe et lui, comme en proie aux ultimes secousses du duende, longeant la barrière, comme le font les toros braves pour mourir, groggy par ce qu’il vient de réaliser, serrant les poings près de la tête, comme si cela faisait trop plaisir, ou trop mal, d’avoir été ce jour le jouet d’un destin favorable, un entremetteur d’art, comme il savait et nous savions qu’il l’était, depuis ses premiers pas de novillero à Nîmes, il y a plus de vingt ans, par une matinée écrasée de soleil. Et qui ne nous sommes jamais lassés, ni lui ni nous, d’en attendre, sans impatience, une nouvelle preuve, sachant qu’elle serait alors étourdissante.
Une vuelta excessive al toro et deux oreilles, bien sûr, pour le torero qui entreprend une vuelta lente fêtée dans la ferveur du temps retrouvé – nous avions, chacun, vingt ans de moins-, après avoir ramassé une poignée de sable de la piste que normalement le torero pose sur le cœur et que lui met près de sa bouche, comme pour s’en barbouiller le visage en un geste de sacrifice et d’offrande, qui sonne comme un baptême au paganisme étrange.
Pour le reste, de maigres détails. Castella gêné par la faiblesse de son lot et par le vent sur le 2, anovillado qu’il accueille de six passes, assis à l’estribo, quelques derechazos main basse où le toro se défend, aussitôt châtié de son genio par une belle trinchera et trois ou quatre autres passes de la droite, notables quand le vent faiblit (une oreille), un excellent réglage de la tête en encensoir du 5 en une seule série technique.
Quelques jolis gestes de Talavante, très concentré, sur son premier, aux passes lentes, décomposées, l’étoffe lancée vers le toro en un doux racolage, le bras lent, le poignet agile. Une passe qui, comme chez les grands, a un début, un milieu et une fin, et se donne à voir comme un tout qui se suffirait à lui-même quand tant de séries, chez tant d’autres, sont sans histoires. Sur le six, jabonero aux cornes courtes, une seule série de naturelles d’entame aérées avant un toreo superficiel, lointain et profilé.
Je cesse de prendre des notes, renferme carnet et stylo, et m’apprête, comme tous à cet instant, à faire un nouveau triomphe à Aparicio, pour sa sortie des arènes. Nul ne sait encore que cette Pentecôte de résurrection du torero gitan s’achèvera en Golgotha. Le lendemain à Madrid.
Vendredi 21 mai 2010, Juan Bautista, Matias Tejela, Arturo Macias- José Vasquez
Un premier rang de barrera juste derrière les toreros, les capes de paseo étendues sur le boudin, ce sont évidemment des places de choix et pour moi une première à tous égards. On voit le toro de près et on frémit un peu, on admire les costumes de lumière mais l’usure de l’habit d’un péon crève les yeux. Dans le callejon qu’on surplombe, les cuadrillas s’agitent, le valet d’épée nettoie à la brosse une cape sale, un torero s’emploie à la muleta de salon, attendant son heure, un subalterne sort une cigarette, l’allume, la passe à un collègue (« Tu fais tourner ? »), la cruche est en place, non ! on la transporte ailleurs ; on vient, on va, on discute, on s’éloigne, on tire sur sa chaquetilla, on fait de petits sauts, les pieds joints, pour se détendre ou on contrôle d’une main dans les cheveux l’effet de la montera sur la gomina.
On peine, à de telles places, à se dégager de cet envers de la corrida, et il n’est pas sûr que le spectacle y gagne. C’est comme voir une pièce de théâtre depuis les coulisses, la proximité avec les acteurs flatte ou ravit, mais que saisit-on, en définitive, de la représentation ?
Les toros, depuis cette place proche du ruedo, me paraissent bien présentés, mieux qu’hier en tout cas, joli trapio et belles cornes. Hélas au comportement, ils se révèlent très faibles (excepté le premier) obligeant les toreros à des faenas d’infirmière ou à mi-hauteur, s’avachissant dès que la main est basse. Ajoutez du vent et vous comprendrez que c’était le jour à être en barrera, tant la représentation était médiocre et les coulisses distrayantes.
Arturo Macias, torero mexicain, « confirmait » une alternative qui l’avait déjà été à Mexico, il y a quatre ans. Ces mystérieuses « confirmations » d’alternative dans les arènes de Nîmes ne me disent rien qui vaille, mais peu importe. Seul Simon Casas y accorde de l’importance – le directeur des arènes est l’inventeur de cette cérémonie qui ne s’imposait naguère qu’une fois et seulement dans les deux villes capitales de la tauromachie que sont Madrid pour l’Europe et Mexico pour l’Amérique du Sud, souhaitant, semble-t-il, « nationaliser » cette confirmation en France, comme si Mexico n’était rien et Nîmes l’égale de Madrid. .. Voilà longtemps que les aficionados sont indifférents à un tel boniment, qui n’est plus même annoncé par la presse.
Arturo s’accroche un peu à son premier, parado à tête violente, qui avait poussé avec force à la pique mais arrive épuisé au troisième tiers, auquel il sert quelques derechazos bien dessinés avant que le toro ne se réserve à gauche puis fuie vers les tablas. Le trasteo est propre mais sans grande imagination. On voit le torero s’inquiéter auprès de son homme de confiance «Qu’est-ce que je fais maintenant », l’autre de lui répondre depuis la barrière « No sé… », et Arturo de s’exclamer « A ver !» avant de donner quelques manoletinas dont il a l’air content. Une demi- épée suivie d’une autre, au tiers cette fois-ci.
Juan Bautista a de jolis gestes devant un lot faiblissime qui a l’air de moins le désespérer que le public ; une belle série gauchère à son premier dont il allonge la charge (belle épée), une grande douceur sur le 4 qui ne fait hurler d’enthousiasme que sa cuadrilla, avant de tenter une épée al recibir, incompréhensiblement face à un toro d’aussi peu d’allant.
Matias fera ce qu’il sait faire sur le 3 -toro qui a l’air de s’intéresser mais un peu andarin- dans l’indifférence générale, tant il est précautionneux au début. Lointain sans doute, mais qui tire interminablement de longues naturelles, ensuite reprises et ornées d’un farol suivi d’un pecho kilométrique. Série de derechazos, étirés à l’extrême, et manoletinas sans grâce et « bougées » là où l’on se doit d’être immobile. Matias que j’aime bien mais qui ne se croise jamais – il doit penser que son allonge de bras l’en dispense- plante malencontreusement une vilaine épée dans le flanc, avant de se reprendre, cette fois-ci dans les canons, et d’aller bouder, les bras ballant sur la talanquera.
Belle estocade de Macias sur le 6.
Voilà ce qu’était la corrida, mais une autre scène se jouait ailleurs dont la nouvelle s’est répandue ici comme trainée de poudre, lors du combat de Matias sur le troisième. Un malheur, un grand malheur. Aparicio blessé à Madrid sur son premier toro. Aparicio qui avait triomphé ici même la veille, en une résurrection de feu… Une blessure atroce : la tête du torero fichée sur la corne du fauve, comme un bilboquet. Le torero qui glisse et tombe dans les pattes du fauve, un mufle qui se baisse, la corne qui cueille l’homme à la gorge, le soulève, puis cette tête d’homme à l’horizontale, les yeux au ciel, la corne …. ressortant par la bouche, de dix centimètres.
La corrida de Madrid était télévisée, les images repassent en boucle au 421, bar taurin nîmois non loin des arènes, passent et repassent au ralenti, dolorisme espagnol oblige. Internet s’en empare, les photos circulent de téléphone portable à téléphone portable. Les messageries sonnent. « Nouveau message » : c’est cette image. Une fois, deux fois, dix fois, sur les portables de nos voisins. Qui aussitôt commentent, se tapent sur l’épaule, font voir à d’autres, ne cessent de s’exclamer : « t’as vu la corne ressort par la bouche», bavards, indifférents au spectacle d’ici, insoucieux que la rumeur se propage dans le callejon et puisse arriver aux oreilles des toreros du jour.
Oui, s’en foutant, davantage hypnotisés par le spectaculaire qu’affligés par le drame, tant l’image saisissante du malheur estompe la compassion – lire et relire « Le Peintre des batailles » de Perez-Reverte. Les premiers rangs des gradins ne sont plus que commentaires de chirurgiens, froids, techniques, presque ravis de la primeur pour les futures discussions entre spécialistes.
On a envie de crier « stop !», de hurler son dégoût que l’on parle aussi abondamment de corde dans la maison d’un pendu, de faire barrage de son corps à ce premier rang, de créer un cordon sanitaire pour que la nouvelle ne tombe pas dans le callejon et que les toreros,en train d’œuvrer, soient épargnés le temps de la corrida. Il sera bien temps …
On a envie de ne plus penser à Aparicio. On veut tenir le drame à distance pour demeurer dans l’illusion que la corrida d’ici est sans enjeu, vaguement ennuyeuse, avec des toros faibles et des toreros qui ne se croisent pas. On aime soudain les toreros du jour, oui on les adore tout-à-coup, Juan Bautista, Matias, Arturo. On veut les protéger comme une mère : « Non, ton père n’est pas encore rentré, mais vas te coucher mon petit, il rentrera plus tard, ne te fais pas de souci. Tu sais que ton père t’aime, alors finis ta soupe ! ».
Oui, on sait, désormais, que la corne rôde et, eux, ne l’oublient jamais.
Sur la photo, les traits de cette tête transpercée sont comme naturels, aucune des lignes du visage n’est altérée, pas même une grimace, on voit le nez, on voit les yeux, on voit les cheveux frisés sur le front, à l’implantation lointaine. C’est bien Julito. Avec une corne qui ressort par la bouche et un regard de toute la terreur de l’Enfer.
Samedi 22 mai 2010, Antonio Barrera, Cesar Jimenez, Ruben Pinar- Fuente Ymbro
Fuente Ymbro de belle caste, très bien présentés, et de beaucoup de jeu ; un régal de corrida, sauf le 2 un peu faible.
Le 1 pousse à la pique, vient de loin et mange tout cru un Antonio Barrera, vulgaire, qui tue cependant d’une belle épée.
Le 2, un toro roux au port altier, applaudi dès son entrée en piste (584kgs), se révèlera faible, face à un Cesar Jimenez sur le reculoir, qui se fait désarmer et abrègera.
Un 3 de belle présence devant un Ruben Pinar, volontaire et alluré, la jambe courte, les fesses en arrière et l’aguante de ses vingt ans. Trois pechos sans bouger d’un pouce concluent la première série, puis des derechazos rythmés et longs, très denses ; une série gauchère d’où se détache une naturelle avant un pecho libérateur ; autre série avec changement de main et circulaire face au toro dont la tête joue les encensoirs, puis la faena se prolonge en sombrant dans un toreo plus vulgaire, circulaires et manoletinas sans grâce, qu’une épée fulminante interrompt heureusement.
Le 4, aux armures très hautes, marque quelques signes de faiblesse mais se reprend durant la faena après avoir sévèrement bousculé le torero, contraint de se défaire de sa chaquetilla et qui revient, un peu groggy, en bras de chemise. La série de reprise, en musique, sera saisissante, puis le torero, un peu défait, se le met dessus puis le fait passer mais sans peser. C’est le toro qui gagne le combat, difficile à la mort, la tête, toujours haute, encore très mobile. Une entière valeureuse mais basse et le torero fait la vuelta, que son trasteo ne méritait pas.
Le 6, d’un joli trapio, un toro de Séville, offrira le meilleur pour Ruben Pinar, avide de succès, qui ojedise avec talent, dans une faena de séries courtes, de grand empaque, avec circulaires, changement de main, inversées, tres en uno, le tout d’une belle puissance, dans un terrain réduit à l’extrême, sûr de lui et dominateur. Magnifique épée et sans doute des trophées, mais je ne m’en souviens plus.
Je me souviens en revanche de Cesar Jimenez sur le 5, un castano claro, bien armé, véloce et de belle allure. Ce toro sera préservé à la pique mais viendra de vingt mètres prendre la seconde comme un brave. De faena, il sera cité une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de trente mètres, et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il viendra, plein d’entrain, s’engouffrer dans la muleta de Cesar. Toro de grand jeu et de très grand moral mais manquant de force. Là était le problème. Cité de si loin, son moral le tient et le pousse à parcourir chaque fois le tiers de l’arène, mais le toro arrive décomposé dans la muleta, comme un sprinter sur la ligne d’arrivée. Mais pour le sprinter, à la ligne d’arrivée, c’en est fini, alors que pour le toro, dans la muleta, tout commence. En voulant mettre en valeur les qualités d’alegria de son adversaire, Cesar s’est privé de ce faire-valoir. Il ne parvient pas à lier deux muletazos et se trouve systématiquement contraint de reculer de quelques pas entre les passes.
Alors, il restera le souvenir de ce toro joueur qui traverse l’arène et d’un torero affecté, ce jour dans un habit rose palais-de-Saint-Petersbourg/ meringue, à la chaquetilla courte qui souligne davantage encore une cambrure, très chute de reins de Carla Bruni à Shangaï, qui le prive de tout naturel.
Oui, un toro et un torero, et jamais les deux ensemble.
Même quand Cesar, pour l’entame de sa faena, s’agenouille au centre exact de l’arène pour citer le fauve, à cet instant sous la présidence, avec un courage et un aguante inouïs, et l’attend de si loin pour lui servir quatre derechazos et le pecho dans cette position.
Non décidément, cette mise recherchée et ces couleurs de macaron tiennent l’émotion taurine à distance. Même quand Cesar Jimenez se jette entre les cornes pour tuer d’une belle épée. Vuelta au toro et une oreille un peu froide au torero.
Nîmes, 23 mai matin, mano a mano Condé-Morante /Juan Pedro Domecq
Spectacle attendu, tant nous avions oublié le précédent mano a mano de ces deux- là, servi il y a plus de quatre ans, un 18 septembre, par une matinée ensoleillée où l’arène, debout, s’était au final égosillée d’indignation en jurant qu’on ne l‘y reprendrait plus. Le temps de fabriquer un toro (quatre ans et demi) et nous y revoilà. L’arène est pleine !
Le soleil est dru et les ombres poudreuses sur le ruedo. Les toreros en habit de gala, Javier Condé en Christian Lacroix aux complications d’Arlequin, Morante de la Puebla dans un somptueux velours grenat aux parements noirs, genre Camp du Drap d’Or.
Le soleil tape et nous engourdit. Condé par terre, bousculé entre les pattes de son petit toro, et qui ne se remettra pas d’une telle frayeur, Morante joliment expressif face à une chose douce, notamment dans des chicuelinas aux mains basses, puis sans intérêt face à une chose boiteuse.
Six toros au soleil, c’est presque trop.
Et puis vint le sixième, bien joli, bien noir, bien noble et un peu moins faible que les précédents. Morante le conduit des barrières jusqu’au centre de l’arène avec une voluptueuse décision à la véronique, puis au cheval par chicuelinas et larga. L’allure du torero, le mouvement de la cape, dans cette torpeur soudain une brise.
Un peu d’agitation dans le calleron, comme des bougies d’anniversaire qu’on allume en cuisine. Le bras du torero qui se tend au-dessus de la barrière et…. une chaise qui apparaît. Oui, une chaise, une petite chaise Napoléon III, en bois blanc et velours garance, dont le torero s’empare, qu’il place sur la piste où rode le toro, et sur laquelle il s’assoit. Et il fallait le voir y prendre place, le dos bien droit, les jambes écartées, les bras détendus, comme pour faire conversation dans un tablao, ou, guitariste, accorder son instrument. Souriant de son bon tour, heureux de la mise en scène et sûr des images qu’elle charrie. Et elle en charrie des images, cette chaise. La suerte bien sûr du divin chauve et autres frères Gallo, des eaux-fortes de Goya, des voyages en Espagne de Théophile Gautier, mais aussi toutes les solitudes de bodegon où jaillit soudain la lueur d’une présence flamenca, inattendue et gratuite.
Morante, assis, déploie la muleta dans des rumeurs de foule, cite son adversaire et dessine à son passage deux aidées par le haut. Le toro serre, contraignant l’homme à se lever. Molinete libérateur mais la chaise est renversée. On croit que la part de rêve s’achève mais le songe ne fait que commencer. Le corps est détendu au centre de toutes choses et la main suave ralentit la charge de la bête jusqu’à nous faire douter de toute raison ; dessinée, vaporeuse, brève, et comme arrêtée, la passe aimante si parfaitement l’animal que le torero en sourit. Puis, alors que nous sommes suspendus aux recommencements d’un tel don de soi, Morante décide d’interrompre, comme pour se jouer de nous, avant de reprendre dans des soupirs d’aise à quoi s’abandonne désormais le gradin, irradié de duende.
Tant d’orfèvrerie savante et variée nous en ferait oublier la chaise.
C’est que pulvérisée par un coup de corne, un péon maniaque était venu en ramasser les débris, ce que voyant, quelques instants plus tard, le maestro avait protesté : « Où est la chaise ? Rapportez-moi ma chaise ! » Le péon s’exécute, à la manière d’un péon, enfin comme nous l’aurions fait vous ou moi, en rapportant une chaise neuve et en la posant à l’endroit même où se trouvait l’autre. Croyez-vous le maestro satisfait ? Nullement ! Ce torero est un artiste, Madame ! Alors, tout en toréant, il se rapproche de la chaise et d’un souffle de muleta, subrepticement, la renverse, les quatre pieds en l’air, comme un élément de décor qui n’aurait jamais dû disparaître de la scène, avant de poursuivre sa faena.
Morante va chercher l’épée, et foudroie le tio avec une énergie qu’on lui connaît peu. Il tourne le dos à son adversaire, s’empare de la chaise, l’éloigne un peu de l‘agonie et s’y assoit, attendant son heure. Le toro le voit, approche à petits pas, tend le mufle à hauteur de genoux. Les cornes balancent en encensoir, mais c’est la fin. L’homme ne bouge pas ; la bête s’effondre comme on rend grâce.
Deux oreilles et la queue pour cette geste.
Pour cette chaise de début de faena, de risque et de défi. Pour cette suerte tombée en désuétude, et soudain exhumée, comme on rend hommage à une lignée. Pour cette faena de duende pur qui a ralenti le temps à ce point que les gloires du passé devenaient nos voisins, Gautier en gilet rouge, le vieil Hugo, Mérimée non loin, ceux-là mêlant leurs regards aux nôtres dans une communion étonnée et fervente. Pour cette faena de haute littérature, intemporelle et romantique. Pour tout ceci en jour possible d’une vie d’aficion, qui nous rend à la fois plus léger et plus dense : Olé Maestro !