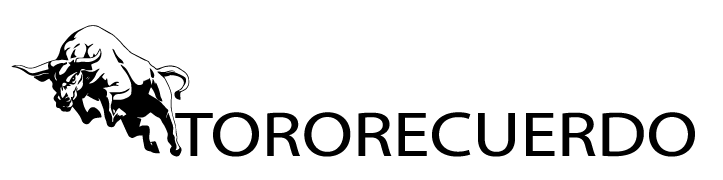Paris, le Prado, 17, 18 et 19 avril 2010, Eyjafjallajokull, seul contre tous,
Eyjafjallajokull n’est pas torero mais il ne craint rien d’un seul contre tous. C’est ce fichu volcan islandais à la montera de glace qui a répandu ses désillusions de cendres d’une chicuelina dominatrice mais sans remate, nous laisssant errer seuls sans projets durant deux jours. Notre vol est annulé, et nous voici contraints de rejoindre Séville…en train. Tout est complet d’ici lundi. Ce sera donc Paris- Bordeaux, puis Bordeaux- Hendaye, puis Irun-Madrid, soit un voyage de 15 heures. Un pot à Chueca, une nuit en pension près d’Atocha. Si tout va bien nous serons à Séville ce mardi 20. Nous sommes privés de trois corridas, réservées en vain, et spécialement de Morante, deux fois, Cayetano et Aparicio que nous ne verrons pas à Séville cette année. Où faudrait-il donc les voir? La retransmission hier soir au Prado a laissé voir un Talavante savoureux et le majestueux capote de Luque avant que le spectacle ne soit brutalement interrompu par un match de foot où le Barça était à l’oeuvre. Cette année Séville commence mal!
Séville, mardi 20 avril, Juli, Manzanares, Luque-Torrealta
Chronique dédiée à Conchita et Gracia, et au joueur de guitare, cantaor de chez Soco qui nous tirait des larmes
Il ne faudrait pas rencontrer les toreros hors de l’arène. Pas plus que prendre le thé avec un écrivain. L’oeuvre encombre. Et tenter de deviner l’homme sous l’artiste est un exercice vain et au fond pas très loyal. Un jeu d’espions ayant travaillé sur fiches avant de croiser, incognito, leur cible.
Ce soir, ou plutôt au grand matin, Juli et Manzanares sont passés chez Soco. Nous y étions. Soco est la fille du torero et ganadero Manolo Gonzales. Elle fait les tenancières de café branché à Séville, où le mundillo chic se précipite, avec son bagage de jetsetters que l’on exhibe comme d’autres les décorations, mi-condescendants mi-déférents devant la demi-naine à tête de toro qui danse la sévillane à hauteur de ceinture mais avec arte y sentimiento.
Juli a tout d’un gosse, un regard de gosse, un sourire de gosse, une allure de gosse. Un peu endimanché, dans une veste trop large, mal assortie au pantalon. Avenant et chaleureux, se réjouissant de tout, allant de groupe en groupe recueillir el piropo, se laissant prendre en photo sans impatience, on ne reconnaît pas du tout le torero puissant et dominateur qui ne se laisse jamais surprendre par ses adversaires quand ces derniers sont des bêtes.
Il a encore triomphé ce jour. Très applaudi après le paseo, le public voulant le remercier de cette Porte du Prince ouverte trois jours auparavant, il s’est montré professionnel face à son premier, très viril dans un remate avant la pique, tirant deux séries à droite plus que propres, encouragé par les « bien » de Séville à chacune de ses passes. Deux très belles séries à gauche, avant que d’être avisé. Il reprend la main droite mais le toro, qui n’humilie guère, s’avise. 2/3 d’épée et des applaudissements chaleureux, sans excès.
Son triomphe sera sur le quatre, un toro assez vilain, bas et lourd, poussant à la pique mais jouant de la tête et que Juli offre à une Maestranza, soudain exaltée par cette bonne manière. Une faena puissante devant un adversaire qui transmet beaucoup et ne paraît pas se lasser de la muleta. Rythme, liaison, puissance et aguante quand par deux fois le toro s’arrête dans la passe et que, sans bouger, Le Juli toque la muleta, manda à mort et tire la charge interminablement. Il baisse la main à gauche, raccourcit les séries quand il le faut, reprend le toro à droite, réduit le terrain pour une série de derechazos de grande aisance. La dernière s’illumine d’un changement de main, lié à deux naturelles qu’un pecho conclut jusqu’au Guadalquivir.
Quand Juli prend l’épée, c’est la sidération d’un tel savoir-faire, d’un tel empaque comme l’on dit ici, qui domine, puis, après l’épée, deux oreilles qui tombent et la Maestranza tout entière qui salue le maestro aux cris de « torero/torero ». Vuelta fêtée mais sans façon. Comme l’on applaudit un madrilène à Séville. On ne ménage pas sa peine mais on n’y met guère de cœur.
Et chez Soco, ce soir, El Juli était un enfant, ravi mais un peu gauche dans ce costume trop grand, dansant la Sévillane avec la maîtresse des lieux, comme il l’aurait fait avec toute autre. Parce qu’il faut bien danser et que c’est toujours un plaisir. Où serait le problème ?
Manzanares chez Soco, dans un impeccable costume bleu de belle étoffe, chemise blanche, cravate rouge, les manches retroussées jusqu’aux coudes parce qu’on est jeune, paraissait exhiber sans plaisir cette beauté qui l’encombre. Un visage de sculpture romaine qu’une ligne de nez adoucit, des lèvres pulpeuses et deux fentes, comme des cicatrices indiennes, d’où s’échappe un filet de regard, couleur miel mais dur comme une lame. Un peu inexpressif. Nerveux, parlant peu, s’asseyant à une table entouré de sa bande qui respecte son silence et ne lui parle pas plus, il est comme échoué là par erreur. Aussi mal qu’il le serait ailleurs. Il se lèvera passer quelques coups de fil, boira un Red Bull au bar où nul ne l’approche. S’en dégage une impression de sauvagerie indomptée et de douleur secrète qui jure avec sa mise à la mode. Un air de Marlon Brando qui émeut et épouvante.
Avec son premier qui se défend, réservé et manso, Manzanares mettra du temps à s’accomplir et c’est au dernier tiers que la faena devient soudain impressionnante. Trois séries énormes qui font soupirer Séville de plaisir (ah! enfin ! se dit la patiente Maestranza). Il avance la main, puis la baisse, conduit interminablement la charge désormais domptée de la bête, en l’agrémentant de gestes inspirés de grand style, trincherilla, molinete combiné à un changement de main et au pecho. Une demi-épée et une oreille, des petites de Séville, mais c’est toujours bon à prendre.
Il surprendra surtout sur le 5, qui entre en piste en rodant, s’arrête, observe et ne bouge plus. Manzanares, las de sa cuadrilla, va au centre tenter de déloger son adversaire de sa querencia, le cite, parvient à lui donner confiance, puis tire trois véroniques et une larga, appuyées plus que belles.
Le toro se révèle puissant et violent aux piques mais manso, échappant d’une ruade au châtiment par quatre fois. Le tercio de banderilles confirme le comportement du tio, parado et violent.
Le maestro, un genou en terre, lui sert des doblones, mais le toro l’avise méchamment au troisième. Manzanares, muy valiente, ne perd pas les papiers et dessine une série courte de deux derechazos liés au pecho où le toro, encore, le regarde. La musique qui retentit – un paso extravagant avec des basculements de comédie musicale à la Brodway- accompagne les séries suivantes, puissantes de toute l’âpre caste du toro, qui sont livrées de verdad par une tête bien faite et un homme qui a le souci du juste placement. La faena baisse cependant un peu à gauche où le toro passe mal avant que Manzanares ne le reprenne à droite, mais hésitant alors à avancer la main et à tirer la passe, jugeant sans doute suffisant ce qu’il avait accompli devant ce manso con caste y genio.
Malgré la surprise d’un tel engagement et d’un bel aguante, une impression d’inachèvement gagne, qu’une épée fulminante cependant dissipe. Le toro meurt en livrant un ultime combat bien dans sa manière : couché une épée dans le corps, il donne un vicieux coup de corne au visage du péon qui s’approchait pour le puntiller. Luis Blasquez recule soudain, les mains sur la joue gauche ensanglantée. Manzanares accourt vers lui, comme vers un jeune frère dans le malheur, plus soucieux de son compagnon que de son triomphe. Cette frayeur et cette sollicitude sont belles à voir. Le peon est transporté à l’infirmerie par ses collègues et El Juli, venu en renfort.
Ce dernier signe de sauvagerie donne sa dimension au travail du torero face à cet adversaire dangereux qui, ici, sera sifflé à l’arrastre. Une grosse oreille pour le maestro et une vuelta très fêtée, finie au centre, qui ne déride pas José Marie.
Chez Soco, il ne paraît pas triste ; plutôt absent. Absent à lui-même, et absent aux autres. Comme retiré d’un monde dont il est une pourtant une effigie et un symbole. Un people, et néanmoins artiste de grande caste qui a déclaré, après la corrida : « Après ce que venait de faire Le Juli, je ne pouvais pas rester derrière », ajoutant ceci, en allusion à la hernie discale dont il souffre et qui nécessite une intervention chirurgicale, différée pour cause de féria de Séville : « Je souhaitais que les gens restent sur une bonne impression parce que je ne sais pas quand je pourrais toréer à nouveau ». Que desgracia ! Y olé al torero !
Luque héritera du lot le plus faible, servant une trincherilla et une passe du mépris de grande douceur à son premier, pour le reste toréé dans l’indifférence, et quelques véroniques vaporeuses à son second, avant d’échouer par défaut de placement à la muleta, ayant cependant distillé un derechazo templissime et isolé. La discrétion à Séville de ce jeune torero si imprudemment attendu partout ailleurs après une belle saison l’an passé est mauvais signe pour la temporada.
Ce soir, Daniel Luque n’est pas venu chez Soco…
Séville, mercredi 21 avril, Ponce, El Cid, Talavante- Puerto y Ventana de San Lorenzo
Toros faibles dans l’ensemble et fuyards vers les tablas au deuxième tiers de muleta mais, si l’on veut bien y regarder de plus près, poussant avec puissance au cheval (en dépit d’une faiblesse des antérieurs) –les 1, 2 et 5- et récupérant du jeu aux banderilles. Le 5 très noble et transmettant beaucoup.
« Perdre le sitio », pour un torero, c’est comme pour nous autres, frères humains, perdre la main. On ne sait trop pourquoi, lassitude, faiblesse, dépression ou préoccupations diverses, mais ce qui était possible ne l’est plus. On le sent, ça se voit, et on n’y peut pas grand-chose tant que l’on n’en sait pas la cause. Les toreros vont-ils en psy ? Je ne sais. Mais ce qui est sûr, et triste, c’est que le Cid a perdu le sitio, comme il peut arriver à chacun de nous de perdre la main.
Le Cid a eu le meilleur lot et quand il cite son premier de vingt mètres, comme naguère – il y a à peine trois ans, et cela paraît « jadis »- , on se met à espérer. Le toro s’engouffre à grand galop, puis viennent deux passes mouvementées, trop mouvementées. Une autre série est tentée de la même eau, Le Cid joliment supendu sur la pointe du pied, la jambe tendue à l’arrière, trois derechazos y pecho, où le toro n’est pas plus dominé. Une autre encore, suivie d’un changement de main avec deux naturelles templées mais lointaines, trop lointaines. Le toro, insuffisamment tenu, fuit vers las tablas où le Cid le rejoint, tentant… deux circulaires inversées d’un effet désastreux. Silence poli de la Maestranza, qui sait pour le sitio et pour le père du torero qui, à cet instant, lutte contre la mort.
Le 5 qui lui échoit est le meilleur, brave à la pique (quoique justement économisé à la seconde), noble, et encasté . Le Cid le cite de loin, la main basse et dessine ce que l’on attend de lui. Mais il paraît vite débordé, ne parvient pas à ralentir la charge ni à dominer la puissance de son adversaire. La musique qui avait commencé à jouer, comme on rend grâce à un toro allègre, cesse après la série gauchère d’où ne se détache qu’une belle naturelle, celle de naguère -c’est-à-dire de jadis, on le sent bien. Beau geste à l’épée, pétition d’oreille qui ne tombe pas. Sous la sollicitation d’une Maestranza, lucide mais affectueuse, et celle, plus pressante, de ses peones, Le Cid donne une vuelta triste, les yeux dans le vide, une vuelta de grand deuil.
Ponce n’aura pas vu son lot, les deux toros qui lui étaient destinés ayant été changés pour faiblesse dès leur entrée en piste. Les toros de remplacement seront de peu de jeu, le premier sortant faible, le second – un Toros de Plata- haut de plafond, au port altier et des bois de cerf à faire hurler de peur. Le piquero José Palomares lui fera un sort dans un trasteo sûr et puissant (le toro ira quatre ou cinq fois aux piques, y compris de réserve, sans grâce, avec violence et grande mansedumbre, mais chaque fois parfaitement tenu) puis le toro jetera la panique lors du tercio de banderilles, cependant bien exécuté. Ponce le tient dans des doblones un genou en terre, lui sert une série impressionnante de dominio y temple, puis le toro fuit aux barrières où il se défend, ne laissant que peu de recours au maestro, cette fois-ci en échec. Mais le pire est à venir au moment de l’épée. Une tête haute, mobile et non dominée. Un torero sur la pointe des pieds et qui paraît avoir peur de se jeter dans les cornes – il y a de quoi !- et qui échoue lamentablement, une fois, deux fois, trois fois, en colère contre lui-même, et le public le sifflant avec cruauté.
Talavante aura des gestes sur son premier, qu’il cite du centre, la main basse, très relâché, dans un torero aéré mais impuissant à éviter la querencia aux tablas qui s’annonce. Le toro y va, le torero le suit et tente une exercice baroque et un peu imbécile où il parait toréer la barrière dans laquelle son adversaire s’est fiché. Manoletinas, un tiers d’épée, saluts aux tablas. Le dernier, plus fuyard encore, ne permet rien de mieux et, en effet, ce sera pire.
Il aura plu tout au long de la corrida, de grosses averses, certaines de grande caste, où l’on sort régulièrement le parapluie et les impers, regardant le spectacle à travers des obstacles divers (manchons et capuches de couleurs acidulées, parapluies noirs ) en tentant d’éviter les gouttières, l’eau un temps retenue se déversant dans le dos, sur les jambes, ou dans les chaussettes. La pluie cesse un instant, on referme alors le parapluie ou on se défait de son imperméable, avec plus ou moins de bonheur selon son tempérament, sa délicatesse et son savoir-faire. Chacun s’accomode comme il le peut de la situation, sans broncher ni rechigner, convaincu que ses voisins de devant, de derrière et d’à côté font le maximum pour ne pas lui gâcher davantage la vie.
Grande classe de la Maestranza qui, sous la pluie, fait comme si de rien n’était. Mais que les clarines fassent un couac au changement de tiers, alors, même sous cette pluie, c’est l’émeute ! C’est ainsi : on supporte le destin avec aguante, mais une faute de goût dans l’exécution du rite déclenche des foudres.
Aujourd’hui, les clarines auront déçu. Ah Séville !
Séville, jeudi 22 avril, Curro Diaz, Matias Tejela, Ruben Pinar- Alcurrucen
Le Serranito est le bar à tapas le plus proche des arènes. Il n’y a, là-bas, ni prince ni roturier, quelquefois un mystérieux chauffeur abyssin, et toujours d’aimables conversations de la colonie française à Séville, sortie des arènes. On y échange impressions de la tarde et, s’il se peut, quelques adresses. Mon compagon de bar de ce soir a trouvé Pinar vulgaire sur son premier et mauvais sur le dernier, dont il aurait accentué les défauts. Ce compagnon est assurément aficionado a los toros, mais il est à craindre qu’il ne manque, quelquefois, de jugement.
La corrida d’Alcurrucen est sortie rousse – sauf le premier- mauvaise, mansa, et décastée, seul le troisième donnant du jeu et transmettant beaucoup à droite.
Le cartel, faible, n’avait pas rempli les arènes en dépit du soleil revenu à 18h30. Alors, pour ne pas se lasser de toreros dépouvus de recours face à une tel cheptel, on regarde les toros et la brega des peones. Et la corrida passe sans ennui.
La brega c’est d’abord Montoliu. Son père, banderillero comme lui-même, est mort dans l’arène, à Séville, un premier mai, terrassé par la corne de son poursuivant qui l’a frappé, dans le dos, en plein cœur. Sa mort en piste a jeté une désolation durable. José Manuel est son fils. Que croyez-vous qu’il devint ? Banderillero ! Ce jour au service de Curro Diaz. Et ce jour, le fils, comme le faisait le père, se pose face au toro, dissimulant les banderilles dans le dos, marche à petit pas, comme s’il voulait faire un mauvais coup, puis, au dernier moment s’élance vers la bête, marque une torsion de la taille pour le citer, l’autre vient, le torero lève les bras, cloue les bâtons dans le berceau, se dégage en courant puis freine aussitôt sa course, finissant comme il a commencé, à petits pas, rejoignant le burladero dans un geste plein de toreria et de morgue, ne méprisant nullement son adversaire, mais le danger. La Maestranza, émue autant qu’émerveillée par cette citation dynastique, applaudit à tout rompre et fait saluer le banderillero.
Au troisième, laid, bas et lourd, qui dès sa sortie en piste se tanque au centre et que Ruben Pinar devra déloger, violent, manso, courant en tout sens, n’accordant qu’une attention discrète aux sollicitations des uns et des autres, voyant le piquero, hésitant, fuyant, puis, comme se ravisant, venant se ficher le morillo sous la pique en se haussant du col, avant de s’en aller errer ailleurs, sous les protestations du public qui frappe dans ses mains l’air des lampions pour marquer son désappointement face à un tel comportement erratique, c’est le peon de brega qui délivre son enseignement de lidia, l’aveuglant de la cape pour lui éviter de prendre la fuite, et le fixant par des remates impeccables pour le tercio de banderilles où le toro, tout à coup, s’emploie, suivant les hommes jusqu’à la barrière. Ce peon a pour nom Juan Rivera. Et il m’enchante.
Au dernier, qui saute comme une chèvre folle dans la cape et de beaucoup de genio, c’est Manuel Montoya qui s’emploie à la brega et le piquero surtout, Agustin Moreno, qui tient le toro sauteur sous toute la puissance virile, sûre et adpatée de sa pique, dans un tercio de belle violence et de grande décision, comme on n’en voit pas dix dans l’année.
Et les toreros, alors ? Eh bien, je vous dirai qu’à leur passage calle Iris, avant la corrida, Tejela était très détendu, Ruben Pinar, très concentré, et Curro Diaz entre deux eaux. Et leur état d’esprit disait beaucoup.
Matias, jeune homme sympathique qui aime l’habit de lumières plus que les toros, n’a pas forcé devant un violent qui donnnait des coups de tête imprévisibles, et regardait l’homme aussi souvent que l’autre lui en offrait l’opportunité. Précautionneux, puis lointain, puis sans recours, ne sachant que faire de ce tio, il abrège en silence. Son second sera encore pire, levant très haut la tête en cours de passe, n’humiliant jamais et se jetant même par deux fois sur l’homme, comme s’il cherchait à toucher au visage. Ajoutons que ce toro se nommait Bandurrio (« mandoline ») et ressemblait –berrendo en colorao– à une vache laitière, et vous comprendrez qu’on n’en veuille guère à Matias qui, comme tant d’autres à sa place, a échoué à toréer quelque chose qui n’était pas un toro.
Curro Diaz n’est guère plus lidiador, mais son matériel, noblote le premier, laissait espérer quelques gestes. Ces gestes, il les accomplit, avec suavité – « pinturero » dirait E.- mais sans liant, ni avancer la main, comme il le faudrait en reprenant aussitôt la passe sans rompre. Quelques derechazos, la main basse, tire des « biens » que la Maestranza soupire, comme à regret, désappointée par tant d’indolence. Le quatrième est le plus fuyard, pousse à la pique par connerie plus que par bravoure. C’est un manso de catégorie auquel Curro Diaz sert une entame élégantissime par passes par le bas supérieures, puis changement de main et trinchera de saveur. C’est tout, avant un toreo sur le voyage, sans rythme ni liaison, dans un silence poli, vaguement accablé, très cour d’Angleterre.
Ruben Pinar, en revanche, défend bec et ongles son jeune cartel, en tirant deux séries de derechazos longuissimes où le toro s’emploie avant soudain de s’arrêter en cours de course, soucieux du visage de qui le domine à ce point. Le jeune Ruben ne se démonte pas, avance la main et étire le bras, allongeant incompréhensiblement la passe, avant de la prolonger encore d’un changement de main du plus bel effet. La série de naturelles sera puissante, le toro comme aimanté par la muleta, et c’est de la gauche dans des redondos interminables et de grande puissance qu’il achève le trasteo, avant de se jeter en hurlant dans les cornes du fauve. Hélas, une pluie de descabellos le privera d’oreille et Ruben, un peu vaniteux, croira devoir faire une vuelta, ici jugée d’assez mauvais goût compte tenu du désastre à la mort.
Le 6 sort manso, avec genio et sans une passe. Ruben lui tend la muleta sous le muffle, lequel est très haut, et dessine des passes qui n’en sont pas plus que son toro n’est de combat. Mais enfin, cette dangereuse chèvre folle tourne un peu aux côtés de la muleta et finit, non par humilier, mais par baisser la tête de quelques centimètres. Ruben croyant y voir le résultat de ses efforts, s’en exhalte et poursuit, avec une insolence de jeune homme, croyant pourvoir améliorer une chose brute, de 550 kgs et qui portait le joli nom de « Pianista », lequel était inapte au combat, à l’arène, et à l’amélioration. Quoiqu’en pense mon compagnon du Serranito…
Séville, samedi 23 avril, mano a mano Perrrera, Luque- Fuente Ymbro
On vous dira que la corrida est sortie faible et de peu de jeu. C’est faux. Elle est sortie faible pour une part mais offrant du jeu pour l’autre. Le quatrième était en efftet faiblissime, le cinquième a dû être changé et le sixième aurait pu l’être. Mais le public avait compris qu’il n’y avait rien à attendre de ces deux toreros ce jour et, lassé, souhaitait qu’on en finisse. Restaient donc le 1, pas un foudre de guerre mais noblote, le 2, soso qui répétait, et surtout le 3, de grandes noblesse et embestida, et le 5, entré en remplacement, encasté. Soit quatre toros pour les vedettes.
Perera en dépit d’un magnifique habit couleur vert pomme, à l’inspiration couvre-chef de reine-mère, n’est plus que l’ombre de lui-même. Son premier, très bien présenté, à larges cornes, certes faible mais s’employant aux banderilles face à un Julio Gutierrez supérieur, aurait pu servir. Mais rien n’allait. Dès les passes d’entame, par le bas et sans bouger, Perera se fait bousculer. Le torero qui aurait jadis fait son affaire d’un tel adversaire, dessinera quatre passes templées au milieu d’une marée d’enganchones qui signait la mauvaise distance et le manque de sitio. Perera, parallèle, n’a rien dominé et paraît avoir perdu ses trois armes préciseuses des années précendentes, le sitio, la distance et le poder. Il ne reste plus rien. Et c’est un torero sifflé en cours de faena (à Séville pourtant si patiente…) face à deux toros applaudis à l’arrastre – le 3, noble, qui fait l’avion dans la muleta, transmettant beaucoup et le 5, plus encasté mais de longue charge- qui se donne à voir, avec de temps en temps un éclair du charme de jadis – deux cambios por espaladas au centre, puis une série droitière et templée sur le 3- qui avive le regret de cette baisse de forme. Sur le 5, il sera en échec complet, trop précautionneux après avoir été avisé, ne pesant pas sur l’ouvrage, apathique face à l’embestida de son adversaire, soit un toro sauvage mais non sans noblesse.
Luque s’en sort un peu moins mal, compte tenu de la faiblesse de son lot en manière d’excuse. Très sûr à la véronique de réception, une passe de muleta – une !- tres templée sur le 2, rien sur le 4, protesté en vain par le public, et un grand capote sur le 6, faiblissime mais que le public a renoncé à faire changer, compte tenu du moral des troupes, eux et nous !
C’est sur cette si terne tarde que nous achevons ce cycle sévillan, écourté par le volcan, où Juli a incontestablement dominé, Manzanares et Morante ayant démontré des dispositions nouvelles face à des adversaires à lidier et une envie de triomphe belle à voir. Restent les « mises à jour » et actualisations diverses des enseignements de la temporada passée. Le Cid toujours dans le bache, Perera pas loin, Luque deslucido en ce début de temporada et Ponce que la chance paraît fuir désormais. Et deux cruelles nouvelles, pour eux et pour nous : Manzanares indisponible du fait de son hernie et cette cornadada de José Tomas, si grave, si lointaine, si prévisible et qui nous laisse orphelins d’autres leçons de gran toreo, avec un goût de sel dans la bouche. Suerte maestro !