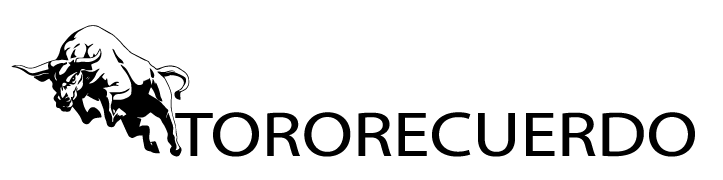Les goyesques, c’est quelque chose, et à Arles c’est toujours plus goyesque qu’ailleurs. La goyesque, c’est la corrida en costume, en habits d’autrefois. Une corrida qui s’endimanche, comme nos anciens quand ils allaient à l’église ou au temple, ressortant le costume et la chemise amidonnée ou le beau chandail et le cardigan de Noël. Le problème, avec la corrida, c’est qu’elle est ordinairement en habit de lumières, une tenue somptueuse qui brille au soleil, celle des pantins en paillettes de la chanson de Francis Cabrel. Alors, pour faire contraste, dans une goyesque, les toreros paraissent dans l’arène comme on le faisait au XIXème. C’est très sympathique mais esthétiquement discutable : c’est un peu une corrida en pyjama, aux allures de carnaval. Des habits de Pierrot et Colombine ou de comedia del arte, avec de grandes capes qui pendouillent le long du corps (celle de Pablo Aguado, grenat mordoré était tout de même de grande beauté) et des couvre-chefs ridicules en croissant de lune tout raplapla ou, comme Morante ce jour, de vraies monteras du temps, hyper-chichiteuses, en oreilles de Mickey, retenues par une jugulaire de soie noire. Mais la Goyesque émeut tout de même en exhibant, sans frémir, la tradition en quoi elle tient tout entière. Après la cérémonie de proclamation du roi d’Angleterre, ce jour, ça fait beaucoup. Mais, quand l’avenir est à ce point incertain, on chérit sans doute la légende des siècles.
A Arles, pour la goyesque, où on se soucie tout de même de ne pas devenir un Puy-du-fou de la tauromachie, on fait appel à un artiste pour décorer le ruedo. Cette année, ce fut la touche flashy de Belin, un plasticien espagnol, qui a donné un coup de jeune et de street art au ruedo ; cela faisait une moyenne.
Les corridas goyesques ne sont pas meilleures que les autres. Elles sont différentes, ce qui suffit désormais à remplir une arène et c’est tant mieux.
Pour le reste, les Garcigrande étaient de trapio et de présentation à la nîmois (le premier brocho et le deuxième terriblement anovillado- Arles baisse un peu…) , mais quelques uns de belle mobilité (le deuxième, le troisième, le cinquième) et bravotes (le deux et le trois). Le tercio de piques, escamoté ou navrant- piques dans le dos ou trop puissantes dès que le toro pousse un peu- nous a gâché le spectacle et aujourdhui deux toros…. Dommage.
Pablo Aguado est passé à côté de sa corrida, il a gaspillé son premier adversaire, peut-être le meilleur du lot, qu’il a étouffé tout de suite, et n’a rien pu faire de son second, en dépit d’une bonne volonté à contre-style (réception par une larga afarolada à genoux, puis quelques passes autoritaires en début de faena). Seules ses chicuelinas marchées et une demi- véronique qui pèse pour la mise en suerte à la seconde pique méritent d’être mises à son actif.
Talavante a irradié, une fois encore à Arles, de sa personnalité singulière. Sa réception à la cape sur un petit toro, très mobile, joueur, et d’une grande noblesse, était toute de temple, de relâchement et de grâce altière, comme la première série à la faena, un genou en terre, de grand cachet. Mais, loin de profiter de la longue charge de son adversaire -qui l’était si peu-, il a toréé « facile » et sans charme, sauf le temple. C’était joli, cela portait beaucoup sur le public, mais c’était surtout (lointain et) anodin. Terriblement sucré. On se croyait dans une arène, on était dans un salon de thé. Les problèmes à l’épée l’ont privé des oreilles qui auraient récompensé cette faena de peu.
Il a été beaucoup plus sérieux et surtout beaucoup plus dense sur son second toro, dans une faena de grand contenu, qui a commencé à genoux. Talavante torée, pèse sur son adversaire, prolonge par un changement demain avant le pecho- toujours à genoux- de grande beauté. Une fois debout, il sert, de main gauche, des naturelles aérées, le corps bien droit, le poignet télescopique, puis une ou deux séries de main droite, le corps relâché, la main très basse. C’est très beau. Il revient à gauche, les pieds joints, puis enchaîne, dans une série interminable, des luquesinas de feu – bien supérieures à celles de Luque- sans jamais rompre ni reculer- la verticalité gorgée d’aguante et de toreria. Epée fulminante qui tue le toro sans puntilla. Talavante, ravi, a une fois encore triomphé à Arles et marche vers la talanquera avec des allures de coq qu’on ne lui connaissait pas, un peu à la manière de Roca Rey. C’est irrésistible (deux oreilles).
Mais c’est Morante qui a fait la corrida. Un Morante inspiré, de fulgurances, ça lui tombe dessus et cela nos électrise. Déjà sur son premier, un peu fuyard, par les passes de réception qu’il commence comme des véroniques et qui se terminent en largas, la percale, tenue d’une seule main, allant au plus loin en donnant la sortie pour tenter de retenir le toro sans l’obliger trop. Puis dans une faena indistincte, où l’on sent le torero hésiter entre abréger tout de suite par des passes de châtiment ou se confier un peu pour voir si ça passe ou pas. On le voit distant et précautionneux et on croit que c’est fini, mais voilà soudain le torero qui nous sert un molinete gracieux, comme tombé du ciel dans le marasme, puis quelques naturelles, les pieds bien en terre. Cela n’ira pas plus loin. Mais cette indécision d’un torero qui se cherche et ces quelques ruptures d’une approche médiocre par des surgissements inexpliqués de toreo de verdad ou d’ornement étaient une mise en bouche pour le suivant.
Et le suivant : mazette ! Quelle récompense pour ceux qui ont la foi ou qui savent voir. Il y eut d’abord une réception à l’ancienne, un hommage vibrant aux corridas du temps de Goya. Une eau-forte. La cape, de face, tenue à deux mains, lancée horizontalement pour donner la sortie au toro à mi-hauteur, une fois, deux fois, puis accompagnée lors du troisième passage par une légère flexion du corps, dans un molinete de cape. C’est si inattendu, tellement exhumé des temps anciens, qu’on en oublie cet habit rose un peu barboteuse qui baille aux fesses et cette montera en oreilles de Mickey. Ce n’est plus une goyesque, c’est la corrida au temps de Goya. Le pittoresque se fait oublier, il ne reste que la vérité et l’authenticité du jeu qui s’achève en véroniques et en une demie, lente, décomposée, souveraine. Les passes de quite, après la première pique, ne seront pas des chicuelinas, mais autre chose : non plus le torero qui dessine une passe, mais le corps du torero, étiré en une figure du Greco, sur la pointe des pieds, enveloppé de sa cape, une flamme vive, une torche en feu. Et la demie qui remate, pas tout à fait une demie non plus : le corps accompagne ce qui commence comme une demie mais se termine en larga, la cape tenue d’une main, donnant la sortie au toro, comme Morante l’avait fait à la réception des deux mains. La boucle est bouclée, toreo d’hier et d’aujourd’hui. Une toreria comme un cours d’histoire. A rendre fou.
Et la faena, ou plus exactement la première moitié de faena, le toro, hélas, s’étant assez rapidement épuisé ensuite, fut une des choses les plus belles que j’ai vues de ce torero depuis longtemps. Assis sur l’estribo, les bras ballant, la muleta abandonnée par terre, le torero tout d’arrogante décontraction attend l’approche de son adversaire pour le citer sans broncher, une fois, deux fois, trois fois, s’amuser à le voir passer aussi docile, puis se levant pour donner deux trincheras d’une lenteur inouïe : on les voit, ces trincheras, se former comme une ridelle sur l’eau, puis se charger d’énergie, enlacer, comme une vague, le corps de la bête, et venir mourir aux pieds de l’homme, laissant le toro étourdi par le mirage. Une passe encore, puis une nouvelle trincherila, au geste plus décomposé s’il se peut, à l’exécution plus doucereuse et à l’effet plus vipérin. Une série de derechazos qu’un pecho templé suspend puis un bouquet de naturelles, égrenées, dessinées, très lentes que pontue un pecho quasi-circulaire, interminable. Trois aidées par le haut concluent le chef d’oeuvre, mais le toro alors ne veut plus jouer. Morante insiste pour remater mais rien n’y fait, le toro reste immobile. C’est bien un peu embarrassant, cette fin en queue de poisson. Peu importe à Morante : un KO est un KO, on n’a pas à s’excuser auprès de son adversaire ; et tel un Mohamed Ali, ange suspendu entre la grâce et le vulgaire, Morante, jamais à court d’extravagances, fait le geste de se frotter les zapatillas sur un paillasson à moins qu’il ne gratte le sol de ses sabots, tourne le dos à sa bête et s’en va à la talanquera. A menos ensuite par la faute du toro (saludos)
L’écriture rend mal compte de ce que Morante fut ce jour, du début à la fin : il fut l’inspiration torera à l’état pur, variété, originalité, citations de suertes anciennes, sens inouï de la lidia, temple et fantaisie, le tout comme sans forcer, sans rien solliciter. L’instrument d’un dessein qui ne serait ni programmé ni réfléchi, dont il ne serait pas l’auteur mais un personnage, choisi par les anges du toreo, qui nous ont fait oublier son drôle d’accoutrement du jour, pour nous laisser voir l’essence du toreo, en hommage à la lignée céleste des hommes de l’arène, depuis Goya. Morante n’a pas fait une goyesque. Il était goyesque. Olé torero !
NB/ A Nîmes, nous souffrons quelquefois des hurlements des anti hors de l’arène (mégaphones, cornes de brume) qui nous gâchent le spectacle. A Arles, l’horripilante pollution auditive est causée par nos sopranos sonorisées lorsqu’elles chantent durant les faenas. C’est proprement insupportable. De si belles voix devraient être réservées au paseo, aux intermèdes entre deux combats (arrastre, vueltas) et à la fin du spectacle. Rudy et la banda Chicuelo II feront le reste, seuls comme des grands. Et eux nous enchantent !