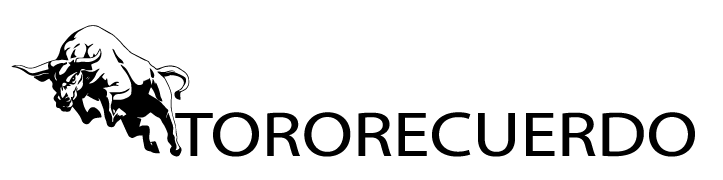ABÉCÉDAIRE
Joël Boyer
Abécédaire
Aimer un capote/Aparicio cara y cruz/Arènes d’Arles/Carreton/Castella/Céret/Curro Diaz/Denis Loré/Etre le torero du jour/Fernandez Meca/Javier Conde/Jose Tomas/Julien Lescarret et le Miura/Juan Jose Padilla/Las Ventas/Luis Francisco Espla/Manzanares Nuit/Manzanares que Voici/Marco Leal/Matias Tejela/Medhi Savalli/Montoliu de père en fils/Morante/Mort d’un taureau/Musique à Seville/Ola dans les arènes/Plaza de Antequera (l’écrin)/Plaza de Antequera (l’aficion)/Perdre le sitio/Ponce/Talavante/ Torero contre le temps qui passe/Torero gitan/ Le vieux peon/Vista Alegre
Pendant le tercio de banderilles sur le toro de Castella : Morante et Ponce, à leur poste dans le ruedo, prêts à faire le quite si les peones se trouvent en danger. Généralement, les maestros se tiennent immobiles pendant la brega du subalterne qui s’efforce de mettre le toro en suerte pour la pose des bâtons. Immobiles, la cape placée devant eux, attentifs à ce qui se passe. Immobiles par devoir, un simple geste inopportun pouvant distraire le toro et mettre à bas le délicat travail de brega, et par respect pour les peones qui oeuvrent. Voir Morante à cet instant : s’assurer de n’être pas vu du toro, et attendre que la bête lui tourne le dos, pour subrepticement déployer sa cape ….et dessiner deux véroniques de salon, et « j’ai le temps d’une troisième », une autre encore ; replier le capote, comme le voleur efface la trace de ses pas, puis, c’est trop fort, en lancer une quatrième qui meurt sur la sable pendant que les autres s’amusent….. Se reprendre, ramasser le tissu, le plier en accordéon par devant soi, se le coller le long du corps, incliner la tête pour voir ce que ça donne, « C’est pas ça ! », recommencer l’opération, « Là, c’est bien ! ». Avancer de quelques pas, la cape bien serrée sur soi. Y imprimer ses formes. Esquisser un sourire de contentement. « Que c’est bon ! » Puis poser les mains à mi-hauteur du tissu, exercer une pression de part et d’autre pour que la cape s’évase en éventail. « C’est top beau » doit se dire Morante à cet instant, indifférent à ce qui se passe à quelques mètres de lui. Et, n’y tenant plus, d’enfouir soudain le visage dans les replis de soie et de percale. La scène était étrange de ce torero qui, prenant sa cape par la taille et lui mordillant gentiment l’oreille, s’oubliait devant huit mille personnes. Morante glissait sur la corrida, tel un cygne piquant la tête dans l’eau sans laisser d’autre trace que le sillon lent de son cours majestueux.
Aparicio, cara y cruz
Une belle entière, un peu en avant, ne parvient pas à nous réveiller d’un tel songe et lui, Aparicio triomphateur, comme en proie aux ultimes secousses du duende, longe la barrière, comme le font les toros braves pour mourir, groggy par ce qu’il vient de réaliser, serrant les poings près de la tête, comme si cela faisait trop plaisir, ou trop mal, d’avoir été ce jour le jouet d’un destin favorable, un entremetteur d’art, comme il savait et nous savions qu’il l’était, depuis ses premiers pas de novillero à Nîmes il y a plus de vingt ans, par une matinée écrasée de soleil. Et qui ne nous sommes jamais lassés, ni lui ni nous, d’en attendre, sans impatience, une nouvelle preuve, sachant qu’elle serait alors étourdissante.
Une vuelta excessive al toro et deux oreilles, bien sûr, pour le torero qui entreprend une vuelta lente fêtée dans la ferveur du temps retrouvé – nous avions, chacun, vingt ans de moins-, après avoir ramassé une poignée de sable de la piste que normalement le torero pose sur le cœur et que lui met près de sa bouche, comme pour s’en barbouiller le visage en un geste de sacrifice et d’offrande, qui sonne comme un baptême au paganisme étrange. (Nîmes, 20 mai 2010, Nunez del Cuvillo)
Une autre scène devait se jouer ailleurs, le lendemain, dont la nouvelle s’est répandue ici comme trainée de poudre, lors du combat de Matias sur le troisième. Un malheur, un grand malheur. Aparicio blessé à Madrid sur son premier toro. Aparicio qui avait triomphé ici même la veille, en une résurrection de feu… Une blessure atroce : la tête du torero fichée sur la corne, comme un bilboquet. Le torero qui glisse et tombe dans les pattes du fauve, un mufle qui se baisse, la corne qui cueille l’homme à la gorge, le soulève, puis cette tête d’homme à l’horizontale, les yeux au ciel et la corne …. qui ressort par la bouche, de dix centimètres.
La corrida de Madrid était télévisée, les images repassent en boucle au 421, bar taurin nîmois non loin des arènes, passent et repassent au ralenti, dolorisme espagnol oblige. Internet s’en empare, les photos circulent de téléphone portable à téléphone portable. Les messageries sonnent. « Nouveau message » : c’est cette image. Une fois, deux fois, dix fois, sur les portables de nos voisins. Qui aussitôt commentent, se tapent sur l’épaule, font voir à d’autres, ne cessent de s’exclamer : « t’as vu la corne ressort par la bouche», bavards, indifférents au spectacle d’ici, insoucieux que la rumeur se propage et puisse arriver aux oreilles des toreros. Oui, s’en foutant, hypnotisés par le spectaculaire plus qu’affligés par le drame, tant l’image saisissante du malheur estompe la compassion – lire et relire « Le Peintre des batailles » de Perez-Reverte. Les premiers rangs des gradins ne sont plus que commentaires de chirurgiens, froids, techniques, presque ravis de la primeur pour les futures discussions en ville.
On a envie de crier « stop !», de hurler son dégoût que l’on parle aussi abondamment de corde dans la maison d’un pendu, de faire barrage de son corps à ce premier rang, de créer un cordon sanitaire pour que la nouvelle ne tombe pas dans le callejon et que les toreros d’ici , en train d’œuvrer, soient épargnés durant la corrida. Il sera bien temps …
On a envie de ne plus penser à Aparicio, si c’est la condition pour que tout aille bien ici. On veut tenir le drame à distance pour demeurer dans l’illusion que la corrida d’ici est sans enjeu, vaguement ennuyeuse, avec des toros faibles et des toreros qui ne se croisent pas. On aime soudain les toreros du jour, oui on les adore, tout-à-coup, Juan Bautista, Matias, Arturo. On veut les protéger comme une mère : « Non, ton père n’est pas encore rentré, mais vas te coucher, mon petit, il rentrera plus tard, ne te fais pas de souci. Tu sais que ton père t’aime, alors finis ta soupe ! ».
Oui, on sait, désormais, que la corne rôde et, eux, ne l’oublient jamais.
Sur la photo, les traits de cette tête transpercée sont comme naturels, aucune des lignes du visage n’est altérée, pas même une grimace, on voit le nez, on voit les yeux, on voit les cheveux frisés sur le front à l’implantation lointaine. C’est bien Julito. Avec une corne qui ressort par la bouche et un regard de toute la terreur de l’Enfer (Nîmes, 21 mai 2010).
Arènes d’Arles (restauration)
Au débouché des rues étroites qui mènent aux arènes qu’elles surplombent- un peu à la manière des ruelles de Sienne qui, en grimpant, vous font la surprise de la piazza- c’est un véritable massacre qui s’offre aux regards : le virage sud-ouest des arènes a été restauré. Un carton pâte lisse, blanchâtre, découpé en arêtes tranchantes. Ce n’est plus Viollet- le- Duc, c’est Hollywood! Stupéfaits, on s’aperçoit vite que les travaux ne sont pas achevés. On bénit alors la paresse des restaurateurs, les fonds qui ont manqué, la révolte des arlésiens, peu en importe la cause, l’essentiel c’est que les travaux nous aient laissé sur les trois quarts restant les arches de pierre rongée, leurs jambages aux contours incertains, les piliers aux ombres obscures, les traces d’un combat contre le temps depuis Rome ; comme une peau distendue qui donne sa majesté au visage d’un vieillard. Sans doute convenait-il de traiter la pierre contre les attaques de nos pollutions contemporaines, mais ce qui a été fait et qui se donne à voir est un atroce lifting qui, s’étant assigné de rajeunir le monument, l’a avalé tout cru, l’a fait disparaître, a dissous l’amphithéâtre de tant de drames et de passions en un vilain décor de supermarché à la Ricardo BOFILL, qui serait posé là le temps d’un faux combat de gladiateurs avant d’être démonté pour être installé dans d’autres foires où il aurait tout autant sa place. Oui, de l’extérieur nous avons perdu un quart de nos arènes.
A l’intérieur, rien n’a bougé. Il fait grand soleil, le chaudron se remplit peu à peu et les tours sarrasines sont toujours aussi belles.(14 avril 2006)
Carreton
Des toros OGM pour une tauromachie moderne, de gestes sans finalité, de passes sans utilité, données pour elles-mêmes, comme “de salon” en présence d’un animal qui n’est plus un adversaire à dominer, un problème à régler, mais un faire valoir sans âme, à peine mieux qu’un carreton d’entraînement.
Mais le carreton de ferraille et sur roulettes a sa part de magie et de mystère. Ce désossement brinquebalant sur une piste de poussière écrasée de soleil dans une arène vide face à un apprenti torero qui, le torse nu, dessine une passe au passage est portée par le rêve. Il faut imaginer cette arène pleine, le public joyeux, ce même geste mais dessiné, demain, dans dix jours ou dans dix mois, devant un toro de combat. Le songe est beau de cette illusion, de l’ hypothétique convention que cette brouette qui passe, poussée par un copain, est un toro, qu’il faut renter le ventre si l’on veut éviter le coup de corne, qu’il ne faut pas se le mettre dessus, que “là tu as vu ce que j’ai fait; c’est énorme, non?” et qu’à cette remarque nul ne songe à rompre le charme. “Eso es un torero”.
La corrida du jour est l’abolition totale de cette distance entre la part de rêve et le surgissement brutal de la réalité. Le charme singulier du carreton c’est de tenir pour semblables toreo de salon et fiesta brava parce qu’ils ne le sont pas. S’ils le deviennent, alors le charme est rompu. C’est une duperie, et c’est au sens propre la désillusion, la fin de l’illusion. (Nîmes, 28 mai 2009, Zalduendo)
Castella
Castella : dix ans d’alternative, toujours ce visage d’enfant, cette voix de fausset, mais un mental de guerrier. Ce corps si gracile et cette mâle volonté répandue tout autour créent une émouvante dissonance et suscitent l’épate. S’y mêlent une part de mystère et l’étrange pouvoir de séduction des héros asexués, Tintin ou Peter Pan.
La recherche du défi trémendiste est son vrai créneau. Les temps forts de ses faenas ne sont, le plus souvent, que le début où il se donne pour cible en laissant le plus de chance à son adversaire qu’il cite du plus loin, et la fin, où son mental lui permet de jouer avec les cornes. Il est de la famille des Damaso Gonzales et des Paco Ojeda, mais il ne torée pas les toros que combattait le premier, et n’a pas la puissance envoûtante du second à son meilleur. Et ce « blanc » entre le début et la fin de ses faenas, le plus souvent des passes sans intérêt, déclasse son toreo. Malgré son vaillant cartel que Madrid a récompensé maintes fois parce que Madrid aime les braves, il n’est pas, pour l’heure, dans les meilleurs. Le faire croire déçoit les afionados qui s’attendaient à mieux (« Madrid, tu te rends compte ! » se dit-on ici, le bouche-à-oreille boursoufflant son cartel). Non ! Pour aimer infiniment Castella, sa tête bien faite, son mental, et son joli port de petit page, il faut le tenir pour ce qu’il est : un jeune homme qui a trouvé sa voie mais un torero qui cherche encore sa tauromachie. (Beziers, le 12 août 2010, Malaga, le 18 août 2010)
Céret
Céret enfin ! Un ami m’avait prévenu : « A Céret, tu verras, on a un problème d’échelle ». Il est vrai que les toros sont bien gros pour un ruedo bien petit. Et quand on dit, ici, qu’un toro a traversé l’arène de part en part, c’est qu’il a couru vingt cinq mètres ! Céret c’est l’histoire d’une bande d’afionados qui décide, il y a vingt cinq ans, de reprendre les arènes pour monter une féria avec les moyens du bord. On prend des toros pas trop chers, issus d’élevages réputés difficiles ou négligés par les vedettes ( Cuadri, Escolar Gil, le Curé de Valverde- ah, le curé de Valverde…-, Dolores Aguirre, etc.) et on invite des toreros sans contrat à les affronter, sûrs qu’ils ne feront pas la fine bouche. Nécessité faisant loi, cette confrontation entre toros redoutables et toreros sans cartel a conféré au tercio de piques, presque partout ailleurs négligé, ses lettres de noblesse. Car on se trouve contraint ici à s’intéresser davantage aux qualités de l’animal qu’au talent des hommes, sauf la force d’âme qui vient par surcroît. Et ça marche ! A un point tel que des toreros confirmés sinon punteros vont y paraître à leur tour, des Ruiz Miguel, des Manili, des Francisco Espla, des César Rincon, des Padilla, faisant de Céret un rendez-vous singulier qui force le respect. En cette période de basse eaux taurines, l’aficion, lassée des faenas standardisées face à des toros de peu, accourt désormais en masse. Et y aperçoit, flattée, la présence du très estimé Matias Gonzales, président des courses de Bilbao, au palco, qui présidera les corridas du jour. Le public de Céret forme une manière de secte du Vallespir, éloignée des circuits plus aisément accessibles, fière d’en être et enivrée de sa propre exigence. Les afionados de Céret font songer au public de cinéma « d’Art et essai » des années 70 : savant et sûr de son fait, indifférent au succès public et attendant obstinément la pépite qui ne saurait tarder, cérébral plus que sensible, intarissablement commentateur entre soi. Fier de sa différence. A Céret, on diffuse du Jacques Brel avant la corrida où l’on salive du spectacle à suivre en écoutant « Les Vieux » ! La fanfare n’est pas une banda de musica ordinaire : c’est une cobla, un orchestre de sardane, avec grosse caisse qui accompagne les instruments à vents, cuivres normaux et bois nationaux, c’est-à-dire catalans : le tenora, sorte de hautbois au son chaud, le tible, à la musique aigre, le flabiol, pipo à peine plus long qu’un sifflet, un tambourin suspendu sous l’aisselle en prime. Car ici, de pasodoble –trop espagnol !- il n’y a guère, et en ce 14 juillet, jour de fête nationale en France on n’honore que la catalane : hymne local, public debout et tout le toutim ! Avant la sortie du cinquième toro, la cobla joue une sardane, l’austère gradin faisant farandole sur place, guirlandes de bras levés, primesautier et guilleret, à mille lieux des émotions du ruedo et de l’air solennel et grave qui ouvre le paseo, genre Bolero de Ravel en plus moyenâgeux, style grand départ pour la croisade. Ajoutons que les mâles roulements de tambours et la sonnerie des trompettes qui annoncent la sortie des toros n’ont rien à voir avec nos familières et ridicules clarines ! C’est un avertissement guerrier de tournoi de chevalerie. D’ailleurs les noms qui figurent sur le panneau que l’arenero présente au public avant chaque combat sont ceux du toro et du picador, et non pas celui de l’homme à pied. Ici, on choisit son gladiateur et on le préfère à cheval. Enfin, il n’y a à Céret qu’un seul algualzil et non pas deux, tant il serait vain de déléguer trop abondamment le pouvoir de police ; le public y veille ! C t alguazil a hérité de la charge de son père auprès duquel, enfant, il défilait déjà à ses six ans. Le père est mort très jeune, on a gardé l’enfant qui a grandi sur son cheval. C’est lui qui conduit désormais le paseo. Dans cette ambiance de Puy-du-Fou sous Charlemagne, il y manquerait presque une oriflamme ! Oui, tout ici respire la Légende des siècles et son Roland de Roncevaux : le goût âpre du combat et les défis héroïques auxquels des hommes modestes accrochent leurs rêves de gloire. Avec les montages alentour et le merveilleux pont de pierre suspendu depuis sept siècles au-dessus du Tech, cette aficion catalane, exigeante et nationaliste, a des airs de Sarajevo. Cette franc-maçonnerie taurine qui a ses ridicules est sympathique en diable ! Comme en loge, on est tenu au silence durant la première temporada, quelques vénérables faisant l’opinion. Mais quand on s’aperçoit que vous en êtes, on vous embrasse à bouche-que-veux-tu en signe de reconnaissance et d’adoubement du nouvel initié. (juillet 2013)
Curro Diaz
Curro Diaz, la trentaine un peu gitane, les cheveux dans le cou, noueux comme un arbre mort, un nez cabossé et une bouche immense qui étirent un visage émacié aux reflets bistre, a un regard de velours, incertain et fiévreux, aux éclairs de braise lente.
C’est un torero discret de Linares, un torero de jolis gestes, de plaisir fugace, un peu décoratif, qui enlumine une corrida sans jamais y laisser d’empreinte durable, un torero modeste qui n’a pas encore trouvé son cartel. Voilà ce qu’était Curro Diaz avant cette corrida de Nîmes. En deux combats, nous avons assisté à l’assomption d’un torero.
Le corps droit, très vertical mais sans raideur, Curro Diaz cite le toro à quelques mètres, attend impassible la charge, muleta offerte, puis l’accompagne au passage d’un discret relâchement de hanche, comme un frisson dans ce toreo de ceinture. Et chaque passe au dessin retenu est pleine de cette certitude de soi, sans mépris ni violence, comme une étreinte pudique, toujours recommencée, dans une intensité lente à faire perdre la raison. Rien de plus qui se donne à voir que ces passes que le torero livre, comme un maître des coups de pinceaux sur une toile vierge, chacun mystérieux mais dont la combinaison dévoile l’oeuvre peu à peu, comme s’il revenait à l’artiste, non d’en être l’auteur, mais le découvreur devant nos yeux étonnés.
A gauche, la main est basse, le tissu au sol, la muleta tenue à la verticale, comme un ruban dont le torero se joue dans des ensorcellements limpides et des frôlements de corps à l’oblique, obligeant l’autre à revenir et revenir encore, dans un jeu inassouvi d’enjôleuses caresses.
Un changement de main, comme un soupir continué, puis à nouveau ces ruisseaux de fluidité, toréant par derechazos, dans un si grand relâchement de soi que la main gauche paraît morte, comme à un bras suspendue. Et il y a encore une trinchera, dense, habitée, vaporeuse, où le toro s’enveloppe dans les replis d’une muleta qui se dérobe.
C’est tout. Et cette main morte comme à un bras suspendue quand de l’autre côté de cette taille étroite s’engage un fauve d’une demi-tonne donne envie de hurler. Et si l’on garde son calme c’est que les passes recommencées d’un toreo si invraisemblablement serein et pur a sur nous un effet hypnotique. Ce toreo rondeno se déploie sans faste ni fantaisie. Un toreo de failles obscures dans la roche brute, de peaux tannées par un soleil froid et des horizons lointains. Un toreo de silence, comme on se recueille, épuré et sûr, à la découpe franche, aux vibrations discrètes. La langue élégante et muette des sourates gravées dans le stuc des palais mudejar. Une fleur d’amandier sur une pierre sèche. Deux oreilles qui en valent mille. (Nîmes, 19 septembre 2010, La Quinta)
Denis Loré
Une gueule de belluaire, des jambes arquées, des épaules tendues au-dessus d’une taille étroite, ce portrait, comme une caricature de torero de l’autre siècle, n’aura pas suffi, jusqu’à présent, à permettre à Denis la carrière qu’il mérite -celle de successeur de Nimeno- en dépit du souvenir notable de grandes faenas que je conserve de lui, tant comme novillero que depuis son alternative. Que faudrait-il qu’il fasse pour sortir enfin de la grisaille dans laquelle on le confine? Peut-être ce qu’il a fait aujourd’hui devant ce cinquième Samuel Flores, maigre, efflanqué, très laid, mais aux cornes si longues et effilées qu’elles dessinent une immense lyre, diabolique. A l’entrée du fauve, les applaudissements que suscite spontanément le sérieux des armures s’interrompent soudain : le public, se ravisant, est saisi d’effroi.
Denis cite, Denis aguante, Denis torée en faisant passer ce toro autour de sa taille qu’il est forcé de comprimer pour que les cornes ne l’atteignent pas. Ces cornes cherchent, ces cornes menacent et Denis, les pieds bien en terre, ne cède rien du terrain, balayé par ces lances, comme des sabres qui zèbrent l’air ou, soudain immobiles, en suspension à hauteur de ses épaules.
Ni la première alerte – le gilet de l’habit déchiré par la corne- ni le vent n’y peuvent rien. Le danger est d’ailleurs tel qu’on en oublie le vent. Ce sont les cornes – et elles seules- qui désormais laissent le torero constamment à découvert. Et elles frôlent la chaquetilla à chaque pecho, la bête paraissant hésiter entre son instinct – frapper son adversaire au coeur- et le mouvement de l’étoffe dominatrice qui l’éloigne du torero. Le public retient son souffle et la tension, à son comble, explose en applaudissements à chaque fin de série. A la mort, le public plein de rage, comme s’il avait été mis en danger lui-même et se trouvait, lui aussi, victorieux du combat, crie “ TORERO” “TORERO”, comme une libération.
Denis est pâle. Il sourit gentiment et lève les bras en saluant la foule l’épée dans une main, avec sérieux et sobriété, comme s’il n’était étonné ni de ce qu’il venait d’accomplir, ni de sa réussite, un peu surpris cependant de l’enthousiasme qu’il suscite et paraissant dire au public de sa ville qui n’a jamais voulu en faire un roi, avec une modestie mêlée de reproche: “ Mais n’est-ce pas ce que vous attendez de moi? Et n’est-ce pas ce que vous m’offrez à toréer?”.
Une oreille pour cette geste comme une succession, cette fois-ci réussie. Denis de Nîmes est né. (Nîmes, 17 septembre 2005, Samuel Flores)
Etre le torero du jour
Le torero du jour fut Daniel Luque. Mais être “le torero du jour” résulte moins des qualités de l’homme que des circonstances. Qu’il y ait un “torero du jour”, peu importe lequel, en dit beaucoup de la tarde. Un “torero du jour”, c’est nécessairement une tarde médiocre, d’un long ennui, avec, c’est à parier, des toros qui sortent mal, donnent peu de jeu, faibles ou décastés. Et cette impression persistante, poisseuse qui envahit le gradin : voilà bien une corrida de trop!
Dans la hiérarchie des commentaires, le “torero du jour”est très inférieur au torero “qui a sauvé la tarde”. Le triomphe de ce dernier efface la grise couleur de l’après-midi tandis que “le torero du jour” n’est rien sans cette tonalité dépressive : c’est la silhouette claire qui se détache d’une grisaille. Le “torero du jour” ne sauve jamais l’aficonado d’une mauvaise tarde ; il parvient seulement à tirer son épingle du jeu.
En outre, le “torero du jour” est nécessairement un modeste, jeune, fragile, peu aguerri ou obscur. On ne songera jamais à dire d’une torero de première classe qu’il a été “le torero du jour”. On dira de lui qu’il a triomphé, qu’il n’a pas déçu, qu’il a été regular ou au contraire en dessous- de son niveau, de son toro. Par définition, une figura ne peut jamais être “le torero du jour”, c’est le torero d’une temporada, de quelques saisons ou un torero d’époque. Le“ torero du jour”, lui, est le torero d’un jour et d’un jour “sans”. Mais ce peut être quelque fois, s’il “répète”, une promesse. Surtout s’il a l’âge de Daniel Luque. 18 ans et demi ce jour. (Malaga, 18 août 2008)
Fernandez Meca ( Stéphan)
C’est la despedida de Stéphan Fernandez Meca, torero brave qui n’a pas eu le choix de ses cartels et qui, condamné à affronter les élevages les plus âpres, l’a fait avec courage, grande toreria, une épée sûre et le sourire un peu sot de celui qui est toujours étonné de triompher de la mort. Son nom sur l’affiche n’a jamais attiré personne, mais s’il est programmé, c’est que les toros sont de respect, alors le public accourt.
Son succès est de procuration? Il le sait et ne s’en offense pas. Il fait ce que l’on attend de lui: mettre les toros en valeur, et il le fait très bien, notamment dans des remates virils, lors de la mise en suerte à la pique, laissant la bête à 10 ou 15 mètres du cheval. Ses triomphes, notables à Nîmes devant les Victorino Martin, sont généralement le signe d’une feria de peu, de celles que l’on oublie quelques jours après, frustrés d’art.
Meca, si jeune et sympathique, n’a jamais suscité l’attente sadique et goguenarde du public à l’égard d’un Richard Millian: disposant de beaucoup plus de recours que ce dernier, il n’a pas son pittoresque. Il n’a jamais, non plus, suscité l’affection qui entourait un Nimeno. Sans doute Nimeno est-il mort de l’arène et Stéphan, lui, annonce, dès le soir de sa despedida, qu’il va devenir agent immobilier…
Le vent souffle par bourrasque et le public applaudit mollement ce torero de Nîmes qui n’a jamais été le sien. Le maire et une autre personnalité lui offrent, aussitôt après le paseo, une sculpture représentant un toro qui, depuis nos places, paraît être de plastique.Tout cela sans façon et sans la moindre émotion. C’est que Stéphan n’est déjà plus parmi nous.
Le vent n’autorisera aucune faena et Stéphan ne se battra pas contre les éléments. Il offre son premier à Denis Loré et le public applaudit chaleureusement ; son second à son jeune enfant et on comprend qu’il lui promet ce soir de rentrer à la maison. Après cette dernière faena dans sa ville, le public applaudit poliment en guise d’hommage. Stéphan reste dans le callejon et refuse de saluer. Tout est dit. ( Nîmes, 17 septembre 2005, Samuel Flores)
Javier Conde (1)
Un remate à la cape (Nîmes, 18 septembre 2005, mano a mano avec Morante)
Dans ce marasme, comme un éclair illuminant brutalement une nuit sans lune, un remate à une seule main de Javier Conde à la fin d’une série de véroniques, plein de mépris et de domination, inspiré, lance de gitan pur qui fait rugir le gradin de plaisir, comme si tout le reste, la torpeur et la désespérance, pouvait d’un seul geste être aboli. Comme le corps d’une femme inassouvie qui se cabre et s’oublie sous la seule caresse que lui consentirait enfin un amant qui se dérobe. Cet instant, monstreux et magique, qui joue comme un philtre, est la marque d’un maître.
Javier Condé (2)
Javier Conde accueille son second par des véroniques flamencas, le compas ouvert, d’un grand style baroque, avant de conclure par une larga méprisante, comme on jette le gant à un adversaire. Enivré par ce qu’il vient de se surprendre à faire, il oublie de mettre en suerte le toro qui se rue sur le picador, pousse le cheval jusqu’à la barrière puis s’éteint un peu. Une deuxième rencontre fait illusion et le tercio est très applaudi.
La surprise est totale quand on le voit offrir la mort de son toro à José Tomas, comme une lorette taperait la bise à un évêque. “Quel toupet!”.
Mais sans doute le prélat a-t-il béni la pécheresse. En tout cas, l’esprit souffle en piste.
Trinchera vibrante, série de derechazos les jambes écartées et la main basse, changement de main, trinchera encore, celle-ci comme on expire. Hébété, le pas mécanique, la muleta tenue à l’horizontale à bout de bras comme on exhibe un morceau de la Vraie croix, Javier s’éloigne du cercle de feu où il vient de se croiser.
Il se retourne soudain, et d’un zapateo cite le fauve qui ne demande qu’une nouvelle rencontre. A nouveau, trois passes d’inspiration, conclues par le mépris. Javier s’éloigne, sidéré, la muleta traînant à terre, interminablement.
L’objet du destin tente à nouveau une prière, hurlant sa misère mais électrisé par la foi. Récompensé par le duende, il s’enivre de son toro et de son art, comme si les deux lui étaient donnés en inattendue récompense. On ne sait plus ce qu’il fait, et lui doit le savoir à peine, mais l’arène hurle ses olés et lui pleure de joie, tour-à-tour vertical, hiératique, la muleta dans les pieds, paratonnerre d’inspiration, tantôt pantin désarticulé, magie des jouets inanimés.
Voilà, c’est beau, tout de ruptures et de fulgurances, la main dédaigneuse et inspirée face à un adversaire inlassable et joueur.
Le public crie sa joie, et son désir que le toro soit sauvé. Il sera gracié, comme il le méritait -malgré la polémique qui s’est ensuivie – au regard des canons de la tauromachie moderne qui devrait attendre avec impatience, dans quatre ans, le sang de ce sang. Deux oreilles au torero qui pleure d’émotion. (Nîmes, 29 mai 2009, Garcigrande)
José Tomas (1)
Eh oui, c’est ainsi, José Tomas est à l’affiche et le Paseo del Parque paraît plus beau que d’habitude. Les murailles et les tours maures de l’Alcazaba en surplomb se découpent si nettement sur le ciel qu’une impression d’artificialité s’en dégage, comme des étranges murs de briques rouges de Giorgio de Chirico. L’arène est pleine trois quarts d’heure avant le début du spectacle. C’est sûr, il se passe quelque chose.
Jose Tomas entre dans le jeu dès le quite sur le premier toro de Pepin Leria par gaoneras, le tissu replié à l’extrême, le reste de la cape au sol, citant à 25 mètres. L’effet et l’exécution sont de perfection.
Son premier toro pèse 545 kgs, a l’encornure commode et paraît un peu anovillado. Il marque de discrets signes de faiblesse mais s’emploie au piquero avec moral et cette alegria du premier de Leria. Quites par parones ajustés et passes du tablier. Mais ce tablier-là n’est plus un tissu tendu à bout de bras, comme l’on évente un drap de lit, c’est un tablier de sévillane, replié par devers soi, qui colle à la taille, une robe à volants dont on joue, Carmen devant Don José.
A la muleta, passe de bandera liée à un pecho qui aspirent le silence. Cite à 20 mètres pour une série de derechazos en chargeant la suerte, en mandant à mort, le geste est parfait de puissance contenue, contraignante, puis libératrice. A la naturelle, le bras est avancé, la taille aimantée par le toro, puis le toro aimanté par l’étoffe qui traîne par terre, dessinant un cercle lent. Tomas s’apprête à faire, toujours de la gauche, une passe inversée, le toro voit la flanelle, bronche mais ne suit pas ; le torero, impassible, ne frémit pas d’un millimètre, remet le bras devant et tire, tire, un toro récalcitrant mais contraint désormais à obéir. Tant d’aguante et de sûreté de soi mettent le feu aux arènes. Derechazos de face, distillés comme des naturelles, un à un, expirant sur le sable, puis le toro est ramené vers les barrières par trincheras et aidées par le bas, pour la mort.
Tout paraît pur, l’emplacement, le geste, la passe et la série, d’une maîtrise sereine et, dans de telles circonstances, presque inhumaine. Cette science de la position, celle du corps face au toro, de la main sur la muleta, de l’étoffe qui va chercher l’adversaire, puis du tissu devant les cornes, est si absolue que tout -l’homme et le toro- paraît s’effacer pour ne laisser voir que le geste taurin, le reste – c’est-à-dire les protagonistes, homme et toro ensemble- étant renvoyés au conjoncturel. Un peu comme ces mains de Michel-Ange sur le plafond de la Sixtine, où l’espace vide entre le doigt de Dieu et la main d’Adam, ce frôlement et cette distance ne nous disent ni Dieu ni l’Homme, mais autre chose.
Alors, oui, l’arène est debout, couvrant la musique de ses “olés” et de ses “Torero/Torero”, car il faut bien se libérer de tant d’intensité. L’épée de mort en mains, ce sont des manoletinas où le tissu de la muleta n’est plus qu’un ornement à la taille. Pinchazo, entière, le toro s’affaisse puis se relève, rinçant un peu l’enthousiasme. Une oreille. Qui n’a pas de sens faute d’une échelle commune….
La vuelta est, en ce 20 août, d’anniversaire, chaque tendido chantant, à son tour, “Feliz cumpleano” face au torero amusé, jusqu’à ce que la musique s’en mêle : José Tomas a trente ans ce jour. Cette manifestation d’affection terrestre jure un peu avec ce que l’on vient de voir qui était d’un autre ordre.
Sort un toro de réserve de 535kgs de septembre 2002, soit un toro de près de 6 ans. La faena, excepté des trincheras et passes par le bas en entame, sera exclusivement gauchère. Des séries de naturelles, croisées, templées, infinies, toujours recommencées, presque hypnotiques, comme si le torero se disait pour lui-même : “ Pas mal mais je peux mieux faire. Voilà, celle-ci est bien . Et celle-ci n’est-elle pas plus lente? Celle-là pas mieux dessinée? Celle-ci encore. Encore une pour voir” et ainsi de suite, sans pouvoir mettre fin à une recherche intérieure de pureté et d’absolu.
Fin par manoletinas, une épée foudroyante. “Torero/Torero”. Deux oreilles. “Cumpleano feliz” plus fort encore. On ressort hagard, comme d’un songe philosophique. (Malaga, 20 août 2008, Le Pilar)
José Tomas (2)
Et le toro qui sort augure mal de la suite. Courant en tous sens, coupant droit sans suivre l’étoffe, menaçant par deux fois José Tomas, se ruant sur le cheval sans manière, il paraît aveugle ou borgne pour le moins. Le public, déçu qu’un tel matériel puisse priver le torero du triomphe annoncé, suggère par ses protestations et ses palmitas un changement qu’il n’obtient pas. La pique est évidemment puissante mais ne paraît pas avoir réglé le problème, les peones plantant les banderilles à l’avenant. Pourtant, Tomas ne quitte pas la piste des yeux, observant à trois pas du burladero ce jeu désordonné, sans marquer aucun signe de désappointement, comme s’il savait pouvoir y mettre en terme.
Il y parviendra en une seule série, la première, le genou ployé, par doblones lents et suaves dans lesquels il tient le toro, aimantant sa charge, la dirigeant avec confiance, la prolongeant avec douceur, l’abandonnant quand aucune scorie ne vient plus en altérer le cours.
Cette série paraît relever de la magie noire, quand de quelques fumerolles mystérieuses un sorcier parvient à apaiser les convulsions d’un possédé.
Cette séance d’exorcisme achevée, sûr de son fait, José Tomas se place à vingt mètres et cite son toro de la gauche, sur cette corne qui l’avait par deux fois menacé, si erratique que nous pensions, à sa sortie, que la bête était borgne. Vingt mètres, de la gauche, le toro accourt avec classe, suit l’étoffe avec noblesse et revient, recommence inlassablement, quand l’étoffe, plus ramassée, glisse sur le sable au plus près de l’homme, un soupir de toreo. Une série, deux séries, dix séries …qu’importe.
Comment expliquer l’impact d’une telle tauromachie qui fait se lever le public mais retient les cris de l’arène (“torero/torero”) comme si chacun sentait confusément qu’il y aurait blasphème à rompre cette versification de mystère et de silence, aux rimes soudain ornées de trincherillas, changement de main dans le dos, et kirikiki limpide comme l’eau pure d’une cascade de roche?
Il y a dans la distance que José Tomas met dans toutes choses – oubli apparent de soi, étanchéité aux autres, au plus près du toro- une solennité qui confère à ses gestes une gravité d’officiant. C’est un torero lointain qui, comme un prêtre derrière l’autel, le dos aux fidèles, désigne le sacré.
Estocade al recibir mais finalement al encuentro, descabello : deux oreilles pour le mallarméen. (Nîmes, 29 mai 2009, Garcigrande)
Julien Lescarret et le Miura
Julien Lescarret torée pour la première fois des Miuras. Sa taille de jockey suffit à dire le challenge et il tombe, le pauvre, sur un andarin, armé et très haut, et qui le restera malgré trois puissantes piques. A la muleta, il se fait manger le terrain à droite. C’est pire à gauche et un désarmé signe l’échec d’un torero trop jeune devant un tel adversaire.
Le toro marche, ne cesse de marcher, ne quittant pas le torero des yeux, marche sur lui, et l’autre ne peut rien. Il s’apprête puis recule, et recule encore. Jusqu’à ce qu’instruit par sa cuadrilla ou comprenant de lui-même, il aille se placer à l’autre bout de l’arène d’où il cite le fauve. Le toro alors court vers lui, qui fait face à la charge et livre sa première passe, embarque le fauve, le tenant enfin. Ayant tiré avantage de ce qui jusqu’alors le menaçait, le jeune torero reprend un peu confiance. C’est déjà trop, et il se fait accrocher, tombant à la renverse. Hébété, il retrouve le péonage qui lui verse de l’eau sur la nuque, comme on le fait à un boxeur groggy. Il quitte alors sa veste de lumières et c’est en gilet et bras de chemise, comme un jeune communiant, qu’il repart au combat. Le public qui avait vu le pire en silence salue alors le défi et le courage, applaudissements dans lesquels Lescarret trouve sans doute la ressource de rester dans le terrain, faisant comme il peut, mais en étant devant. La cuadrilla déborde des deux côtés du burladero pour entretenir le feu, ou se tenir prête au cas où. La foule est conquise sinon par ce combat inégal du moins par la force d’âme de Lescarret, qui, à cet instant, si petit, si gracile face à un tel danger, est comme un jeune fils que l’arène entière voudrait protéger. Un geste décidé et une belle épée feront tomber une oreille que nul ne songerait à discuter. Lescarret exulte, tend les bras vers la foule, ivre de peur ou de délivrance. Son péon, Frédéric Leal, s’avance vers lui, le prend affectueusement dans les bras et lui caresse les cheveux, dans un geste de mère. La vuelta est intense, et aux spectateurs qui lui demandent de leur lancer le trophée, il rit sans gêne ni regret, mettant l’oreille sur le coeur pour signifier à tous : “Ah, non! Celle-là je la garde!”. (Arles avril 2009)
Juan José Padilla
Juan José Padilla, comme d’habitude, fait le spectacle. Sa manière paillarde, goulue, rabelaisienne, de se tenir dans l’arène fait le bonheur des foules. Très décidé à la cape sur chacun de ses toros en gagnant du terrain, il sera inégal aux banderilles. Au 4ème, une entame de rodillas (8 passes avant le pecho en gagnant le centre, glissant sur la piste comme un saurien d’avant l’histoire) mettra le public en ébullition, lequel réclamera deux oreilles, sans doute pour faire payer à la présidence le refus de faire jouer la musique durant la faena. Pas bégueule, la présidence les accordera (Arles, Miura, 12 avril 2009).
Las Ventas
Des grappes de foule s’écoulent lentement des rames du métro et suivent une même direction, formant un fleuve puissant de processionnaires aimantés par un même courant. Au débouché de la station, on grimpe ensemble les marches vers la lumière, dans un silence de martyrs aztèques. Et soudain, les arènes vous tombent dessus. Une forteresse de briques rouges, aux hautes tours carrées, reliées par des galeries en terrasses de style arabo-andalou, dont on pressent qu’elles sont une ultime diversion. Deux groupes de sculptures y font face qui nous disent le reste : un hommage au torero El Yio, mort à 21 ans, comme un ange suspendu à la corne d’un toro, pleuré par les siens, et un buste du Dr Fleming que salue un maestro de bronze. Le sacrifice et la pénicilline, la mort et la blessure. On n’entre pas dans Las Ventas, les arènes de Madrid, ces arènes du monde, sans un frisson et la mine grave. Voilà pour l’aficionado. Pour ne rien dire du torero lorsqu’il franchit le patio de cuadrillas…
Il n’y a, ici, ni fantaisie, ni légèreté. Il n’y a pas, comme à Séville, de calle Iris par où les toreros rejoignent l’arène applaudis par les badauds qui les encouragent dans une atmosphère chaleureuse de fête partagée. Madrid, ce n’est pas la fête. Les toros y sont généralement redoutables et le public est au torero plus redoutable encore. Il exige de lui le plus grand courage et une forte personnalité. Pour cela, il lui faut un toro morphologiquement parfait, aux cornes les plus exagérées possibles, et de caste, pour que le combat soit «à la loyale» ; la moindre boiterie de l’animal déclenche protestations et sifflets jusqu’à ce que la présidence en ordonne le changement. Quand le toro est exempt de tout défaut visible, alors le toro n’a jamais tort, et si le toro est compliqué, vicieux, couard, con genio, et que le torero ne s’accorde pas avec lui, on siffle le torero parce que « à chaque toro sa lidia » et que l’homme n’a pas le droit d’être en échec.
Madrid n’aime rien mieux que la force d’âme. Voilà pourquoi, les toreros punteros, les stars de la tauromachie, y sont généralement mal accueillis. Aux yeux de Las Ventas, leur succès durable manifeste un trop insolent désir de vivre. Ceux qui en sont dépourvus, les chevaliers à la triste figure, les moines de l’Escorial, et quelques toreros de second ordre n’ayant plus rien à perdre, et qui le montrent, sont attendus avec curiosité. Et ils le savent : une oreille coupée ici vaut dix ailleurs, un prochain contrat à Madrid et une dizaine de plus dans la saison. Deux oreilles, c‘est une Puerta Grande et une temporada assurée et peut-être même deux.
Luis Francisco Espla
Voilà longtemps que je n’avais plus vu Espla. Sa petite taille et sa calvitie me surprennent. Il se tient droit, très droit, sans doute pour ces deux raisons et pour une autre, elle, que je n’avais pas oublié : sa toreria.
Chef de lidia attentif et quelque fois cérémonieux, banderillero habile, tantôt mutin, tantôt goguenard, muletero technicien qui a en suffisamment vu pour ne plus s’illusionner ni sur les toros ni sur le public ni sur son art, Espla en impose par sa manière d’être dans l’arène, celle d’un artisan qui connaît le métier, sans forfanterie ni fioriture. Le personnage qu’il se compose, étranger à l’hyperbole et au songe, aux images romanesques et au charme du duende, se résume tout entier en une parfaite connaissance du toro au service d’une tauromachie désacralisée. Il reste, et depuis plus de trente ans, celui qui combat les bêtes que le sort lui réserve dans toutes les arènes d’Espagne, de France et d’ailleurs, admiré de Madrid, apprécié des publics torista et sachant consentir quelques clins d’oeil aux autres, mais sans façon ni vanité. On le dit artiste – mais alors en peinture, art qu’il affectionne- , intelligent et cultivé. On l’a vu mille fois dodeliner de la tête face à l’adversité, comme si on ne la lui faisait pas, sans se démonter jamais et retournant à l’ouvrage en prenant le public à témoin. Et pour avoir vu des scènes de ce genre dix fois, vingt fois, peut-être plus, on aime Espla qui nous dit que la corrida est un fichu métier (Malaga, août 2008).
Manzanares/ Nuit
Il ne faudrait pas rencontrer les toreros hors de l’arène. Pas plus que prendre le thé avec un écrivain. L’oeuvre encombre. Et tenter de deviner l’homme sous l’artiste est un exercice vain et au fond pas très loyal. Un jeu d’espions ayant travaillé sur fiches avant de croiser, incognito, leur cible.
Ce soir, ou plutôt au grand matin, Juli et Manzanares sont passés chez Soco. Nous y étions. Soco est la fille du grand Manolo Gonzales. Elle fait les tenancières de café branché à Séville, où le mundillo chic se précipite, avec son bagage de jetsetters que l’on exhibe comme d’autres les décorations, mi-condescendants mi-déférents devant la demi-naine à tête de toro qui danse la sévillane à hauteur de ceinture mais avec arte y sentimiento.
Juli a tout d’un gosse, un regard de gosse, un sourire de gosse, une allure de gosse. Un peu endimanché, dans une veste trop large, mal assortie au pantalon. Avenant et chaleureux, se réjouissant de tout, allant de groupe en groupe recueillir el piropo, se laissant prendre en photo sans impatience, on ne reconnaît pas du tout le torero puissant et dominateur qui ne se laisse jamais surprendre par ses adversaires quand ces derniers sont des bêtes. Et chez Soco, ce soir, El Juli était un enfant, ravi mais un peu gauche dans ce costume trop grand, dansant la Sévillane avec la maîtresse des lieux, comme il l’aurait fait avec toute autre. Parce qu’il faut bien danser et que c’est toujours un plaisir. Où serait le problème ?
Manzanares chez Soco, dans un impeccable costume bleu de belle étoffe, chemise blanche, cravate rouge, les manches retroussées jusqu’aux coudes parce qu’on est jeune, paraissait exhiber sans plaisir cette beauté qui l’encombre. Un visage de sculpture romaine qu’une ligne de nez adoucit, des lèvres pulpeuses et deux fentes, comme des cicatrices indiennes, d’où s’échappe un filet de regard, couleur miel mais dur comme une lame. Un peu inexpressif. Nerveux, parlant peu, s’asseyant à une table, entouré de sa bande qui respecte son silence et ne lui parle pas plus, il est comme échoué là par erreur. Aussi mal qu’il le serait ailleurs. Il se lèvera passer quelques coups de fil, boira un Red Bull au bar où nul ne l’approche. S’en dégage une impression de sauvagerie indomptée et de douleur secrète qui jure avec sa mise à la mode. Un air de Marlon Brando qui émeut et épouvante.
Il ne paraît pas triste ; plutôt absent. Absent à lui-même, et absent aux autres. Comme retiré d’un monde dont il est une pourtant une effigie et un symbole. Celui d’un people, et néanmoins artiste de grande caste qui a déclaré, après la corrida : « Après ce que venait de faire Le Juli, je ne pouvais pas rester derrière », ajoutant ceci, en allusion à la hernie discale dont il souffre et qui nécessite une intervention chirurgicale, différée pour cause de féria de Séville : « Je souhaitais que les gens restent sur une bonne impression parce que je ne sais pas quand je pourrais toréer à nouveau ». Que desgracia ! Y olé al torero ! (Séville, 20 avril 2010)
Manzanares que Voici (le magazine…)
Manzanares est le meilleur acier trempé du moment et paraît le savoir. Avant la sortie de son premier, un très beau toro de 530 kgs, aux armures redoutables, il se donne à voir en piste, le dos abandonné à la barrière, la cape étendue à ses pieds, revers légèrement relevé sur bas roses, les bras en croix de Saint André sur le torse, en une attente arrogante, où il paraît éprouver sa puissance. C’est ainsi qu’il se recueille. Mais à la fin, tout de même, il se signe. Il conclura sa première faena d’une épée, la plus belle du cycle, jusqu’à la garde, vengeresse. Manzanares, encore tout à son combat, se met en garde, le coude plié à l’horizontale en direction de son toro. Le fauve le regarde, fait un pas et se rend. Une oreille de feu pour ce combat ardent de toreo grande.
Une épée phénoménale mais contraire, d’un engagement total, mettra fin au combat sur le 6. Alors, Jose Maria se tend comme un arc, renverse la tête en arrière, et se fait adorer par le ciel. Sortie de Jupiter par la Puerta Grande (Malaga, 17 août 2010, JP Domecq)
A Bilbao, quelques jours plus tard, il fallait voir la vuelta, et il fallait voir Manzanares sortir de l’arène en traversant le ruedo, heureux de son après-midi, faire d’étranges petits signes de la main aux tendidos, en repliant les doigts sur la paume, comme le font les bébés et les jeunes filles coquines, puis, sur le marchepied de son fourgon, à l’arrêt devant la plaza, assis, en habit de lumières, accueillir interminablement la foule, signer des autographes, dire un mot aimable à chacun, s’exposer aux téléphones portables multifonctions. Jose Maria offrait généreusement sa popularité aux âmes inconsolées, comme un jeune prince thaumaturge … (Bilbao, 26 août 2010, El Ventorillo)
Marco Leal (novillero)
La vraie surprise viendra de Marco Léal pour sa présentation à Arles. Véroniques de réception très assurées, ajustées et toréées. Et faena de grande qualité qui a su canaliser l’alegria du novillo tant à droite qu’à gauche. Un travail très sérieux, de grande justesse, et assez dominateur. Un travail de torero. Une vuelta al toro et deux oreilles viendront un peu gâcher la fête, mais qu’importe les trophées…. Marco, heureux comme un gosse, avait offert la mort de ce premier adversaire à sa bande de copains qui, dégringolant des gradins, sont venus s’agglutiner sur la piste, un, deux, dix, douze, quinze, vingt, peut-être plus. A offrir ce toro à ses potes, on crût un instant que tout le public allait se retrouver en piste. Il fera la vuelta en portant un bébé blond sur le bras, dernier rejeton des Léal, son demi-frère entendit-on sur les gradins.(Arles, 16 avril 2006)
Matias Tejela
Oh Matias n’a guère d’imagination, il n’est pas un lidiador, ni davantage un torero d’inspiration ; son répertoire est limité, comme sa connaissance des terrains, et le sens du sitio. Non, il n’a que peu de tout ce qui fait les grands toreros.
Mais il a la grâce d’un poignet et le don du temple, cette douce lenteur qu’il imprime à son geste, à sa muleta et donc à la course du toro qu’il sait ralentir au-delà de toute raison. Ce don, il l’a, il l’entretient et il n’en est pas avare. A la différence des artistes qui ne templent que s’ils s’acordent avec leur adversaire, lui temple comme il respire, en tout cas chaque fois qu’il le peut, sans attendre LA faena. Il temple ici ou là, sur une passe isolée avant de rompre, et peut tenter sa chance dans le marasme. « Et si on templait ? » a-t-il l’air de se dire. « Chiche !». Alors il tente, fut ce devant un toro à contre-style.
Le temple, chez tous les autres toreros qui en sont dotés – une petite dizaine-, est un plus, une grâce qui ne peut qu’être appelée par le cours des choses, évidemment rare et pécieuse. Lui, le temple, c’est sa ressource, son truc, son seul bagage. Alors, il n’en est pas économe et en répand comme d’autres l’eau bénite, en une inattendue abondance, les jours avec comme les jours sans.
Au cente du ruedo, après ses passes du cambio, il cite à nouveau de loin, embarque le toro, l’attire dans sa muleta, de plus en plus lente dans des passes expirées. Autre série, plus lente encore, toute de douceur ; une interminable étreinte. C’est si lent que le toro paraît s’arrêter. Mais, c’est qu’il s’arrête ! Alors, un léger tremblement de tissu imprime à nouveau un souffle de muleta, qui reprend aussi lentement le cours de la passe interrompue. La main est basse, de plus en plus basse. Elle est si basse maintenant, qu’elle est sous le muffle ; le tissu traîne au sol ; c’est une main et un bâton – la « muleta »- qui aimantent la scène. Tejela s’en enivre tellement, de cette lenteur, de cette puissance d’attrait, de cette noblesse de l’adversaire, que lui, si soucieux de son maintien, n’y prend plus garde, plié sur son toro, non pas plié loin du toro comme souvent, mais presque accroupi aux côtés du toro, pour que la main frôle le sol et avec la main la muleta, et avec la muleta le muffle, dans un geste de révérence sacrée, comme on glisse les Rameaux sous les pas du Chist.
Il prend la main gauche et délivre trois séries de naturelles dessinées mais où il ne temple plus. Alors on s’en fout. «Reviens, reviens vite à droite ! » Donne nous encore de ce temple, de cette lenteur de déraison, cette inouïe violence des contraires que la beauté étouffe comme l’on régurgite un cri dont on craindrait qu’il fasse cesser le charme de chimies obscures, mais qu’un remate libère de rage contenue, comme un désensorcellement de tensions addictives.
Voilà ! Matias reprend à droite, et nous de son opium qu’il distille aujourd’hui à profusion. Il faut bien en sortir. Il se jette dans les cornes. Son partenaire s’effondre, fort applaudi à l’arrastre. Deux oreilles pour le torero, pour dix minutes de magie pure. Il ne faut jamais désespérer d’une corrida. (Arles, 5 avril 2010, Puerto San Lorenzo)
Mehdi Savalli (novillero)
C’est la novillada attendue, avec Mehdi Savalli chez lui. Cette phrase seule qui mêle des consonances étranges, un prénom marocain, un patronyme italien, des toros espagnol sur nos terres camarguaises et le tout dans des arènes romaines me transporte de joie. Je comprends qu’il puisse s’en agacer quelque fois, mais voir la Camargue, cette Camargue des Bouches-du-Rhône, terre d’élection du Front National, faire de ce novillero-ci son héros me comble d’espérance. Olè y Olé! Ouallah! Ouallah! Le revers de sa cape est vert islam, comme un drapeau marocain, et après son triomphe (une et deux oreilles, celles-là généreuses), il s’enveloppera au centre de l’arène d’une bannière blanche que ses amis de quartier avait confectionnée, comme dans ces drapés dont les hommes du désert se protègent du sable.
[…] Medhi manifeste par toutes les pores de la peau son bonheur à fouler le sable, son enthousiasme d’être là, son aguante joyeuse faite d’un courage qui n’a rien de sacrificiel- à l’inverse de tant d’autres- , son physique d’athlète. Il est la présence même, le débordement irradiant, le torero pour les autres qui paraît n’avoir d’autre plaisir que d’offrir le sien au public. (Arles, 16 avril 2006)
Montoliu de père en fils
La brega c’est d’abord Montoliu. Son père, banderillero comme lui-même, est mort dans l’arène, à Séville, un premier mai, terrassé par la corne de son poursuivant qui l’a frappé, dans le dos, en plein cœur. Sa mort en piste a jeté une désolation durable. José Manuel est son fils. Que croyez-vous qu’il devint ? Banderillero ! Ce jour au service de Curro Diaz. Et ce jour, le fils, comme le faisait le père, se pose face au toro, dissimulant les banderilles dans le dos, marche à petit pas, comme s’il voulait faire un mauvais coup, puis, au dernier moment s’élance vers la bête, marque une torsion de la taille pour le citer, l’autre vient, le torero lève les bras, cloue les bâtons dans le berceau, se dégage en courant puis freine aussitôt sa course, finissant comme il a commencé, à petits pas vers le burladero dans un geste plein de toreria et de morgue, ne méprisant nullement son adversaire, mais le danger. La Maestranza, émue autant qu’émerveillée par cette citation dynastique, applaudit à tout rompre et fait saluer le banderillero. (Séville, 22 avril 2010, Alcurrucen)
Morante (1)
L’ami Michel raconte avec gourmandise la genèse d’une telle affiche. Morante aurait l’hiver dernier téléphoné au Cid pour lui proposer de combattre en mano a mano des Victorino durant la feria de Séville et un dîner pour en discuter. Le Cid, étonné de voir l’inégal et précieux Morante souhaiter se confronter à lui, le plus grand spécialiste de cet élevage, mais, au fond, simple, modeste et sans façon n’a, à cette heure, qu’une contrariété : comment s’habiller pour ce repas avec un tel dandy ? Il consulte sa femme qui, soucieuse, convient en effet qu’il faudra faire un effort. L’histoire ne dit rien du choix vestimentaire finalement opéré, mais le conteur laisse imaginer que c’est un Cid très endimanché qui voit arriver à sa table un Morante…. enveloppé dans un long manteau de fourrure blanc, bébé phoques ou renard de Sibérie. Un à zéro pour l’excentrique, toujours à hauteur de sa réputation.(Séville, mano a mano/Vitorino Martin, 23 avril 2009)
Mort d’un taureau
Peu de chose, sauf la mort d’un grand toro, belle à voir comme c’est peu dicible. Pas la mort en elle-même bien sûr, ni cette résistance à mourir que dicte quelquefois la bravoure, le toro terrassé par l’épée puisant une énergie dernière à retarder sa chute. Non, pas ce type de mort. Celle-là n’était plus un combat, c’était une sagesse. En voyant ce Jandilla combattu par Talavante traverser le ruedo pas à pas, sans fléchir, presque sans broncher, au rythme d’un vieillard qui sait sa fin dernière et ne s’en offusque pas, souhaitant seulement en finir la tête haute, avec dignité, on songeait aux martyrs chrétiens des premiers âges. La scène était saisissante de ce toro refusant de mourir là où il avait été frappé pour s’efforcer de rejoindre les siens, de l’autre côté de l’arène, près du toril d’où il était sorti 20 minutes auparavant pour son dernier combat, ou -qui sait ?- les terres célestes des toros bravos. Cette traversée lente du ruedo n’était pas une agonie, c’était une traversée du Styx, interminable, résolue et grandiose. Chacun comprenait qu’il ne revenait à quiconque de l’interrompre ou de la profaner. Talavante était bien un peu embarrassé, nous aussi au fond, mais la noblesse de la scène nous imposait le respect. Alors, sans que l’on sache bien pourquoi, on s’est tous levé et on a applaudi à tout rompre, au bord des larmes, au bord du gouffre. Et quand le toro est tombé, on était 8 000 à lui fermer les yeux, orphelins de son mystère.
Musique à Séville
Séville restant toujours Séville, il faut cependant dire un mot de la bronca. Oh, non, pas de celles où la plaza s’étourdit de sa propre rage, généralement réservée à ses toreros, ceux de Séville qu’elle chérit toujours, sermonne quelquefois et déshérite avec violence – mais alors le temps d’une faena, ou, au pire, d’un après-midi- parce que, ce jour, le torero apathique ou couard lui fait honte ( “Le sang de mon sang! Un tel spectacle! Ne peut-il donc être digne de ses anciens, nous qui l’avons tant choyé, qu’aurions donc nous dû faire si tout cela n’a pas suffi? Ah, non, quel sort cruel! Fuera! Fuera! Je ne te connais plus, je ne te reconnais plus. Tu me fais trop de mal. Tu es la honte de la famille! Va, va et que je ne te revoie plus”) avant de se raviser dès le toro suivant parce qu’un fils est un fils, et que celui-là est d’un bon sang, que l’on est fier de le voir resplendissant dans son habit de lumière et que l’on sait de quoi il est capable, les jours avec.
Non, pas ce type de bronca mais une récrimination incertaine, presque timide, à peine osée parce que celui qui en est l’objet n’est pas torero, en tout cas il n’affronte pas les toros à pied. Celui-là est un sage et un savant. C’est le maestro de la banda de musica de l’arène et il est si savant et normalement si sage qu’il serait inconvenant de le rabrouer, comme on peut le faire d’un mauvais fils. Mais aujourd’hui on le siffle quand il joue parce qu’il n’a pas joué précédemment et que, sur ce toro-là, il a joué trop tard, quand tout était accompli.
Dans toutes les arènes du monde- sauf Madrid où l’on ne joue jamais durant le combat-, la banda de musica des arènes est appelée à accompagner la faena d’un pasodoble lorsque la présidence de la course estime que le travail du torero le mérite et qu’elle en donne l’ordre à son chef. Le maestro alors se lève et la fanfare retentit avec plus ou moins de bonheur, étant plus ou moins en harmonie avec le jeu de l’homme et de la bête. Quelquefois, le choix du paso qui porte presque toujours le nom d’une figura du toreo (Belmonte, Manolète, El Cordobès, Paco Ojeda) trace une généalogie, illustre une parenté, distinguant une manière de toréer, récompensant le torero d’un parrainage glorieux. Oui, un paso peut adouber un torero, surtout à Séville.
Mais ici, on ne donne pas d’ordre au maestro de la banda de musica,Don Tristan, Tristan Tejera. C’est lui, et lui seul, qui décide de la musique et de son moment. Nul ne conteste son titre à le faire tant il est devenu, du son des cuivres qu’il dirige, le meilleur chroniqueur de la course, jouant joyeux, épique ou grave selon ce que les circonstances lui dictent, cessant de jouer lorsque les choses se dégradent, soulignant les faits d’arme, l’inspiration ou el arte du toreo mais préférant toujours le silence à une musique qui ne serait que d’encouragement ou d’agrément. Don Tristan a ses pasos préférés, enregistre des disques, ne parle jamais et joue rarement.
Il a la retenue et l’autorité d’un oracle. Son silence nous dessille de l’illusion, de la tricherie ou de la facilité et son office nous dit la rareté du duende. Il a aussi ses fantaisies et joue quand ça lui chante, à tout moment de la lidia, sans se borner, comme partout ailleurs, à n’accompagner que le troisième tiers- celui de la faena. Un quite de cape, une demi-véronique d’anthologie, une paire de banderilles valeureuse, un toro qui charge avec alegria pour sa troisième pique, tout lui fait profit dès lors que la toreria souffle et que le moment est exceptionnel. Etant très exigeant, ce moment demeure rare à ses yeux et donc à nos oreilles.
Aujourd’hui, le maestro n’a pas joué lors de la faena del Cid au troisième à la grande déception du public- et l’on entendait, de-ci de-là quelques fort irrévérencieux “ musica!” comme si la foule pouvait, ici, s’autoriser une telle injonction ; il n’a joué qu’en extrême fin de faena pour Pepin Leria sous les sifflets du public qui lui reprochait d’avoir tant tardé à le faire; a semblé s’irriter, enfin, de la règle qui impose de jouer quand le torero plante lui-même les banderilles en servant un pasodoble suave “ Por sevillanas” tout à fait mal adapté aux rencontres entre Encabo et son faible cinquième.
Pourtant…Comment mieux dire qu’un combat avec un toro décasté ne suscite aucune forme de plaisir qu’en lui opposant, d’un contre pied ironique, une jolie sévillanne? Que le Cid sur son premier avait incompréhensiblement insisté sur la difficile corne droite qui lui imposait de rompre après chaque passe alors que son toro passait bien à gauche, qu’en faisant le silence ? Enfin, que l’on ne joue pas un pasodoble quand le torero se joue la vie, seule l’issue du combat pouvant justifier de fêter sa victoire ? Olè, y olé. Viva el maestro Tristan! (20 avril 2006)
Ola dans les arènes
Et puis, après la mort du cinquième, le public dont on aurait pu croire qu’il n’espérait plus rien de ce morne cycle se met à sautiller, debout, chacun à sa place, pour lutter contre le froid. C’est assez drôle à voir, ces grappes d’ennui qui s’agitent tout au tour de l’arène. Puis, ces grappes deviennent plus nombreuses, tout le monde est debout, et tout le monde saute, en frappant des mains. Cela amuse, cela distrait, et l’idée, tout à coup, surgit : ces nervosités, ces gigotements, ces ridelles de foule se soulèvent soudain en une gigantesque “ola” qui court tout au long de l’amphithéâtre sans souci d’un rivage où se disperser. Une fois, deux fois, trois fois. La musique se met à jouer, les gens rient sous les secousses de la vague qu’ils viennent d’inventer et qui, pourtant, les submerge, se substituant au spectacle attendu et qui ne leur a pas été offert. Elle est immense, cette vague. Nul ne veut y échapper, même les invités du palco s’y mettent. Elle est ingrate et rigolarde. Chacun y vide sa colère et sa frustration, chacun s’y lave de son ennui, chacun y puise une émotion dont il est frustré, chacun s’amuse de soi et des autres, et puis, comme un corps fourbu trop longtemps battu par les flots, l’énergie mauvaise se dissipe, la vague se charge peu à peu d’espérance et le goût de cette fête improvisée d’une attente nouvelle. Et c’est alors dans la joie que le conclave, voyant Sébastien CASTELLA s’apprêter à recevoir son ultime toro, s’assied en frappant dans les mains et en criant, sur l’air des lampions, “ SEBASTIEN ! SEBASTIEN !”, faisant injonction au torero d’inventer, lui aussi, son triomphe.
Et l’autre le fera. Belles passes de réception à la cape et faena de la casa, faite d’aguante et d’immobilité, de tres en uno approximatifs mais qui soulèvent le gradin d’enthousiasme. Deux oreilles dont on ne sait trop ce qu’elles récompensent, les “olés” ou la “ola”…(Nîmes, 18 septembre 2005/Mano a mano Rincon- Castella ).
La rue principale s’appelle calle del infante Don Fernando. “El de aqui”est-il quelquefois précisé sur les plaques!
La plaza de brique et de chaux rappelle par le rythme de ses ouvertures sur l’extérieur, ses galeries couvertes de tuiles beiges, son sable ocre et ses élégantes tribunes, la Maestranza. Depuis les places à l’ombre, les grands arbres du parc qui jouxte les arènes dessinent un auvent au-dessus des tuiles pâles ; le soleil du soir aiguise l’éclat distinct de ces verts qui se mêlent, comme une vague suspendue. Est-ce la présence de cyprès? Cette arène andalouse baigne dans une atmosphère toscane qui lui confère une harmonie et une quiétude singulières en tauromachie. Son aficion n’est pas un combat, ni une exigence; elle est là, comme un écrin qui serait offert aux toreros qui voudront bien y paraître, pour ressusciter le souvenir d’élégances du passé.
Plaza de toros d’Antequera (2/ L’aficion)
Les aficionados d’ici savent que l’arène est de troisième catégorie et qu’ils n’y verront jamais des toros du trapio de Séville ou de Madrid. Bilbao, Ceret ou Vic ne font pas partie de leur imaginaire. Ils s’extasient en disant que Malaga est de première catégorie et, au seul énoncé de ma bonne ville de Nîmes, ils s’exclament admiratifs : “Là, il y a des toros!” On sent seulement, à un rien de retenue, une fois cette politesse faite, qu’ils ne sont pas loin d’estimer, par devers eux, que la vie est mal distribuée et que ces toros qui sortent à Nîmes seraient plus profitables à l’aficion d’ici!!
Ils savent que leur aficion et la tradition de cette plaza ne leur permettent pas d’exiger beaucoup plus que le bétail qu’on leur donne. Ils le regrettent sans doute, mais s’en font une raison: c’est la condition des cartels de luxe qu’on leur offre. Ponce, El Juli, Morante ou, jadis, Curro ou Rafael ne viendraient pas affronter, ici, autre chose que des toros anovillados ou afeités. Mais, comme tous les Espagnols, ils n’oublient pas que Manoletete est mort à Linares et Paquirri à Pozoblanco, que la corrida est toujours un combat contre l’aléa, que tout peut y arriver et que seul le destin commande. L’aficion , ici, est admirable de noble abnégation. Comme à la cour des Angleterre, c’est “Never explain, never complain”.
Alors, ils font fête à leurs toreros, ils les applaudissent, ils les encouragent quand il le faut, ils crient “TORERO! TORERO!” aussi fréquemment que le plaisir le leur dicte, réclament à tout coup deux oreilles quand l’une est accordée et ne se font aucun souci à voir le président quelquefois dodeliner de la tête, comme s’il s’apprêtait à leur refuser cette récompense : ils savent que c’est un bon président et que pour rien au monde il ne songerait à leur gâcher la fête.
On ne passerait pas toute la vie dans un salon de thé, pas plus qu’à ne voir de corridas qu’à Antequera, mais quelle fête et quelle joie! (20 août 2005/ Manzanares, Espartaco, Rivera Ordonez).
Perdre le sitio
« Perdre le sitio », pour un torero, c’est comme pour nous autres, frères humains, perdre la main. On ne sait trop pourquoi, lassitude, faiblesse, dépression ou préoccupations diverses, mais ce qui était possible ne l’est plus. On le sent, ça se voit, et on n’y peut pas grand-chose tant que l’on n’en sait pas la cause. Les toreros vont-ils en psy ? Je ne sais. Mais ce qui est sûr, et triste, c’est que le Cid a perdu le sitio, comme il peut arriver à chacun de nous de perdre la main.
Ponce (1)
Ponce a été énorme et Séville, ordinairement si réticente à se rendre à sa tauromachie technique, à ses gestes d’une froide précision chirurgicale, et moi à sa muleta large comme un drap de lit et -pourquoi ne pas l’avouer ?- à sa mine de programmeur en informatique, sommes à genoux, une porte des Princes ouverte dans nos coeurs, seule la malchance à l’épée l’ayant privé d’une sortie sur le Guadalquivir.
Il y eut d’abord ce premier toro d’une violence inouïe, qui ruait, débordant d’une caste sauvage indomptée, les pattes en avant dans le capote de Ponce, a désarmé un péon d’une cornada criminelle qui a cisaillé l’air comme un cimeterre ottoman, a ensuite désarmé Ponce lui-même, menaçant, la tête haute, celle du cheval à la pique, et qui paraissait ne rien craindre de l’un puis de l’autre châtiments, des piques puissantes et sans retenue dans lesquelles le picador mettait toute cette énergie que l’on puise à l’odeur du danger quand il ne fait place qu’à l’effroi d’un instant qui peut être le dernier, le cheval cabré en dépit de son caparaçon, Saint Georges terrassant le dragon, non loin de deux capes roses sur le sable, traces de combattants défaits, et des visages du péonage, les traits déformés par la peur, sous un ciel gris et menaçant.
Une troisième pique s’impose qu’autorise la présidence. Le toro est conduit face au cheval et quand le piquero lève le bras pour le citer à nouveau, Séville, soudain, proteste et s’y oppose. Comme une bande de gangsters qui exige de l’inconnu souhaitant la rejoindre un fait d’arme exceptionnel lui valant droit d’entrée. Quelle réaction curieuse pour un si fin public…
Ce toro est un tueur et Ponce n’a plus rien à prouver. “Eh bien voyons!” crie la foule à ce numéro un qui ne fut jamais le sien. Ponce se plie sans résister à cette provocation et sollicite de la présidence le changement de tiers. Au palco, le mouchoir blanc tombe sur le velours grenat : le sort en est jeté, il n’y aura plus de pique, c’est à toi désormais torero de faire ton affaire de ce monstre. L’élégante Maestranza l’exige de toi, comme une châtelaine en son donjon rêve d’éprouver elle-même la réputation du valeureux guerrier.
Aux banderilles, le public est suspendu à la sauvagerie de la charge, n’étant soulagé que lorsque les peones, après avoir planté les bâtons tant bien que mal, parviennent à la talanquera.
Ponce prend la muleta et l’épée, va saluer la présidence et commence son combat par des doblones dont le geste sûr et l’efficacité font rugir la plaza. Passes de châtiment dominatrices, jeu de jambes avisé, muleta de combattant, puis le fauve se rend, sinon sur la droite, du moins sur la gauche, une, deux, trois séries de naturelles, ponctuées, chaque fois, de pechos profonds qui libèrent la charge de la bête et l’émotion des spectateurs, lesquels se frottent les yeux de voir ce torero jouer maintenant avec un toro à sa main, comme ces magiciens qui, d’un mouvement du poignet dans un mouchoir blanc, font d’un lapin une colombe.
Malchance à l’épée, non concluante, qui oblige au descabello, et un ne suffira pas. Pas d’oreille mais qu’importe. Comme dans les westerns, lorsque la bande a commis l’erreur de fixer à l’inconnu un droit d’entrée trop élevé, celui qui est parvenu à en payer le prix rafle la mise. D’une faena Ponce est devenu chef et on ne se souvient plus qu’il ait eu un prédécesseur. Vuelta triomphale et Séville, à son tour, se rend, dans l’éblouissement et, désormais, sans rancune.
Mais Ponce ne devait pas en rester là et son second toro (le quatrième de la course) devait lui octroyer le triomphe. Séville y était enfin prête. (21 avril 2006 face à des Zalduendo)
Ponce (2)
Il est d’usage désormais, à Nîmes, d’applaudir Enrique Ponce dès la fin du paseo. On ne se souvient plus très bien pourquoi. Il n’a jamais été le torero de Nîmes comme l’avait été en son temps Paco Ojeda qui avait signé ici ses plus grands triomphes, ou Emilio Munoz dont le club taurin a si longtemps enflammé les nuits de la feria nîmoise, ou encore Joselito que l’aficion locale a toujours attendu avec patience et respect, lui ayant offert mano a mano ou un contre six, aux résultats souvent aléatoires mais dont aucun n’a déprécié le cartel. Non, avec Ponce, ce serait sans doute plutôt l’inverse. On l’applaudit par remords de l’avoir fait si tard, quand l’aficion partout ailleurs rendait des hommages tonitruants à sa régularité, à son beau cartel de torero de transition, de basse époque, la mine triste et la muleta large comme un drap de lit, savant et valeureux, sans doute, mais sans vraie profondeur, sans romantisme, étranger à l’épopée et complètement dépipolisé.
Ses très grands triomphes, ailleurs qu’à Nîmes, dans sa deuxième partie de carrière, et peut-être surtout la tardive reconnaissance sévillane en avril 2006, ont libéré ses fans d’ici et nourrit les scrupules des autres. Le torero reprenait des couleurs, sa longévité lui donnait une patine nouvelle, comme ces rois sans gloire des temps anciens que l’histoire a finalement récompensés pour leur long règne sans crime. (Nîmes, 10 mai 2008)
Talavante (1)
Talavante n’est pas dans le quota des jolis garçons mais, pour peu que l’on soit chanceux, de lui, on se souvient. Inégal, à la recherche d’une tauromachie hiératique, dédaigneuse des vanités de ce monde, il porte sur un visage à la Philippe II, prognathe et sans éclat, le détachement des martyrs sans gloire. Son corps aussi est d’un autre âge -quand celui de José Tomas est si contemporain-, noué, arthriteux, comme abîmé par les désolations d’une retraite à l’Escorial. Enfin, les jours de triomphe, son sourire est laid, sans joie ni charme, un sourire par ce qu’il faut bien remercier, comme le pauvre la main secourable. Tout en Talavante est du XVII ème siècle. Une toile de Vélasquez. Le chevalier à la triste figure et le gueux, tout en un. (Nîmes, 19 septembre 2009, Le Pilar)
Talavante (2)
Il faudra les protestations du public qui, à son second, lui refuse la musique dont la présidence le récompensait généreusement pour que le torero soit appelé à de plus fortes exigences.
Alors, près des tablas, piqué d’orgueil, il avance à petits pas, tout près de la corne. Puis entre les cornes. Puis au-delà de l’autre corne, pour toréer comme il sait le faire, en se plaçant dans des terrains inouïs qui défient l’entendement et hypnotisent la foule comme si à chacun de ses gestes, réduits au minimum mais au-delà de la ligne du sacrifice, on attendait, interdit, que le destin frappe l’enfant qui gambade dans un champ de mines.
Cette deuxième moitié de faena n’est plus un combat, c’est une attente angoissée face aux cornes, la respiration suspendue que nulle passe ne libère car quelques pas de plus du torero annoncent déjà une autre passe, plus serrée, plus éprouvante. On ne sait s’il convient d’applaudir le torero, on ne sait plus d’ailleurs si l’on en a bien envie, s’il s’agit d’une fête ou d’un suicide, d’un jeu à deux ou de la prouesse folle, opiniâtre et déraisonnée d’un trapéziste sans filet, d’un “joueur” à la roulette russe. Le public, taisant d’effroi, se libère à la mort et réclame une oreille, attribuée.(Nîmes, 9 mai 2008, San Lorenzo)
Torero contre le temps qui passe (1)
Le second toro d’Espla sort plus que faible et le public sollicite le changement dès la première pique où il s’affale. Espla résiste et, face à la foule contraire, fait signe qu’il entend planter les banderilles…sans musique. Première paire : Espla souhaite fixer le toro a cuerpo limpio, court en cercle autour de la bête, le bras tendu entre ses cornes pour en ralentir la charge, mais le peonage s’en mêle, qui doute du réalisme du maître, à la grande fureur de celui qui se trouve ainsi privé de la prouesse espérée. Deuxième paire, et même doute du peonage sur l’aptitude torera. Un quite subreptice et hop le toro est fixé! Espla, excédé, arrache une nouvelle paire de bâtons qu’il plante dans un por dentro serré avant de tenter une nouvelle fois de fixer le toro. Le peonage, qui parait préférer un licenciement pour faute à la mort du patron, intervient à nouveau. Espla, humilié par ces quites, qui sont autant de réserves manifestes sur ses capacités et d’objections publiques à son commandement, sollicite la pose d’une quatrième paire que la présidence, amusée comme l’arène, n’a pas le mauvais goût de lui refuser. Cette fois, le peonage se rend, comme nous tous. Et Espla, a cuerpo limpio, arrête l’animal d’une main sur le frontal, face à une arène folle de joie du triomphe du torero sur son âge et de l’obstiné combat qu’il a entendu mener jusqu’à son terme contre le regard des autres, le plus lourd des fardeaux.
Espla, un air de majordome de grande maison, et qui en connaît tous les secrets, goûte la versatilité de la foule. La présidente chipotera pourtant l’oreille que cette ultime facétie à la Malagueta méritait bien.(Malaga, despedida, 23 août 2009)
Torero contre le temps qui passe (2)
Espartaco a peur, lui aussi, de chacun de ses adversaires – des novillos outageusement afeités que le public juge avec tristesse mais sans rien manifester. Mais le public se souvient de son cartel, alors il le soutient, l’encourage et, toujours assez peu sûr de lui, le torero se force à lui faire plaisir, à tenter quelque chose, à s’approcher plus près, à ne plus bouger cette putain de jambe quand le toro s’enroule dans sa cape. Cela marche, le toro vient mieux, imbestit et à droite et à gauche. Reprenant confiance, soutenu par les olés des tendidos qui mesurent cet effort du torero sur lui-même, on retrouve alors un Espartaco inchangé, comme avant, comme s’il n’avait pas quitté l’arène, poderoso, technique et à l’enthousiasme d’un novillero. Non rien n’a changé, il n’a rien oublié ; il le démontrera aussi à la muleta, sauf cette putain de trouille dont il ne peut se débarrasser tout seul. Alors le public l’aidera encore, et encore le toro passera, et ce goût retrouvé de la passe sûre, templée et dominatrice lui reviendra.
Ce dialogue – comme une perfusion d’aficion du public à son torero- est absolument bouleversant. Et le public sera inondé de bonheur à voir ce torero qu’il a réinventé tenir serrée à deux bras sur sa poitrine l’oreille qui le récompense de son combat et de sa lutte victorieuse, la seule qu’il avait à mener, la lutte contre sa propre peur. (Antequera, 20 août 2005)
Torero contre le temps qui passe (3)
On se demande quel est le ressort qui conduit Manzanares, après une si longue et indolente -quoique brillante- carrière, à paraître, à son âge, la taille encore faite mais le visage bouffi et rubicond, dans une arène. La peur lui déforme les traits, sa respiration est celle d’un condamné face à l’échéance et, évidemment, il ne fait rien. Une fois la peur passée, c’est à dire aux toros des autres, il n’en fera pas plus, se dégageant à peine des tablas durant le tercio de banderilles. Le public tait son exaspération face, non pas au désastre- qu’ici on peut comprendre- mais à cette absence totale de toreria, à ce déplaisir si manifeste d’être là. Il ne reste de celui qu’il a été que cette absence de verguenza qui l’a tant de fois caractérisé. Silence poli à ses deux.
[Mais quelques instants plus tard…] Autre “toro” bon bon, avec plus de gaz. Paco Rivera Ordonez l’entend à la cape, notamment lors d’un beau quite par chicuelinas et n’a pas d’autre réflexe que de partager aussitôt ce sorteo favorable avec Manzanares, qui a fait si pâle figure cet après-midi. Il lui fait signe, l’autre avance et tire trois chicuelinas de la casa, dessinant avec une douceur extraordinaire- comme si le geste se déroulait au ralenti- les arabesques de l’étoffe basse, laissant la bête ivre à ses pieds. Le public se lève, comme un seul homme, condamné à rendre grâce à cet ingrat. (Antequera, 20 août 2005/ Manzanares, Espartaco, Rivera Ordonez)
Torero gitan
On se garde depuis Hemingway d’y revenir mais le préjugé est tenace : le torero gitan serait peu conventionnel, tout d’inspiration, couard ou bravache, selon les jours, les deux le plus souvent à la même minute, irrégulier, très gravement irrégulier, à tous les sens du mot, mais c’est aussi, c’est surtout, un immense artiste. Rafael de Paula, Curro Caro, Aparicio, et tant d’autres avant eux. Le préjugé est si tenace qu’il cimente une forte complicité entre le torero gitan et les aficionados. On n’attend rien d’un torero gitan, on sait qu’il ne faut rien en attendre. On attend seulement que ce soit son heure, qu’il en décide ainsi, quand il le voudra, aujourd’hui devant un toro astifino, ou dans trois ans devant cet autre con casta, sans qu’aucune rationalité n’ait sa part dans le choix de l’instant, si longtemps différé, mais alors de grâce. On attend comme on le fait pour un guitariste ou un cantaor flamenco. Ca peut venir, ou pas, ça peut venir un peu ou surgir soudain, comme l’eau que découvre le sourcier. Mais alors, d’un coup, tout se met à trembler.
La certitude de ce mystère apaise les aficionados que jamais l’échec du torero gitan ne déçoit. Les plus toristas des afionados ne font pas exception à la règle. Ils n’aiment pas moins que les autres le torero gitan, parce que, comme tous, ils savent que le jour « où ça veut»….. Les aficionados goûtent aussi les déroutes du torero gitan, parce qu’elles sont souvent grandioses, et au vrai, chaque fois différentes, aussi insoupçonnées que ses triomphes. Ils s’amusent de sa frousse, de ses mimiques, de cette tête qui dodeline, des ses bras grands ouverts qui prennent le public à témoin que c’est impossible, là vraiment impossible ! Ils s’en amusent, pas par méchanceté mais par mimétisme.
Car c’est un autre mystère de l’irradiation gitane que le public finisse par ressembler au torero, irrévérencieux là où l’autre néglige la convention, braillard et persiffleur quand l’autre gesticule en courant sans façon vers ses peones qu’il injurie comme un charretier, n’hésitant pas, lui le public, à interpeller le maestro avec familiarité, dans une complicité de registre où il faudrait commencer par le vulgaire. En attendant le duende.
Le vieux peon
Alors, rien ? Si ! Il y avait ce vieux peon, le vieux peon du Cid. Enfin, vieux, disons de mon âge ou à peine plus. Grand, de belle allure encore, les cheveux blancs, légèrement voûté, dans un habit gris perle et argent qu’il porte aussi bien qu’il porterait un costume du ville ou le traje corto des paysans. Qui court légèrement penché vers l’avant, économe de ses gestes mais attentif à tout, discret comme un majordome de maison anglaise. On le voit mais on n’y prête guère attention. Il est comme une ombre pâle dans le ruedo, un double transparent du torero qu’il sert. Voyons le, cape en mains, dans une brega sûre, face au toro qu’il ménage ; transmettre les messages au piquero ; derrière le burladero veillant sur son maestro. Et c’est lui, à la pique sur le sixième, quand le toro renverse la monture, le piquero à terre, les jambes prises sous le cheval immobile, les deux monosabios qui tentent de protéger de leurs mains nues leur animal des assauts répétés du toro, Juli et El Cid tentant d’intervenir en vain, qui parvient, un peu tard – ah, l’âge…- mais assuré, à éloigner le danger.
Je ne connais pas le nom de ce vieux peon, ni sa carrière. Quel âge peut-il avoir ? Que fait-il encore dans le ruedo ? Pas envie d’une jolie retraite, d’un peu de repos ? S’ennuierait hors le sable et le sang ? Sait pas quoi faire d’autre ? A d’emblée choisi l’habit de plata ou l’or lui a-t-il été refusé ? A-t-il femme et enfants ? Dans ce cas, ceux-là sont sans doute en âge de se marier. Profession du père ? Que disent-ils à leur future belle famille ? Torero ? Peon ?
Torero, claro ! La fidélité à ce métier, la sûreté du geste, ces cheveux blancs sous la montera furent pour moi la seule lumière du jour. La flamme d’une bougie dans une crypte obscure, comme un maigre signe d’espérance à quoi la foi se réchauffe. Je m’apercevrais quelques jours plus tard, à Madrid, que ce péon, c’est El Boni que j’ai connu torero il y a vingt ans. Le temps passe… (Nîmes, 17 septembre 2010, Garcigrande et autres)
Vista Alegre
Un faux air de ville de province de nos manuels d’espagnol des années 70, des avenues de capitale, larges et ombragées avec des immeubles hauts aux façades placardées de bow windows, et ici ou là des boursoufflures fin de siècle comme à Madrid. On sent que les années 1880 furent prospères. La gare et ses voies ferrées sont un fleuve qui traverse la ville quand le rio Nervion paisible, tout en ondulations douces, étrangle lentement le vieux Bilbao, coupe-gorge de rues étroites, sombres et humides, mi-Naples, mi-barrio Chino. Ici, les rues ont pour nom « libertad », «autonomia » ou « Hugo Chavez », et le drapeau basque est partout. Au Nord, suspendu, comme saisi au-dessus du fleuve, un soulèvement tellurique aux rondeurs de caravelle galactique, une Santa Maria en titane : le musée Guggenheim.
Une arène qui surprend : à l’extérieur, une armure de béton en écailles, avec pour seule fantaisie une frise de devises de ganaderias. A l’intérieur, les couleurs mal assorties d’un jeu de Lego : barrières vermillon et blanc, contre-piste crème anglaise, balcons coquille d’œuf à larges bandeaux rouille, et des gradins de béton brut couverts de sièges bleu ciel. Le ruedo, lui, beaucoup plus petit qu’à Madrid, Séville ou Malaga, est couleur taupe : on sent que les choses sérieuses commencent.
Mais pas tout à fait encore ! Au paseo, les deux agualziles sont précédés par une jeune fille à cheval vêtue d’une cape de velours vert. C’est elle qui salue la présidence, récupère la clef du toril, et offre leur récompense aux toreros. Les mules de l’arrastre sont emplumées aussi haut que Lisette Malidor, suivies par une armée d’areneros tout de blanc vêtus, taillole et béret rouges. Les clarines sont en redingote rouge et une musique maigre de sardane accompagne le tercio de banderilles lorsqu’il est pratiqué par les peones.