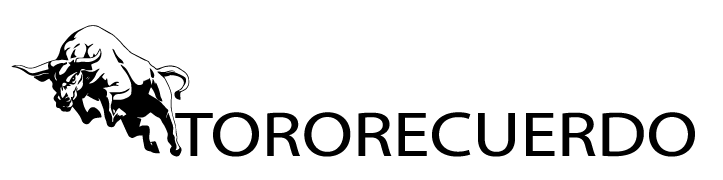Malaga, 15 août 2017 – Paco Urena, Javier Jimenez, José Garrido/ Fuente Ymbro
Première corrida depuis la mort de Fandino. Malaga est mon arène préférée, le cœur intime de mon aficion, mon île cachée que je ne partage qu’avec mesure, mon trésor secret. Et c’est cette arène que j’ai choisie comme dernière chance d’une convalescence possible : réparer mon aficion, m’extraire d’un deuil trop douloureux qui m’a fait beaucoup douté du bien-fondé éthique de cette passion d’un peu plus de trente ans. Je le fais pour mes amis, plus que pour moi. Ne sais trop comment l’expliquer. La peur de les perdre sans doute si je n’allais plus aux arènes. Après tout, on ne sait jamais si les sacrifices du veuvage procèdent d’une digne fidélité ou d’une vilaine déprime. Peut-être est-ce une déprime… Alors, un jour on se laisse convaincre et on retourne au bal. On va bien voir.
Hélas, l’arène est aux trois quarts vide. Mais dès le paseo, la musique flatte des impressions agréables, une vie qui défile, l’émotion à fleur de peau, un mano a mano Curro Romero/ Paco Ojeda, Espartaco auquel on refuse la deuxième oreille et dont le père tente en vain d’escalader le palco présidentiel pour casser la figure du président, les banderilles d’Espla, les doutes de Joselito avant sa retirada, croisé plus tard dans la soirée sur les allées du Paseo del Parque, Javier Condé découvert novillero puis vu seul contre six avec la muleta blanche, un jour de pluie, José Tomas, vu trois fois ici, dont deux le jour de son anniversaire et toujours triomphant, une faena de Morante, et tant d’autres choses.
Les Fuente Ymbro sont bien sortis, très joliment présentés quoique d’un lot disparate (de 486 à 580 kgs), 4 sur 6 nobles et offrant du jeu, 2 plus exigeants. Corrida entretenida mais les hommes ont été en dessous des toros, sauf Urena. Il faut toujours se méfier des apparences. Le cheveu ras le front, le nez pointu, le cou dans les épaules, un regard de chien battu, ce torero dégage une impression de fragilité et de tristesse infinies. Quand il marche, c’est à petits pas, mais d’un petit pas tout sauf solennel, un petit pas de timide ou de Pierrot lunaire. Il avance en balançant drôlement les jambes en avant, dans un mouvement suspendu, un peu éthéré, mais en cadence et à la raideur militaire, donnant l’impression que seul l’effet de balancier parvient à entraîner un corps qui résiste. Urena, c’est une silhouette de mannequin articulé dont on aurait perdu les fils. Et qui se trouve là contre son gré. Auquel le ruedo serait infligé.
Mais qu’un toro paraisse et cette silhouette devient torero de verdad, un des plus engagés qui soit, toujours dans le sitio, croisé comme un belluaire. Sa faena sur le premier, cornivuelto, très bien fait, toréé sans zapatillas -même les timides ont leur fantaisie- était gorgée de toreria. Position centrée, main basse, grand temple et beaucoup de mando, la muleta près du corps : le torero et la codicia du toro donnent au tout des effluves de toreo grande. Les quatre séries à droite sont émouvantes de sitio, de poder et de beauté. Le toro est plus récalcitrant à gauche. Penché sur son ouvrage, croisé, Urena insiste et gagne en servant une naturelle océanique. Le toro se fige en cours de passe ? Le torero menacé aguante sans broncher, et reprend le cours de sa faena conclue par bernardinas et trincherillas de toute beauté. Epée fulminante. Une énorme oreille avec pétition de la deuxième non accordée. Vuelta en zapatillas.
Deuxième faena d’une même eau mais plus irrégulière notamment à gauche où le tout manque un peu de liaison. Mais des derechazos de macho, jambes écartées, où Urena cite son adversaire depuis le centre, avant de l’embarquer, et un changement de main avec naturelle vibrante à suivre restent dans l’œil cinq jours après. Autre grande épée. Oreille réclamée avec force et non attribuée par une présidence inflexible mais avec critères – ça nous change ! Boudeur, Urena ne veut pas sortir saluer, s’y résout sous la pression, fait sa vuelta des larmes de colère dans les yeux et ne cessera pendant le combat suivant de son compagnon de prendre à partie tous les hommes qui l’entourent dans le callejon pour se plaindre de l’injustice. Cet homme est un fiévreux, comme souvent les grands timides…
Son compagnon suivant était le blond Javier Jimenez, l’Andalou de l’étape, très soutenu par l’aficion locale et qui temple bien, comme on aime ici, mais sans liaison et le plus souvent avec trois pas en arrière entre chaque passe. De très belles naturelles a camera lente devant son premier, brave, noble mais très affaibli par la pique ensuite d’une vengeance idiote du piquero qui s’était laissé surprendre sur la première rencontre – bousculé à nouveau sur la seconde, il en perd ses étriers et pique littéralement couché sur son cheval , les jambes flottant au-dessus de l’arrière train de sa monture, dans une scène de grande exaltation collective (saludos), et une jolie faena sur le suivant dans le style Espartaco, très templée, bellement rytmée, mais toujours un peu décentrée (saludos).
Garrido m’a beaucoup déçu. Il est certes tombé sur le lot le plus exigeant, avec un premier tardo, vif et brutal, et un second manso, gratteur et peu coopératif mais les deux avaient leur faena, que le torero, pas très allant en dépit d’un merveilleux habit écru aux parements noirs en forme de ramages baroco- sud américains, n’a pas su ou voulu trouver. Débordé sur le premier, il a davantage pris sur lui sur le suivant qu’il avait reçu par largas affaroladas de rodillas et un bouquet de véroniques dominatrices, mais on sentait que le trasteo lui coûtait, et n’étant ni à Madrid ni à Bilbao il a abrégé.
Malaga, 17 août 2017, Picasiana- Enrique Ponce, Javier Condé/Juan Pedro et Daniel Ruiz
La féérie n’est pas la réalité, c’est à ça qu’on la reconnaît ! Et c’est pour cela qu’elle enchante. Il ne fallait pas venir à cette corrida avec des semelles de plomb. Ceux-là, les forçats de l’aficion, les virils du Vallespir, les bagnards du tercio de piques, les fans de l’intoréable, les saliveurs du terrorifique, devaient rester à la porte de la Malagueta. Cette corrida n’était pas pour eux. Mais Dieu, pour tous les autres, si nombreux ce jour (une des plus belles entrées du cycle en dépit de la présence de l’incertain Javier Condé), quel spectacle !
Dont Enrique Ponce fut le maître d’œuvre. C’est lui qui a tout décidé, tout organisé, tout conceptualisé. Puisqu’il y a concept comme on nous l’a bien expliqué. Pas la partie d’emblée la plus convaincante certes, mais il faut bien en dire un mot. Le concept, c’est celui de la corrida totale (toreo, costumes, peinture, musique, tout en fusion) en un temps où le mundillo se convainc, à tort ou raison, que la corrida tout court ne suffit plus à remplir les arènes, les aficionados étant une espèce en voie de vieillissement sinon de disparition, de sorte qu’à défaut de trouver un nouveau public il nous faudra bien un jour fermer les portes ! Le mundillo, qui vit du spectacle, se lance, telles les boîtes qui flanchent, dans le marketing, le packaging et autre chasse aux prospects, comme on jette une bouteille à la mer. Alors, cette corrida est dite « Cristol ». C’est la marque déposée….
D’abord, les badigeons de la Picasiana – corrida traditionnelle à Malaga en hommage à Picasso. C’est cette année l’artiste français Loren Pallatier qui a décoré la talanquera de ses œuvres, des trempés de muleta dans de la peinture, et de part en part des imitations d’encre de Chine, avec les muletas/pinceaux suspendues au-dessus du patio de cuadrillas, comme du linge à sécher dans les rues de Naples – le tout néanmoins assez discret et plus réussi que sa déco d’il y a trois ans avec les visages de Picasso, trop présents. Puis les costumes, mais seuls les peones sont en habit goyesque, pas les matadors, on ne comprend guère pourquoi. Enfin, la musique. C’est la vraie nouveauté. Foin du pasodoble, on veut de la variété, de la musique de film, du classique, un philarmonique, des chœurs, une soprano, des flamenquistes ! La banda Chicuelo II de l’ami Rudy qui a inventé le genre n’a qu’à bien se tenir ! On a, lors de cette « Cristol », entendu du Brel (« Le Rêve impossible » de « L’Homme de la Manche » ), du Barbara (« L’Aigle noir »), de l’Aznavour (« She » dans Notting Hill), du Julio Iglesias (oui,oui), « Mission » de Morricone et le « Concerto d’Ajanjuez » bien sûr, désormais des classiques dans le Sud Est de la France, mais aussi « San Juan de La Cruz » et même le « Panis Angelicus » de César Franck sans oublier un inattendu « O Fortuna » du Carmina Burana pour le paseo, ce dernier sous quelques sifflets épars tout de même. C’est bien beau, merveilleusement exécuté, de très grande qualité mais, pour sûr, cela sature vite le ruedo d’émotions qui tiennent autant sinon plus à ce que la musique suggère qu’à ce qui s’y joue « a musica callada » comme le disait Bergamin qui ne s’y serait sans doute pas bien retrouvé.
Le concept « Cristol », c’est cela. La saturation. Des volutes d’opium anesthésiantes. Mais bon, à être dans une fumerie, autant se laisser aller.
Et la féerie fut ponciste, comme on ne peut guère le raconter.
C’est Ponce qui a convaincu Javier Conde de rependre l’habit pour l’occasion. On ne pouvait imaginer mano a mano plus singulier. L’eau et le feu, l’impeccable science du maître et les géniales mais désordonnées saillies du cancre, la soie et la lame. Ponce est le parrain du fils de Condé et d’Estrella Morente. Ami fidèle, il a su trouver les mots, et voilà Condé qui paraît à ses côtés au paseo, dans un merveilleux habit noir aux éclats de diamant. Ponce fut pour lui, toute la corrida, son apoderado, son peon de confiancia, penché derrière le burladero pendant que Condé torée, un ami lui infusant le courage qui lui manque ou la science qui lui fait défaut, un frère le déniaisant d’une quite sur son toro pour lui monter que celui-ci peut servir, ou un compagnon l’encourageant d’une tape sur l’épaule quand ça se passe bien.
Et Conde en effet a ressurgi. Dans l’incertitude et des éclairs de foudre ; entre la frousse qui lui marque le visage et les inspirations où il se retrouve. Entre tremblements de couard et ébranlements du duende. Discret à la cape, sauf un quite sur le premier toro de Ponce, oh presque rien, deux véroniques, une demie et un desplante, mais le tout d’une allure folle qui fait rugir la place, et un bouquet de véroniques de cartel, muy paulistas, sur le dernier où soudain el arte vous pète à la gueule. Pour le reste, le toreo de Conde a été comme à l’accoutumée tout de ruptures, de lignes brisées, de fulgurances, souvent de demi-passes. La beauté et le génie de son toreo c’est le tissu qui se dérobe, pas celui qui accompagne. Sa manière n’est pas de jouer le jeu, c’est de le rompre. Sa passe est une caresse sans finition, dont la violence tient précisément à l’inachevé, à la frustration à quoi elle vous laisse suspendu. Il y a dans cette manière une volupté. La volupté sadique d’un amant magnifique qui jouit de voir un corps se tendre sous ses charmes et en reste là. Pour recommencer à l’occasion, sans jamais en finir, sans jamais conclure. Son toreo se nourrit de l’illusion du revenez-y, mais le revenez-y n’est jamais sûr. Sa marque est la décharge électrique, l’attente fiévreuse, l’imposture grandiose.
Sa première faena sur le toro que Ponce lui a fait découvrir d’un quite sera, à cet égard, une leçon de choses. Un changement de main de grande allure et pour faire quoi de la gauche ? Non pas une naturelle interminable mais un desprecio, venimeux, de châtiment ! Le geste d’un souverain. Et puis deux brèves séries de naturelles, le bâton comme suspendu à la main, tenu à l’oblique, le tissu au plus près du corps, lui, le torero, vertical et relâché, dessinant non plus une passe mais un ensorcellement de cercles de feux. On avait précédemment vu Ponce faire des merveilles, mais c’est à cet instant que la Malagueta avait les larmes aux yeux (vuelta).
Fera le clown sur le suivant, un petit toro de 465 kgs mais à la charge brutale. Un clown inspiré par instants. Sur le Concerto d’Ajanjuez, au milieu de mille précautions, soudain deux derechazos comme tombés du ciel, et une trinchera, après quoi Condé, effrayé, part en courant, s’arrête 10 mètres plus loin et mime alors un desplante dépourvu de sens mais muy flamenco. Un peu plus tard, deux autres, les jambes écartées, des derechazos de macho dont il sort étonné, regardant à droite et à gauche comme s’il cherchait à cet instant le ressort du miracle. Irrésistible ! puis tout va un peu à vau-l’eau (silencio).
La dernière faena sur un Juan Pedro très armé sera de gala après des véroniques et une demie d’estampe, très centrées, vibrantes, de grande allure. Eclats de diamant noir à la muleta. C’est son épouse Estrella Morente qui chante « Mientras que tu toreas, voy a sonar ».. Manifestement, ça le perfuse de duende. On le voit après une courte série de la droite (une paire de derechazos, une trinchera) saluer la foule comme un chef d’orchestre le fait en fin de concert, inclinant le buste, se redressant les bras levés, dans un geste ample de reconnaissance à l’armée invisible des anges qui l’ont accompagné. A gauche, des naturelles envoûtantes, les plus toréées de l’après-midi sans doute, après quoi il abrège alors que son adversaire, allant et de grand jeu, avait encore trois ou quatre séries à donner. Une épée défectueuse le prive de trophée pour cette faena toute d’évaporation inspirée (saludos).
Quant à Ponce. Comment dire ? Un seigneur en majesté sur ses trois toros dont deux (de JPD le premier et le cinquième) d’une classe infinie quoique flojitos. Pour moi, le meilleur de Ponce depuis Séville en 2006. Limpidité de la construction, soin dans l’exécution, technique inouïe qui se fait oublier par l’évidence d’un accord parfait avec ses adversaires qu’il sait ranimer, entretenir, grandir dans des faenas, sans vrai toreria mais au jeu somptueux d’intelligence et de limpidité de lignes. Verticalité, relâchement, temple, il est l’envers de Conde : tout chez lui est aboutissement. Pas le genre à laisser quoique ce soit en suspens. Sa passe ? C’est « Je te raccompagne chez toi, je t’amène dans ta chambre, je t’allonge dans ton lit, je te borde et je veille sur ton sommeil, si tu veux bien ». Cette sollicitude de chevalier-servant qui dissipe toutes préventions a des vertus anesthésiantes. On sombre dans le rêve, dans le songe, tout devient soyeux, cotonneux. On est dans le chatoiement et dans les limbes.
Le miracle qui s’est produit sur le cinquième tient à ceci que le torero lui-même s’est laissé hypnotiser par le charme puissant qu’il distillait en toréant. Pas la moindre scorie, pas le moindre replacement après la passe ou la série- Ponce ne consent jamais à se replacer, la distance plus que le sitio est sa spécialité, et s’il lui faut rectifier la position, sa grande muleta le lui permettra sans qu’il ait à consentir un pas de plus ou de moins, c’est son toro qui devra se plier à sa volonté. Ponce sur un nuage donc, en trois séries de la gauche, inouïes de tracé, de douceur et de lenteur. La première fera se lever la moitié de l’arène, la seconde l’arène tout entière. La troisième où il joue du pico de la muleta sur le sol, à l’envers puis embarquant son toro d’un mouvement de poignet remettant le pico à l’endroit dans une passe interminable et comme suspendue, met la Malagueta en ébullition : 8 000 personne debout et hurlant « TORERO, TORERO,TORERO » et pluie de sombreros cordouans sur le ruedo. On n’entend plus la musique ; c’est la fusion, le délire. C’est encore la commotion quand Ponce fait ses poncinas, pour une fois d’évidence, puis on le voit aller à la barrière, on croit que c’est fini. Non ! Le voici qui revient une cape en main. Pour faire de nouvelles poncinas avec le capote ! C’est beaucoup moins joli mais la tocade où Ponce s’oublie fait plaisir à voir. Il est comme nous, il succombe, il transgresse. Il est ailleurs. Il va chercher l’épée et se met à genoux pour une série de derechazos. On est heureux, on est épuisé, on ne sait plus quoi inventer, on est d’accord pour que cela ne cesse jamais.
D’où l’indulto qui n’avait guère de sens taurin en dépit de l’immense classe du toro – mais comme les autres largement économisé à la pique et avec quelques signes de faiblesse. Un indulto que des circonstances exceptionnelles imposaient d’évidence. Toute une arène criant « INDULTO INDULTO INDULTO » comme quelques instants auparavant « TORERO, TORERO, TORERO ». Une présidence se laissant finalement convaincre et on ne peut guère le lui reprocher : c’est la seconde fois en 150 ans (et la première était également le fait de Ponce). Et c’est ainsi que, dans un enthousiasme indicible, nous avons récompensé Ponce d’un indulto. Puisque vous l’aurez compris, il s’agissait de cela : consacrer un instant de grâce torera. (Une oreille, une oreille et deux oreilles sur le dernier indulté en dépit de la pétition unanime mais non concluante de la queue). Avant de raccompagner son toro vers le toril, Ponce invite Conde à s’en régaler de quelques passes puis mime le geste de la mort.
Après la dernière faena de Condé, comme à l’opéra, les artistes sont tous venus saluer, les toreros, Loren le plasticien, les chanteurs, Estrella Morente, la soprano, le chef – montois dit-on-, Juan Pedro Domecq lui-même. On vit Ponce, toujours bon camarade en dépit du triomphe, écarter les porteurs qui proposaient déjà leurs épaules pour associer Condé à son triomphe et faire à ses côtés une ultime vuelta à pied, accompagnés tous deux de toute la troupe du « Cristol ». Ponce dans les étoiles, Condé ravi de ses retrouvailles réussies avec la Malagueta, Juan Pedro en gloire, et Estrella Morente en figure de proue amoureuse d’un mouvement de foule joyeux et désordonné.
Ponce sortit finalement en triomphe par la Puerta Grande, raccompagné à hombros au travers des allées du Paseo del Parque jusqu’à son hôtel.
Moi, je flâne sous les brands arbres, dans des senteurs de jasmin, en contemplant dans la nuit les fluorescences des murs de brique rouge de l’Alcazaba.
Malaga, 18 août 2017- Francisco Rivera Ordonnez, Cayetano, Gines Marin/ Juan Pedro Domecq
Les jours se suivent et comme chacun sait…. Les Juan Pedro du jour, bellement en cornes, mais d’une faiblesse insigne, arrivèrent tous muy aplomados à la faena de muleta. Sauf le quatrième, plein de race, et dont Francisco Paquirri qui l’avait banderillé avec classe ne sut trop que faire. Ses adieux, ici, furent comme ailleurs, sympathiques, plein de nostalgie mais sans regrets (saludos, saludos) . Adios maestro.
Cayetano a une telle planta torera et, cette saison, un tel sitio, que pour cela seul la Malagueta réclama l’oreille sur son premier combat, laquelle ne fut naturellement pas accordée. Parmi les mille détails de toreria, sa passe de réception à la cape, par larga afarolada de pie, de grande inspiration, et ses quatre derechazos, très serrés, assis à l’estribo, outre la plus belle épée du cycle ( vuelta, saludos).
Mais c’est encore Gines Marin qui, ici, a marqué les esprits en dépit de son jeune âge et de la piètre qualité de ses adversaires. Sérénité de sa tenue en piste, élégance, sitio et distance, arôme de la passe, savoir-faire impressionnant pour son âge, aguante dans un numéro de porfia de verdad devant un adversaire outrageusement armé. On sent chez ce très jeune homme d’à peine 21 ans un niveau d’exigence torera impressionnant et une quête de l’essentiel qui fait espérer le meilleur. L’exact inverse des jeunes toreros de la modernité, les Roca Rey ou autres Lopez Simon. Por fin ! Peut-être devra-t-il cependant travailler l’épée… (saludos, saludos).