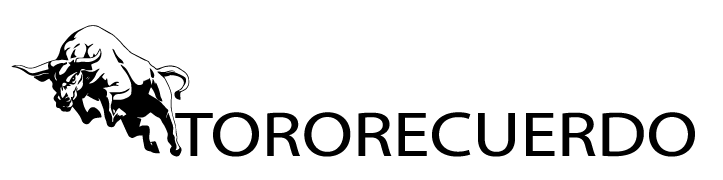Séville, 17 avril 2015- El Cid, Daniel Luque, Pepe Moral/ Montalvo
Demi-arène bien affligeante pour un vendredi de pre-féria à Séville. Les tendidos de la Maestranza sont comme chaises vides dans une réunion électorale désertée : on ne voit qu’eux. Et l’aficion des présents paraît relever davantage d’une obstinée fidélité en des temps révolus que de l’acte de foi en la résurrection prochaine d’une passion que l’on sent s’éteindre doucement, irréversiblement, comme la vie qui glisse entre nos doigts, sauf survenance de quelque miracle que rien n’annonce tant les protagonistes de la fiesta brava – oui, c’est ainsi que cela se nommait- le G4, les autres toreros, l’empresa, les ganaderos qui s’adaptent et nous autres qui persistons à nous compromettre, paraissent se liguer pour que rien de tel n’advienne.
Trois toros faibles suivis de deux décastés, après deux changements (le 3 et le 4), tous de présentation à peine correcte pour Séville, n’ont pas flatté notre moral.
Le premier du Cid était sans doute le plus noble, chargeant un peu et se replaçant comme majordome anglais à un cocktail de la gentry, avec discrétion et à distance convenable, prêt à servir à nouveau au moindre signe, mais un majordome vieilli, usé, sans force et un peu sourd qui en approchant renverse quelquefois le plateau sans que nul ne lui en veuille, tant chacun a à cœur que tout se passe bien. Ce toro c’est « Les vestiges du jour » d’Ishiguro (le livre) et d’Ivory (le film). Luque, au quite, l’a traité avec une douceur exquise et le Cid lui a tiré une ou deux séries de longs derechazos sans l’obliger ni le contraindre, tel un maître de maison attentionné à sa domesticité déclinante. Regain de jeunesse sur le suivant, un manso perdido qui fait trois fois le tour du ruedo et fuit tout signe de combat, que le Cid, avec métier et décision, réussit à conserver dans sa muleta templée et basse en deux séries de la droite avant de le suivre en querencia près du toril, comme qui sait prendre ce qui vient, sans illusion excessive. Tant d’abnégation torera pour combler un public qui ne demande que cela, sachant qu’il n’y a rien d’autre à faire, touche au grandiose.
Luque, aussi, a dû mettre un peu du sien au second qui lui saute au visage à la première véronique et se rue comme un brave sur le piquero par deux fois, en lui servant un quite par chicuelinas de macho, énergique et jambes écartées, conclues par une larga de grande toreria qui s’achève, avec arrogance, dos à l’adversaire et cape sur l’épaule. Daniel brinde au public mais la demi-charge qui reste de ce toro, finalement faible, ne permet rien de notable. Le cinquième, sans trapio, entre en boitant ; Luque dessine deux véroniques à genoux dans l’indifférence générale puis trois autres en parones et une demie à faire enfin saliver. Longue faena languissante…
Reste Pepe Moral qui a d’abord offert au public, pour de mystérieuses raisons, insondables au profane, son premier combat sur un cardeno sans trapio, efflanqué, apeuré et tremblant, puis montré ses bonnes manières sur le suivant, le dernier de l’après-midi, de présentation sérieuse dans un toreo vertical, les pieds joints, penché sur l’ouvrage, par derechazos amples et profonds. Ce torero au physique sec, au visage émacié, terriblement homme de la terre, droit et austère, sauve l’après-midi par son sentimiento. Plus marginal à gauche, il aguante en fin de faena un adversaire qui n’en peut plus et qu’il tue d’une belle épée et arrache un petit trophée, tout sauf impérissable mais pas immérité. Il sort fêté calle Iris, dans une ambiance bon enfant et pueblerina, sympathique en diable, entouré de sa famille et de ses amis de la proche banlieue.
Séville, 18 avril –Enrique Ponce, José Maria Manzanares, Lama de Gongora/ Victoriano del Rio
La Maestranza se retrouve. Plein soleil, no hay billettes et ambiance des grands jours calle Iris où l’on accueille Manzanares en sauveur de la feria. Et on a compris ce jour pourquoi il l’était.
Manzanares n’est ni artiste ni lidiador et sa recherche passionnée de l’élégance peut agacer comme les muscadins les sans-culottes après Thermidor. Mais l’heure n’est plus à la Révolution et s’il affectionne les flash et les podiums, les magazines et les défilés de mode, la jet-set et tant d’autres choses qui font los famosos, on aurait grand tort de négliger l’essentiel : il paraît dans les ruedos tous les après-midi où il risque la blessure ou la bronca, aime ça, l’adrénaline qui monte et les cornes qui rodent, la cicatrice possible sur ce physique de statue grecque ; la flétrissure ou l’ivresse narcissiques. Mais lui, ce n’est pas dans une flaque d’eau sous les ramages qu’il se contemple, c’est en toréant dans une arène, avec le superbe du gladiateur gracié, chéri par les femmes de sénateurs ou de patriciens romains du Bas–Empire, toréant à sa façon, cherchant le temple et le lié de la passe plus que toute autre chose, les joliesses immaculées du toreo de salon mais « in live » jusqu’à l’épée finale, son moment de vérité quoiqu’il advienne.
Il a certes mis du temps, ce jour, à s’accorder avec son premier, manso distraido, faible, à la charge erratique mais aux jolies cornes, qui a pris deux micro-piques, ne s’avisant qu’en fin de faena qu’il fallait le prendre par en dessous (en tapis volant) et non en lui tendant la muleta frontalement. Mais alors, bon sang, que ce fut beau et ample, un vrai chavirement, son toro en querencia près de la barrière prenant soudain feu en deux séries de verdad de derechazos longs et profonds liés à des pechos interminables sur un terrain enfin réduit à l’extrême avant une épée fulminante (une oreille). Sa seconde faena sur un toro aux armures commodes fut également intermittente, après un tercio de banderilles salué par la banda de musica : génie de Curro Javier qui n’attendant pas la mise en suerte profite opportunément de la course du toro qui poursuit encore Luis Blasquez pour réaliser un quite en plantant les bâtons. Une entame au centre de grande allure, plus nerveuse, le torero davantage dans le sitio qu’à l’accoutumée, un manque de lié sur les séries suivantes du fait de la faiblesse du toro, avant d’aguanter aux barrières dans une faena allant a menos dont il n’y avait pas lieu d’espérer une récompense. C’était compter sans l’orgueil du torero qui se grandit et se dépasse par une épée de macho, en todo lo alto, décisive, sur le toro collé à la barrière, sans autre sortie possible que sur lui. Une épée de gladiateur de Bas-Empire qui n’escompte la grâce de quiconque et ne compte que sur ses propres forces, soudain ramassées et irrésistibles, pour que le pouce soit une fois de plus levé (oreille).
Ponce fit peu et long devant le plus piètre lot de l’après-midi, son très beau premier (585), manso qu’il fit châtier excessivement, qui s’est repris aux banderilles, mais est arrivé irrégulier à la muleta et son second, absolument dépourvu de classe. Lama de Gongora, dont c’était l’alternative, est passé à côté du meilleur de l’après-midi (le premier), dans un trasteo lointain et précautionneux où il n’allonge pas le bras à droite et recule à gauche. On sort tout de même content, c’est dire où nous en sommes de notre niveau d’exigence.
Séville, 20 avril 2015 – Ferrera, Fandino, Pepe Moral- Torrestrella
Corrida affligeante dans une demi-arène écrasée de soleil, où l’on priait sans illusion pour que les toros, tous d’une faiblesse insigne, ne tombent pas. Profond abattement que n’ont durablement dissipé ni l’entrega de Ferrera, plus sérieux qu’à l’habitude et toujours spectaculaire aux banderilles, ni la confirmation des jolies manières de Pepe Moral sur son premier adversaire, offert au public avec une entame de faena en citant, depuis le centre, son toro à la barrière, pour une passe du cambio avec de beaux enchaînements, puis quelques séries droitières profondes, lentes, templées et cette discrète vibration de sentimiento, entrevue avant-hier (musique, entière lointaine, deux descabellos).
Public impassible qui ne s’est révolté qu’à la mort du cinquième, copieusement sifflé, et qui a obtenu, sans la complicité des tendidos de sombra, impénétrables face au désastre, le changement du sixième, à peine plus invalide que les précédents.
Et le basque ? Une erreur de casting manifeste avec des toros pareils. Mais aussi une grossière erreur de jugement de sa part quand il est allé par deux fois au quite sur les toros de ses camarades, des sifflets épars lui intimant de n’en rien faire tant le lot appelait aux économies de temps de crise. Hélas, un joli toro melocoton, au pelage en peluche comme un jouet d’enfant, d’un peu de présence tant à la pique qui l’épargne que durant le tercio de banderilles où il galope de bon cœur, nous déniaise sur l’essentiel : Fandino, le torero qui ne sourit pas, tout à l’édification de son personnage austère, concentré et diferente, l’orgueilleux et brave maestro, a perdu le sitio.
« Perdre le sitio », pour un torero, c’est comme pour nous autres, frères humains, perdre la main. On ne sait trop pourquoi, lassitude, faiblesse, dépression ou préoccupations diverses, mais ce qui était possible ne l’est plus. On le sent, ça se voit, et on n’y peut pas grand-chose tant que l’on n’en sait pas la cause. Les toreros vont-ils en psy ? Je ne sais. Mais ce qui est sûr, et triste, c’est que Fandino a perdu le sitio, comme il peut arriver à chacun de nous de perdre la main. L’échec de son solo de Madrid n’en est pas la cause : il en était déjà le symptôme. Le diagnostic a été confirmé à Arles, il est consacré à Séville. Ne nous affligeons pas, le sitio revient comme on le perd : toujours par surprise. Il suffit d’y croire. Courage Maestro !
Séville, 21 avril 2015- Finito, Manzanares, Luque/ El Pilar, Moises Fraile
Il y a pire qu’une faena allant a menos. Il y a les corridas qui s’effilochent. Une arène quasi-pleine sous un soleil triomphal, des robes de sévillanes partout et une guirlande de mantilles aux palcos de sombra donnent à la Maestranza un air de fête. C’est lendemain d’alumbrado.
Finito, dans un superbe habit bordeaux et or, scintille de mille feux face au meilleur du lot- nous ne le savions pas encore-, un toro haut, un peu maigre mais en cornes, bravote et de grande noblesse. La réception à la véronique s’achève par un bouquet de trois demies enchaînées, le tissu ramassé au maximum qui se dérobe tel Aladin, devenu nuée, qui disparaît aspiré par sa lampe magique. A la muleta, les terminaisons des deux premières séries de la droite, des derechazos longs, templés et profonds, avec changement de main et passe de la firma en jet de muleta comme coup de fouet au sol sont d’une préciosité inattendue et violente ; la seconde, mieux exécutée encore, à rendre fou ! Les naturelles les plus pures du cycle – limpides, encore un peu rapides, mais templant le toro sous nos yeux- sont énormes et la variété des enchaînements à suivre de main droite (molinete, deux derechazos, molinete, passe par le bas, pecho) d’un goût exquis. Finito reprend la main gauche pour égrainer des naturelles que la faiblesse de son toro ne permet plus de lier ; la passe est belle, lente, très dessinée, mais la position après replacement marginale. Une épée basse et deux descabellos nous privent de l’attendue polémique sur l’octroi des trophées : une grosse ovation et un saludo fort templé saluent le chef d’oeuvre, fragile et durable comme la poésie.
Manzanares sera moins inspiré sur le suivant, un beaucoup plus joli toro qui pousse avec allant et force à la pique jusqu’à renverser la cavalerie et auquel Luque servira un quite par véroniques de Semaine sainte, toutes de douceur et de compassion mêlées. Le tercio brillant de banderilles à suivre (saludos pour la cuadrilla) nous laissa espérer le meilleur, mais la faena sera hélas sans inspiration ni entrega, esthétisante au passage en dépit de deux ou trois pechos de la casa. Difficultés à la mort, le toro n’ayant à aucun moment été dominé (silencio). Nous apprendrons un peu plus tard que le torero était souffrant, victime d’une gastro, ce qui ne doit pas être plus agréable en habit de lumières qu’en costume de ville. Retenu à l’infirmerie, Manza passera son tour au cinquième pour toréer le six qui sort en boitant mais est le seul à pousser comme il convient au tercio de piques. Brega de grande intelligence de Curro Javier qui le ménage. A la muleta, où le toro arrive faible, José Maria recherche patiemment, élégamment et avec une obstination attentive et douce, le temple, tel le sourcier de l’eau dans une terre aride, et y parvient en deux séries après quoi son toro, parado, n’a plus rien à offrir. Manza pinche, déçu. Mais, tout embarrassé qu’il soit, il se reprend et tue d’une épée superbe. Vous, je ne sais pas, mais moi en tel cas, je me mets en repos en alternant Imodium et Ercéfuryl. Lui frappe comme un belluaire. C’est quand même une sacrée différence entre le maestro et le commun…
Luque a été, comme souvent, souverain à la cape et anodin à la muleta, avec cependant le plus mauvais sorteo du jour, un très faible premier, qu’il a eu l’idée d’offrir (saludos de politesse) et un second manso, décasté, faible et très court (silencio).
Les quarante ans de Cédric R., 19 et 20 avril
L’ami Cédric a décidé de fêter son anniversaire à Séville. Cela tombe bien, ses quarante ans ce sont aussi mes trente ans de Séville ! J’y étais venu alors en 4 L pour ma première féria, voir Paco Ojeda, Emilio Munoz, Curro Romero et Rafaël de Paula. C’était en 1985, j’avais 25 ans. Je me demande si ce n’est pas à cette féria que j’avais assisté au tercio de quites où Curro et Rafael avaient rivalisé avec Paco dans un concours de véroniques absolument phénoménales, saluées par la banda du maestro Tejera. Cette année, ce n’était plus en 4L, c’était en tenue de soirée à la Casa de Pilatos. Comme je vous le dis ! Sacré Cédric ! Cette histoire de smoking m’a bien un peu contrarié, mais on ne chipote pas quand on vous invite à partager un rêve. Un sueno. De verdad !
Passer la porte de la Casa de Pilatos sous les flash des photographes, se faufiler entre des images de mode, retrouver des amis, de très nombreux amis, s’embroncher dans des famosos, être accueilli dans la cour au son de guitares, deux chaises de paille sous les bougainvilliers et un croissant de lune dans le ciel, traverser les salons arabo-andalous aux tapis épais éclairés à la bougie, s’imaginer soudain hanter une toile de Delacroix, arriver dans une immense cour au parterre tapissé de buis, au centre une fontaine, des terrasses sous galeries sur chaque côté, ici un ensemble de musique de chambre, là des gitans faisant la rumba, des bars partout, un essaim de serveurs attentionnés. Champagne ! Cédric a fait les choses en beau et son plaisir, son rêve fou, ce fut de nous convaincre qu’ainsi, dans cet endroit magique, nous pouvions l’être tous. Et on l’était en effet, tous sans exception, beaux et ravis. Comblés. Mais la soirée ne faisait que commencer.
On fut invité à traverser d’autres salons aux murs couverts d’azuleros et à prendre place dans le patio d’honneur de la Casa pour le diner. Un zapateo de feu sur une estrade devant la statue de Minerve en encoignure, le bouclier aux pieds, a électrisé les tables chics. Maxime a dédié une chanson romantique à Cédric qu’il a chantée plus crooner que jamais ; une belle chanson d’amour tendre et inspirée qui nous mettait les larmes aux yeux puis Cédric a dit quelques mots, presque rien, comme si cette fête n’était pas la sienne, mais la nôtre. Celle qu’il nous offrait. Il a évoqué « Pépita » en regardant le ciel et chacun a compris que son amie, cette figure sévillane, la « Pépita » du Grau et d’Aigues-Mortes lui manquait.
C’était une merveilleuse soirée sans fin, où les salons hispano-mauresques traversés à l’arrivée sont devenus discothèque jusqu’à l’aube avec musique « live », des femmes en robe de soirées allongées en odalisques entre les coussins, Manzanares riant avec sa bande, Paco Ojeda regardant amusé deux ou trois drag-queen qui rodaient non loin, la haute silhouette du Comte de la Maza, tous l’ivresse et l’amitié au cœur et moi les chaussures qui commencent à faire mal.
Le lendemain, on songe au petit poème en prose de Baudelaire « Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge ; à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront, il est l’heure de s’enivrer ; pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise ».
Cette injonction, Cédric l’a réalisée le jour suivant à la Casa de Guardiola, Puerta de Jerez, en nous offrant une autre fête, aussi munificente mais plus intime, con sentimiento, dans le patio de style plateresque de ce palais XIXème, où les élégantes colonnes où la brise circule, le décor de stuc léché de soleil, le mur ocre du patio couvert où grimpe le lierre, les ombres douces et les éclats tamisés de lumière rappellent les scènes hispano-mauresque des toiles de Maria Fortuny. Et là, dans cet écrin, sans que nul ne s’en avise, le duende a soufflé tout l’après-midi et jusqu’au creux de la nuit. Un duende qui nous a pris aux tripes, un duende d’émotions intimes, bouleversant, remuant les souvenirs, fouraillant les cœurs, rappelant les âmes mortes et nos chers disparus.
Il faudrait tout dire, savoir tout écrire, raconter Mila, cette femme en châle à fleurs dans le répertoire de la Pantoja, accompagnée au piano et qui nous fait pleurer, ce Manuel, à l’allure italienne, qui vient un temps l’accompagner en duo, les applaudissements interminables, ces deux têtes d’ange que l’on aperçoit soudain sortant de leur médaillon de stuc pour s’embrasser dans un coin, cette bande de gitanes de Jerez, de Cadix et d’Utrera, qui sont venues en famille et qu’accompagne un guitariste austère, vieux monsieur chauve bien mis, au visage d’intellectuel des années 30, aux lunettes d’acier et au pied-bot. Ces trois jeunes dans l’autre cour qui jouent des sévillanes. Oui, il faudrait…
Mais un pianiste va nous bouleverser plus encore. C’est Arturo Parera Obregon dans une de ses compositions jouées au piano sous les arches en dentelles du patio. Une véritable commotion : cet homme arc-bouté sur le clavier est un maestro, un Glenn Gould, Morante à la véronique. Une composition éblouissante de thèmes sévillans et de musique espagnole, des variations de « Nuits dans les jardins d’Espagne » enchaînées à des phrases de « Dios te salva Maria », des soupirs de fandangos et des basculements de buleria ou de solea ; on croit que c’est fini, mais ce précipité de notes n’était qu’une trinchera, et la faena reprend, plus belle encore, variée, étonnante, profonde, accrochant de nouveaux thèmes, les précipitant ou s’emparant de nous avec violence ou mélancolie. Ces adagios, ces largos, ces barcarolles, ces obstinatos infusent et nous frappent au cœur à nous faire rendre l’âme. Cet artiste possédé par le duende arrache nos souvenirs du plus profond un à un, les plus enfouis, les fanés et les couleurs éteintes et ses notes sont soudain une vie ressuscitée à Séville, le défilé de nos vieilles années ici. Alors on pleure tous, mais chacun pour soi : notre première fois à Séville, les Portes du Prince qui s’ouvrent sur le Guadalquivir, la Virgen de Triana et celle de la Macarena, les nuits fauves au Parc Maria Luisa et nos premières pensions humides au petit patio fleuri, le Rocio ou les attentes de la Semaine Sainte, nos cours d’Espagnol au lycée et nos amis d’ici ( Olé Crescencio ! Olé Conchita !), on pleure le temps qui passe et ce qu’on a vécu, cette amitié qui circule et les copitas de Manzanilla, les calèches du campo de la feria (Olé Martine et Armand !) et le Christ du Grand Poder. On pleure les beaux jours et les autres, ceux qui sont là et ceux qui ne sont plus. C’est magique, merveilleux, éprouvant. Et cette épreuve est véritablement, authentiquement et terriblement sévillane.
Beaucoup plus tard, les tables seront disposées en cercle au fond du patio autour des gitanes de Jerez et du guitariste. Chacune chante et danse à son tour comme au coeur d’un chaudron. Un rayon de soleil doux souligne le profil de Ana Manzanares, la sœur du torero et on se surprend à trouver qu’elle lui ressemble, ces yeux en fente indienne, ce nez si joliment troussé, ce front haut. Ana a été frappée par le sort à la naissance mais elle a le profil d’une princesse.
Elle est là en première ligne du cercle aux côtés de sa sœur et des amis qui veillent sur elle, accompagnant le baile et le canto de petits mouvements de la tête. Sa joie d’être là, parmi nous, en égale, est belle et poignante. Et soudain, n’y tenant plus, on voit Ana se lever, se défaire de son sac en bandoulière pour venir au centre chanter le canto et danser. Les sons se bousculent et parfois s’éteignent dans sa bouche et sa danse est un peu celle d’Olympia, la poupée cassée des « Contes d’Hoffmann ». Ce surgissement flamenco des profondeurs, des gouffres de la vie et des mystères de l’énergie vitale était saisissant! Le duende qui, à cet instant, est venu cueillir cette jeune fille, qui lui a intimé l’ordre d’habiter los medios, cette flamme vive que nous avons accompagnée de palmitas et de « olés, la gorge nouée, n’était plus le silence de Dieu. C’était un signe de Sa grâce. Une Pentecôte sévillane.
A cet instant, ce patio d’amitié et d’arte devenait assomption, une aspiration miraculeuse du ciel où l’on imaginait Bernanos heureux. Voilà les instants que nous ont offerts Cédric et Maxime pour cet anniversaire. Pour sûr, mes trente ans à Séville ont été réussis !!!!