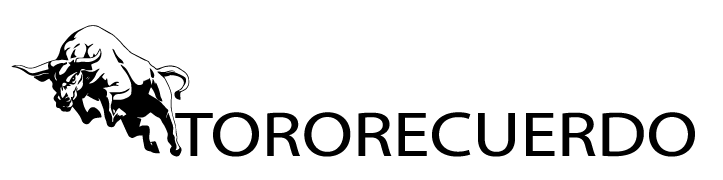Malaga, 18 août 2014- Cid, Castano, Escribano/Victorino Martin
On a tous nos petits secrets. Moi, j’ai toujours aimé Malaga, modeste, populaire, absolument sans distinction, longtemps orpheline des circuits touristiques et taurins. Je ne sais plus si c’est Théophile Gautier dans son « Voyage en Espagne » ou Alexandre Dumas dans son « De Paris à Tanger » qui rapportait l’expression en vogue au XIXème : « Les seigneurs de Cordoue, les petits messieurs de Séville et les gens de Malaga ». Je m’y suis d’emblée senti comme chez moi. Le soleil, la mer et, il y a près de trente ans, ma jeunesse faisaient le reste. On va aux arènes en remontant le Paseo del Parque que surplombent les hautes tours arabes de l’Alcazaba, des andalouses en tenue sont partout, de jeunes gitans ou leurs mères vendent du jasmin de table en table, on visite le musée Picasso ou désormais la fondation Thyssen et le soir on se ballade sur le port en songeant que si l’Espagne a saccagé son bord de mer, elle a décidemment, de Barcelone à Valencia, réussi ses ports. Une vraie spécialité, audacieuse et élégante. L’aménagement de Malaga est une merveille. S’agissant de l’aficion, ne le dites à personne, c’est une place de première ! Les toros y sortent mieux présentés qu’à Nîmes, le palco a la rigueur de la Maestranza, le public, évidemment local, sait distinguer une passe d’une autre dans une série inégale, la banda, toujours solennelle, porte haut la geste taurine et les toreros sont ici, comme moi, un peu chez eux.
La Malagueta nous a offert, ce jour, une bien belle Victorinada. Lot très bien présenté (de 500 à 586 kgs), encasté dans l’ensemble, le premier très en tête, un peu faible et assez vicieux, quatre très bons, poussant à la pique, mobiles et donnant du jeu, les 4 et 5 supérieurs.
Le Cid en torero d’expérience s’est accroché, très sûr, parfois un peu lointain sur son premier (saludos) et a frôlé le toreo grande à la naturelle sur le suivant, allant a mas, se centrant, se relâchant. C’était très beau jusqu’à une vilaine épée atravesada suivie de trois descabellos qui l’a privé de trophée. Mais ici, nul ne pleure ou ne récrimine. « Son cosas de toros !». La Malagueta, reconnaissante au buen toreo, lui a offert une très belle vuelta et c’était très bien ainsi.
Contrat après contrat, l’homme à la cuadrilla se fait un nom. Castano ! Torero y matador de toros ! Patiemment, consciencieusement, laborieusement et très intelligemment, Castano se construit et progresse. Le chiqué, l’allure, la toreria ostentatoire, le charisme, il les laisse à sa cuadrilla et on imagine que ses peones lui en sont infiniment reconnaissants. On devine qu’ils l’affectionnent, on voit qu’ils le protègent, qu’ils l’aiment comme un frère. Faut-il que cet homme soit admirable et, au fond, sûr de lui, pour ne pas prendre ombrage de leur fantaisie ou de leur talent. Quelques uns en ricanaient au début. Ils sont de moins en moins nombreux. Cette banda torera (Adalid, Sanchez, Galan, Sandoval), c’est lui qui a décidé qu’il en serait ainsi, que le spectacle avec eux serait plus complet et qu’il n’avait rien à en redouter. Avec sa mine pâle aux cernes creux, Il me fait penser à ces producteurs d’Hollywood des années 50 passant inaperçu dans leur mauvais costume mais dont on s’avisait, un instant trop tard, étourdi qu’on était, qu’ils étaient les véritables patrons, puissants, discrets et d’une fermeté de caractère qui fait les vrais cadors. Les leaders sans Rolex. Indifférents aux enfantillages. Forgeant, et eux seuls, leur propre destin.
Sur son premier, très encasté et aux vilaines intentions, qui a pris la seconde pique de trente mètres, on a vu une entame par doblones un genou en terre d’une toreria saisissante, puis un sitio puissant, les pieds bien terre, les jambes en compas, supérieur à droite, manquant de liant et pesant moins à gauche, achevant par une épée bien en place, un peu tendida (saludos). Son second, qui a pris trois piques en brave face à un Tito Sandoval des grands jours, avait trois grosses séries à donner. Castano les a offertes, trois séries énormes de derechazos, longs, templés, avec rythme et liaison, cousus à trois pechos de grande allure. Il se fait désarmer deux fois à gauche, revient à droite mais son adversaire désormais se défend comme un assiégé. Une épée phénoménale met un terme au combat. C’est Fernando Sanchez qui puntilla, et il fallait le voir le Sanchez, une fois le coup de poignard réussi, se tendre vers le ciel en bombant le torse, s’enivrant de toreria. Un peu ridicule, vraiment grandiose. C’est tout de même Castano qui a eu l’oreille !
Escribano a hérité du plus mauvais lot pour sa présentation en torero à Malaga. Il banderille bien son premier qui se révélera aplomado à la muleta et avec grand cœur le dernier, s’exposant à l’excès dans un quiebro avec sortie por dentro, se retrouvant coincé à la barrière dont il s’esquivera par miracle un quart de seconde avant que le toro n’y fiche ses deux cornes. Le public, plein de gratitude pour ce geste d’une après-midi de peu, lui pardonnera tout le reste, le manque de métier à la muleta, la position lointaine et de s’être fait déborder par un adversaire vicieux qui aurait mérité un autre combat ( gros trois quarts d’entrée).
Malaga, 19 août 2014- Antonio Ferrera, unica espada/ Miura
Le lot fut bien affligeant et on songea méchamment que c’est ce qui pouvait arriver de mieux à Ferrera qui a quitté l’arène sans trophée. Oh, certes, les Miuras ont été moins indignes qu’à Nîmes, mais presque tous d’une insigne faiblesse. Le maestro, discret, pourra y étancher son amertume, et c’est tant mieux pour son moral. On avait déjà craint le pire quand l’éleveur avait annoncé que c’était un lot de présentation sévillane. On a redouté la litote, mais nous avons eu tort : le lot était de jolie présentation, assez homogène (540 à 566 kilos), plus « joli toro » que le sont généralement les Miuras, jolie tête mais rien de bien impressionnant. Au comportement, nous avons eu dans l’ensemble d’agréables tercios de piques, avec des mises en suerte lointaines et appliquées, davantage grâce aux hommes qu’aux toros, excepté le 5 et le 6, ce dernier entre les mains de Tito Sandoval. Mais d’une grande faiblesse, souvent diagnostiquée dès le premier tiers. Le 1, bien en tête mais sans présence, le 3, très joli castano, décasté, le 4 faible et vicieux, le 5 un vrai invalide- un Nîmois si vous voyez ce que je veux dire. Le 2, noble sur la droite, et le 6, seul Miura de comportement, sortant du lot.
Ferrera dans un habit vert perroquet, style Elisabeth d’Angleterre, apparemment très calme, a fait preuve de plus de sang froid que d’envie, laissant un peu filer la corrida comme si ce n’était pas son encerrona. Trasteo court et lointain la plupart du temps, banderilles médiocres dans l’ensemble, en échec face au genio du 4 et du 6. Sa faena fut sur le deuxième, avec deux très belles séries à droite, mais le maestro n’a pas insisté sur la gauche, corne où le toro s’avise. Une épée magnifique et foudroyante et une grosse pétition ne sont pas parvenues à faire tomber l’oreille. La réception à la cape du 5, un genou en terre avec soudain une envie de novillero nous a fait espérer un frémissement. Mais hélas, aussitôt après une belle véronique templée, Ferrera a reculé la jambe. Sans doute ne pouvait-il faire autrement…
Dans ce chapelet de « silencio », les seuls rugissements de l’après-midi furent sur les tercios de banderilles quand Ferrera eût la bonne idée de les partager avec les banderilleros (les trois derniers). Car il avait su s’entourer le bougre ! David Adalid, Fernando Sanchez, Marcos Galan, Javier Ambiel, Jaime Padilla. Adalid et Sanchez ont évidemment été extraordinaires et Ferrera bien meilleur à alterner avec eux.
On ne pouvait cependant se défendre, à la fin de la corrida, d’une sincère et affectueuse estime pour ce torero qui avait certes vu un peu grand, mais qui a fait face avec une belle sérénité, sans signe apparent de découragement, ne prenant jamais le public à témoin de sa malchance, n’hésitant pas à alterner avec le péonage pour nous offrir un peu de variété, quoique la comparaison puisse lui en coûter, et qui a tout de même combattu, seul, six Miuras (petit trois quarts d’entrée).
Malaga, 20 août 2014- Juli, Perera, Talavante/ Victoriano del Rio
Dans cette arène torerista à la folie, on frôle le « no hay billette » : c’est le cartel appelé à lancer la feria. Joli lot, de présentation sévillane (504 à 588 kgs), quatre toros de cinq ans, les trois derniers avec de jolies cornes, de deux demi-piques chacun, mansos, mobiles et décastés, sauf peut-être le dernier qui vient avec beaucoup de gaz, tous sauf le premier donnant du jeu.
Au paseo, on ne voit que Perera, qui avance le pas lent et majestueux, tel un empereur romain. C’est son moment et incontestablement sa saison. C’est fou le mental quand même ! Sa première faena confirme cette impression d’aisance, tant à la véronique, passes douces et templées en parones, qu’à la muleta, impressionnant de sitio, à la juste distance, dans une faena rythmée, main basse, cependant quasi exclusivement droitière, se terminant par circulaires. Epée trasera mais concluante (oreille). Mais Perera sera précautionneux et sans intérêt (enganchones, désarmés) face à son second, très en cornes, qu’il achève d’une épée décisive (saluts). A cet instant on songe que son prochain « un contre six nîmois » risque de nous paraître bien longuet…
El Juli m’a surpris ; tout arrive ! Rien à son premier, mal avisé, tant à droite qu’à gauche en dépit de deux tentatives de chaque côté (silencio). Mais c’est un Juli méconnaissable, transfiguré, vertical et relâché (oui, oui vous avez bien lu !) qui s’est présenté ensuite pour une faena habitée, essentiellement de main gauche, avec des changements de main limpides et souverains, des trincherillas dans les zapatillas, des passes du desprecio, et à droite, le bras coupé au coude, un peu codillero et non plus télescopique, avec dans le tout, face à un adversaire en cornes et qui ne songeait, en seconde partie de faena, qu’à fuir vers les barrières, un rien de nervosité inspirée. Oui, nous avons vu ce jour un torero moins cérébral, moins techniquement démonstratif qu’à l’accoutumée (un désarmé, courant comme un possédé derrière son toro fuyard, ne prenant jamais le public à témoin), paraissant toréer pour le plaisir. Presque romantique. Ce n’est certes pas Morante, mais ce n’est plus le marathonien des ruedos qui nous lassait. Frivole, on s’avise soudain que même quelque chose dans sa coupe de cheveux a changé, la tignasse en folie, débordant sur le front, le cheveu un peu dans le vent. A bas le brushing : tout est là ! Un tiers d’épée et deux ou trois descabellos le privent de trophée pour ce qui reste pour moi la faena la plus profonde du jour (saludos al centro). Et vérifiant une fois encore qu’en tauromachie tout est possible, surtout les miracles !
La plus belle et la plus complète fut celle de Talavante sur le second, que deux petites piques ont rectifié et concentré sur le combat qu’il fuyait au premier tiers. Toro très noble, très mobile, avec hélas un rien de soseria. Il y a dans la manière de Talavante quelque chose de léger, d’aérien, de fluide, une frivolité précieuse mélangée de gamineries espiègles qui retient encore quelques aficionados. Son toreo est une brise et donne l’impression qu’Alejandro joue avec le vent comme les enfants au cerf-volant. S’en dégage une poésie quelque fois merveilleuse, de grande inspiration, faite d’ornements discrets où rien ne pèse. Des trois toreros punteros, il serait Véronèse, Morante le Tintoret et Tomas le Titien. Il y a du Rimbaud en lui. Morante serait alors Verlaine et Tomas tous les autres poètes, le vers ample d’un Victor Hugo, l’hermétique aridité de Mallarmé et la volupté de Baudelaire.
Doblones un genou en terre, il se relève et sert deux trincherillas de cartel, où le toro paraît s’aimanter à un souffle de muleta. Suivent deux séries de derechazos, Talavante très vertical, très relâché, la main basse, sur un terrain réduit au minimum, avec changement de main sur la dernière qui annonce les naturelles à suivre, inspirées, ralenties, souveraines. Elégance, variété des cites, par molinetes ou de main droite avant changement dans le dos, inspiration d’un kirikiki, bernardinas impressionnantes d’aguante, une dernière trincherilla qui laisse le toro à ses pieds, lui immobile dans un desplante de statue de sel. Ce n’est plus un combat, c’est du champagne qui coule à flots un jour de fête. Epée, quatre descabellos et une vuelta très fêtée en guise des deux oreilles. Sur le suivant, véroniques et demie, pleines de desmayo, comme si son capote était plus léger que celui de ses compagnons, puis une entame de faena par six statuaires sans broncher et trois trincherillas pleines de langueur. Mais Rimbaud me paraît soudain un peu en dessous de ce toro noble qui vient con gaz. Les naturelles sont aérées, liées, templées, rythmées, un ou deux pechos sont de grande saveur, mais il y a des enganchones et le tout travaillé plus qu’inspiré, comme si le garnement se disait qu’il nous en avait assez donné. Une épée, très grosse pétition, l’oreille tombe quand l’arrastre est déjà partie, on va la chercher dans le toril et on la lui offre sans façon, sans doute pour l’ensemble de son œuvre.
Très jolie après-midi de torerisme où les trois maestros sortent sous les applaudissements d’un public conquis. Je retiens la transfiguration du Juli, la voluptueuse insouciance de Talavante et le métier, qui ne suffit pas à faire un cartel inoubliable, de Perrera.
Malaga, 21 août 2014- Javier Condé, Salvador Vega, Jimenez Fortes/ Luis Algarra (filiale Domecq)
Deux tiers d’arènes. C’est jour de corrida Picassiana pour les trois toreros malaguenos! Une spécialité locale où l’on rend hommage à l’artiste en s’habillant de goyesque, ou à peu près. Y manque le couvre-chef bicorne et c’est tant mieux ! Le ridicule finit par tuer et la montera est très belle au torero… Jimenez Fortes, sans doute conscient qu’il n’était pas né pour concourir à un prix d’élégance, a préféré l’habit de lumières, bouteille et or pâle aux très jolis ramages. L’habit de Javier est bien beau, mais plus Keith Haring que Picasso, bleu nuit sur fond blanc, avec des dessins d’enfant à découpe géométrique, des figures soulignées de grands traits noirs, une étoile orange dans le dos, genre illustration du « Petit Prince », le livre. Celui de Salvador Vega, merveilleux gris perle brodé de pompons charbon au méridien des bras et des jambes, est le plus beau. Mais ce n’est pas tout ! La Malagueta a fait appel à un artiste français, un certain Loren, pour décorer les tablas et burladeros enbleu lavande et noir. Les premières paraissent badigeonnées à coups de muleta trempée dans du goudron, les secondes représentent des têtes de toros et les portes des talanqueras lesregards de Picasso à travers les âges ; ici, amusé, là songeur, ailleurs grave et pénétré, ou bien charmeur. Le mur du fond du callejon est agrémenté de jolis médaillons à motif de minotaures et la porte du toril a été repeinte du même bleu. Le tout est très vilain, ne rappelle en rien le Picasso de la période bleue, si ce n’est peut-être sa tonalité crépusculaire, pas très heureuse quand elle fait cercle autour du ruedo pour une corrida de ce siècle qui n’a pas vraiment besoin de cela. Quelle drôle d’idée…
Toros de présentation nîmoise, sans vrai trapio, quatre sur cinq de plus de cinq ans, le cinquième, d’octobre 2008, frôlant la limite d’âge, de deux petites piques chacun, deux très faibles, le premier et le cinquième bravotes, la plupart mobiles, au moins un temps…
Javier Condé a laissé passer son lot et sans doute le meilleur toro du jour, le premier. Sifflets irrités plus que véritable bronca, sauf à la sortie, Javier, le pas lent, détaché de sa cuadrilla, faisant face. Ce fut son seul moment d’hombria.
Savaldor Vega, torero affectionné, modeste de l’étape qui ne torée plus à peu près que dans sa province, a accueilli son premier par véroniques dessinées mais sans art. La faena de muleta, brindée au public, a débuté joliment par des cites lointains depuis le centre pour une passe du cambio, suivie de deux séries de derechazos très longs et templés, avant que le toro ne s’effondre (saludos). Il accueille le suivant, le plus toro du jour, de bon comportement à la pique, par un merveilleux pecho un genou en terre, plein de toreria, avant de prendre d’emblée la main gauche pour égrener deux séries de naturelles, quelques unes jolies, avant que le toro ne s’immobilise définitivement (saludos). A retenir aussi de très enveloppantes chicuelinas au quite sur le premier de Condé. De bien jolis gestes laissant une impression d’inachevé mais un délicat parfum de jasmin dans l’air.
Jimenez Fortes a été le torero le plus complet du jour, centré, relâché, plein d’aguante, les pieds joints et la main basse, dans une faena construite et bien menée sur son premier. Se lance de verdad entre les cornes mais l’épée, caidita, est inefficace. A la différence de pratiquement tous ses compagnons, il reprend l’épée et non le descabello et tue comme un brave (vuelta très fêtée). Son dernier combat sera plus aléatoire surtout en deuxième partie de faena. Très belle épée. Ce garçon est un tueur (saludos).
Malaga, 22 août 2014, Ponce, Morante, Manzanares/ Zalduendo
No hay billette… ni toros ! Présentation à peine correcte, le second de Ponce, très anovillado, en dépit des cinq ans affichés, les deux premiers ainsi que « Refugio » le toro du triomphe morantiste, entre faibles et invalides, piques symboliques, les deux de Manzanares étant les plus mobiles, le dernier con gaz. Sifflets, demandes de changement, slogans « des toros, des toros », tout y passe ! Dans une plaza aussi bon enfant et bienveillante aux exigences des artistes, c’est signe que le spectacle est bien affligeant.
Faena d’infirmière de Ponce sur son premier, invalide quasi-complet dont il a tendrement choyé les derniers instants en le rappelant miraculeusement à la vie. A osé saluer ! Le pire et le meilleur sur le second : sa faena du catalogue de La Redoute, toujours pareille d’une saison l’autre, de plus en plus vintage, on la voit depuis quinze ans, c’est le produit phare de la chaîne. Lointain, toreo du pico, avec léger déhanché au passage, génuflexions arthritiques suspendues à une taille, celle-ci, il est vrai élastique. Deux moments toreros et deux seuls : l’entame par doblones un genou en terre, con dominio, et une série énorme de derechazos, une peu perdue dans le reste, où Enrique, très vertical, très relâché, torée dans le sitio, la main basse, le bâton de la muleta à l’oblique. Mais comment venant de voir ceci peut-on encore supporter le reste ? Mystère… (saludos).
Manzanares a également servi sa faena sur le premier, après l’avoir conduit au centre. Séries amples, les premières à ce point qu’au pecho le toro ne passe presque plus sous l’étoffe tant il est tenu éloigné de l’homme, mais cela va a mas. Naturelles très appliquées, templées entre de longues pauses où l’on écoute, recueilli, un pasodoble très Belle Epoque, genre les Brigades du Tigre. Bigre ! Désarmé, José Maria ne parviendra plus à lier. Belle trinchera et épée en la crux (oreille). A mon humble avis, Manzanares est passé à côté du dernier toro qui s’est révélé excellent au tercio de banderilles, vif, galopant, suivant les hommes jusqu’aux tablas. A la muleta, « Maznorra », c’est le nom de la bête, surprend trois fois le torero en venant avec codicia de trente mètres sans avoir été cité. José Maria ne met pas cette charge à profit, pourtant miraculeuse ce jour. Très belles séries de la main gauche et tentatives de recibir (saludos).
Et puis, il y eût Morante ! Rien à retenir de son premier, complètement décasté. L’artiste a l’air de vouloir sur le second, toro de cinq ans, avec d’assez jolies cornes et qui sort vif. Morante s’apprête à la cape dès la réception mais il n’en ressort pas grand-chose à l’exception de fléchissements répétés de son adversaire que le public proteste avec force. La présidente reste inflexible. Deux chicuelinas ensorcellent alors le toro qui paraît sous GHB et s’aimante aux ondulations d’un capote féérique avant de s’effondrer raide-mort. On craint l’over dose mais il se relève et la présidente, sans doute insatisfaite des deux simulacres de piques, refuse de changer de tercio. On crie « Pitié pour la bête », Morante, dépité mais solennel, se découvre et la présidente sort finalement le mouchoir blanc. Ouf… Les présentations sont faites. Vous connaissez « Refugio ».
L’entame d’une toreria folle aux enchaînements insoupçonnés (trinchera, passe par le haut, molinete, passe par le haut), une série de trois derechazos lentissimes gorgée d’art, un chapelet de naturelles dans les zapatillas, et quatre autres derechazos comme tombés du ciel, plus beaux encore que les précédents, nous ont transportés sur une autre planète. Sans repères intelligibles, sans référence, sans précédent et comme sans souvenir, dans une intensité d’être là, face à cela, à la fois cotonneuse et intemporelle, qui absorbe tout, la musique que l’on n’entend plus, la faiblesse du toro que l’on ne perçoit plus, nos voisins qu’on oublie, seul face à Morante oeuvrant, et lui, seul sans nous. C’est très étrange, le GHB… On se moquait tout à l’heure du toro et soudain c’est nous qui nous trouvons hypnotisés, comme sous le charme puissant et doux d’un mage bienveillant. Ouverts à l’infini, bienheureux comme saints au paradis, dans une féérie indicible d’où l’on devrait revenir muet pour ne rien raconter. Le duende n’est pas transmissible. Le duende ? C’est quand on ne prend plus de note. Qu’il n’est nul besoin de se concentrer tant on se trouve transporté. C’est cette évidence que le torero ne songe à rien d’autre qu’à ce qui s’accomplit, à ce qui vient, qui va venir encore, qui ne s’arrêtera jamais, qui recommencera en mieux, en encore plus doux, en encore plus profond. Le duende ce n’est pas le temps arrêté, c’est l’éternité. Une faena comme dans un rêve et des souvenirs en lambeaux de brume, comme un réveil au petit matin, l’émotion intacte, le sentiment d’avoir été traversé, bouleversé par ce que nous avons vu, mais la certitude que toute reconstitution est illusoire et vains les efforts pour explorer à nouveau des chimères. Alors, on referme les yeux en se disant que c’est mieux ainsi. Le souvenir du rêve est scellé au monde : après tout un rêve est un rêve.
On se souvient du chapeau andalou, gris à larges bords, jeté des tendidos sur le ruedo aux pieds de Morante en milieu de feana, du kirikiki qui a suivi, d’une anodine bousculade après quoi Morante s’est repris, son toro avec lui, les deux plus forts, de l’élégance des aidées par le haut, des aidées par le bas qui expiraient aux pieds du taureau, des molinetes morantissimes où le maestro torée (pardon !) le cul outrepassé pour obliger davantage le toro. On se souvient de Morante qui torée de tout son corps, du poignet, des bras – toujours regarder le bras contraire de Morante- de la taille, du buste, des jambes, des pieds, où pas une molécule de ce type ne s’abstient de toréer, où son corps tout entier dessine le cercle de feu où sa magie opère. Ce jour, à deux pas du sombrero cordobes tombé des tendidos. Avec arte, une douceur exquise et sans ce baroquisme (molinetes exceptés) qui quelquefois me gêne.
Epée entière et décisive. La Malagueta est en ébullition. Pour cette faena à deux oreilles et la queue à Nîmes, une seule oreille tombe en dépit des protestations unanimes du public qui en réclamait une autre. La présidente, sans doute moins douce rêveuse que nous, ou plus attentive à la commodité de cet adversaire, ou pour vouloir nous punir d’avoir demandé en vain le changement de ce toro qui s’est révélé d’une noblesse infinie et d’une charge courte mais inlassable, résiste. Vuelta très templée de Morante. Bronca majuscule au palco.
Morante est sorti à pied par la puerta de cuadrillas dans des clameurs de Puerta Grande, mais le public est resté sur les gradins, comme on le fait à chaque grande corrida, comme s’il s’agissait d’entretenir encore le feu en couvant les braises de duende de notre présence. De peur qu’elles ne s’éteignent trop vite. A cet instant on vit un arenero traverser très lentement la piste en soutenant du bras un vieillard à la démarche vacillante, un peu cassé en deux. C’était Rafael de Paula, l’occasion était trop belle, qui s’offrait une dernière ovation avant d’emprunter la sortie des toreros, dans le sillage de Morante. «Eso si, es flamenco !
Malaga, 23 août 2014, Pablo de Hermosa, Tomas/ Deux Parlade, un V. del Rio pour JT
à Gene et Denis,
Petit tour à la Casa natal de Picasso qui exposait « La Minotauromaquia » et quinze autres gravures de la suite Vollard, des eaux-fortes réalisées par l’artiste entre 1933 et 1936 pour son marchand parisien en échange d’un Cézanne qui lui plaisait. Même les génies ont des tourments, cette série en témoigne qui vous reste dans l’œil et vous habite les jours suivant. Sur cette courte période, Picasso a quitté Olga, sa première épouse, mère de son fils Paulo, laquelle lui refuse le divorce, s’amourache de Marie-Thérèse Walter, sa jeune muse, âgée de dix sept ans quand il en a quarante six, lui fait un enfant en 1935 (c’est Maya), avant de rencontrer Dora Maar, la photographe, égérie de Bataille et Breton. Ces quelques années de la maturité d’un homme (il a alors 52-55 ans) entre ruptures et sentiments, plaisirs et complications, conduisent le peintre à se représenter en minotaure, mi-homme, mi-bête, jouissant des femmes dans la volupté de bacchanales puis les forçant quand l’animalité gagne, un minotaure puni pour ses crimes dans l’arène d’un coup de puntilla avant qu’une main miséricordieuse ne se tende vers lui depuis les tendidos, en geste d’affection et de pardon. Sur quelques estampes, le Minotaure est Œdipe aveugle soutenu par une main aimante : les crimes alors n’en sont plus ; ils ont été programmés par les dieux. Le destin a bon dos mais la punition est sévère : Œdipe est aveugle, ce qui pour un peintre n’est pas rien. « Minotauromaquia » enfin, œuvre magistrale qui préfigure Guernica, représente le Minotaure, une épée en main face à un cheval éventré qui supporte le corps d’une femme torera blessée. Face à lui une jeune fille tient une bougie et un rameau d’olivier ; elle est la lumière rédemptrice, qui éclaire et sanctifie la scène barbare. Sans doute la figure de Marie-Thérèse, la pureté de la femme-enfant. Sur le côté gauche de l’estampe, un homme torse nu et barbu grimpe à une échelle comme s’il voulait s’enfuir. Cet homme est-il Jésus, comme on l’a dit ? Est-il l’allégorie du sculpteur antique du Minotaure qui fuirait devant le monstre qu’il a créé et qui lui échappe. Est-ce Picasso terrifié par sa conduite ? On va à la corrida du jour, des doutes et des interrogations plein la tête…
Il n’est plus possible de voir et d’apprécier José Tomas avec spontanéité et naturel. Ses triomphes des années 96 à 99 brutalement interrompus, sa retirada, son retour tant attendu, ses absolus triomphes madrilènes de juin 2008, sa blessure d’Aguascalientes, sa si longue convalescence, son retour à nouveau à Valencia en juillet 2011, sa rareté depuis lors, son choix de toréer peu et avec qui il veut, son évitement des grands circuits (Madrid, Séville, Bilbao), son sommet nîmois de septembre 2012, il y a trop de légende, trop d’attente, trop de comparaisons possible pour qu’on puisse à nouveau le regarder comme on devrait regarder un torero, simplement avec les yeux , non par pour son propre compte (« je l’ai vu », « j’y étais ») mais pour le plaisir de voir toréer. Et comme si cela ne suffisait pas, les morantistes s’en mêlent, seuls aficionados exclusifs, de marque déposée, tout à la gloire de leur maestro, qui dénigrent systématiquement José Tomas ou l’évoquent avec condescendance, entre deux soupirs affligés… Avez-vous déjà entendu un tomasiste, en un mot un madrilène, brocarder Morante ou se priver du plaisir de le voir toréer ? Moi, jamais ! Les tomasistes savent qu’il peut y avoir deux toreros sur une même planète, à une distance galactique des autres. Pas les morantistes, hélas, qui sont un peu le provincialisme de l’aficion, beaucoup dans l’entre-soi, hermétiques au tragique : pour eux Séville est une fête et le toreo doit l’être aussi, de préférence dans une ville calme, prévisible et fleurie.
Après ces quelques lignes qui vont me fâcher avec pratiquement tous mes amis, et sous les réserves qui précédent – on ne peut plus « voir » José Tomas et le sens de l’analyse, faussé, ne peut plus être rectifié- voici l’essentiel. La Malagueta ne m’a pas paru aussi dévote et transportée lors du paseo que Valencia en 2011 ou Nîmes en 2012. Bien sûr le public était en place un quart d’heure avant l’heure, mais nulle folie n’a accompagné le défilé des cuadrillas, les gens se sont rapidement rassis et, à la fin, les applaudissements ont aussitôt cessé. José Tomas auquel la municipalité a remis en piste le capote de oro de la ville pour sa saison… 2009 n’a pas été autrement appelé à saluer ni à la fin du paseo ni avant l’entrée de son premier toro. C’était bien ainsi ; on ne doit jamais être la dupe de la rareté.
Au début, on l’a maudit bien sûr. Maudit d’alterner avec un cheval, ce qui saucissonne le spectacle en le privant de rythme– les travaux de réfection de la piste entre deux combats sont très longs- et de comparaison. On le maudit aussi d’avoir choisi ce premier Parlade (496 kilos, de quatre ans et demi), joli certes, bien fait, mais faible et sans jus avant même les piques dont il sera très épargné. Déçu encore par ce premier désarmé à la troisième véronique et par cette fin de faena que Tomas s’est trouvé contraint d’abréger sous les sifflets. Silencio pas tout à fait accablé (nous nous souvenions aussi des véroniques de réception templées et lentes, des chicuelinas marchées pour la mise en suerte et d’une faenita douce devant ce toro sans classe) mais qui sonnait quand même comme une gifle. De ce premier combat ne restait que le silence de cathédrale lors des passes de réception, ce qui, dans cette arène gentiment bavarde, témoignait tout de même de l’attente, asphyxiée d’impatience, que suscitait l’idole.
La suite fut un ample adagio, un hymne taurin à la lenteur, de cape mais surtout à la muleta. Le capeador fut moins convaincant, à nouveau un peu bousculé au quite sur le deuxième (un joli Victoriano del Rio de cinq ans, 526 kilos), quite aussitôt repris à l’identique bien sûr, par tafalleras et un enchaînement entre gaonera y farol alternés que l’on appelle caleserinas, en l’espèce plus original que limpide, beaucoup moins élégiaque que ses quites nîmois. Il y avait eu à la réception des véroniques templées balancées comme des navarras, des chicuelinas merveilleuses et une demie de cartel, altière, à la Joselito, de grande beauté. Une demi-pique où le toro qui s’emploie soulève la cavalerie, laquelle se laisse faire, et une seconde pique symbolique.
C’est le début de cette deuxième faena qui fut saisissant. Quatre ou cinq statuaires, où la corne menace, où l’on croit que le toro serre mais c’est le torero qui souhaite qu’il en soit ainsi, que la corne rôde autour de ses flancs, qu’elle passe et repasse toujours au plus près, les pieds joints bien en terre pour être sûr ne pas bouger. Et soudain ces statuaires sont autre chose que des statuaires, c’est le torero qui commande, qui aguante et qui mande, immobile et solennel, figé comme statue de sel, et quand Don Tancredo décide qu’on a assez joué, c’est lui qui interrompt les passages d’une passe par le bas, de cartel, voluptueuse et définitive. Là, soudain, on ne songe plus à ce drôle de mano a mano, à l’attente irritante entre deux combats, au faible premier ; on est pris par cette manière de toréer de verdad.
Pour comprendre ce qui va suivre, il faut aller sur Youtube écouter la chanson « Despacito » ou « Muy despacito », une ranchera mexicaine chantée par un certain José Alfredo Jimenez dont la banda de musica de la Malagueta (« Rudy sors de ce corps ! ») a livré une version orchestrale majestueuse et lente, un peu valsée, assez triste. Pleine de langueur et de nostalgie. A soulever l’âme. C’est alors que José Tomas s’est mis à toréer lentement des deux côtés, citant le toro d’un souffle de muleta pour amorcer une charge qu’il prolonge infiniment et ralentit d’une manière inouïe. Le temple chez lui, n’est plus seulement une vitesse contenue, c’est une épaisseur, une densité entre le tissu et les cornes, puissante comme un champ magnétique. La manière et la philosophie, le sens profond, du temple tomasiste sont très différents du temple morantiste. Pour Morante, le temple est un accord, une liaison entre l’homme et le toro, c’est une muleta qui butine, qui folâtre, qui caresse la tête du toro, qui mignarde, effleure, titille, papillonne, batifole dans des frôlements exquis. Pour Tomas, le temple, c’est d’abord une distance, le ressort d’une charge, comme si cette distance, dans une aimantation mystérieuse, devait devenir le carburant du toro, le gorger d’une énergie destinée à le prolonger, à le rendre davantage toro. C’est le temple pour le temple : on n’y recherche plus l’accouplement de la muleta avec les cornes, mais le miracle d’une charge, comme le sourcier le filet d’eau. Le seul objet du temple tomasiste, c’est d’aller chercher la caste ou ce qu’il en reste de très enfoui et que l’on voit affleurer, avec quelques fois une abondance insoupçonnée, comme il l’a fait ce jour sur une paire de naturelles qui tenaient du miracle, lentes, interminables, affinées. Pures. C’est très beau, un peu froid, à rendre fou.
Mais quelques enganchones plus tard- et l’enganchon est une eau trouble dans le toreo limpide de Tomas-, le toro s’est éteint. Un pecho lentissime où le toro s’engouffre de tout son corps et une fin par aidées par le bas et trincherillas concluent en beauté la faena despacissima. Pinchazo, demie qui suffit. Une oreille. Cela va mieux, mais pout toute une série de raisons sans mystère – hier nous avions vu Morante, Tomas se révèle moins souverain qu’à l’accoutumée, il est accroché à la cape et doit quelques fois rectifier sa position à la muleta, son toro finit sans transmission-, ça n’est pas encore tout à fait ça.
La dernière sera la bonne face à un Parlade castano, de près de 600 kilos, légèrement brocho, pas beaucoup plus piqué que les précédents. Sept ou huit véroniques d’entrée, trois lentissimes, plus une media parfaite. Pas de quite, on garde des forces pour la suite. En quatre passes hautes et deux trincherillas, Tomas conduit le toro au centre, où après une première série de derechazos énormes, trois, pas un de plus, mais lents comme c’est peu imaginable, et une autre de moindre envergure, il prend la main gauche pour une symphonie de naturelles liées au pecho. Le temple magnétique qui aimante interminablement le toro est cette fois-ci d’une puissance et d’une précision nucléaires. On n’imagine pas une main gauche plus pure, un tissu plus sacré, un toro plus allant, qui va chercher le mystère aussi loin que le lui commande Tomas. Et quelques fois, dans la série, l’une est plus belle encore, plus complète, plus majestueuse. Le toreo de Tomas est, à cet instant, recherche pure. Les pechos sont tous de la même eau, des pechos non pas pour se libérer de la charge en fin de série, mais des pechos pour templer encore, cette fois-ci par le haut. Peut-être les plus beaux pechos, les plus insoupçonnés, les plus purs jamais vus. Naturelle de face, les jambes écartées, mais le toro se trouve trop contraint et deux enganchones s’ensuivent. Tomas rectifie la position, trincherilla finale. Epée de verdad. C’est fini ! Deux oreilles. Vuelta de feu. Et sortie en triomphe par la Puerta Grande aux cris de « Torero » « Torero ».
Je sens bien néanmoins que quelque chose me retient. D’abord, le constat qu’à la différence de la faena de Morante de la veille, je ne me sens pas vidé du tout, ni comme tombé d’un rêve. Ensuite Tomas a été moins souverain à la cape qu’à Nîmes ce qui n’est pas rien, le capote étant son seul moment d’allegria et de fantaisie, toutes choses qu’il bannit à la muleta. Et de faena, une manière d’être que je trouve de plus en plus solennelle et grave. Très religieuse. Qui nous tient à distance, le torero étant tout à la démonstration de ce temple magnétique qui aimante le toro à l’infini. Comme s’il n’avait plus à cœur, à ce stade de sa carrière, que de nous convaincre de sa puissance surnaturelle à douer un toro d’une charge dont la nature l’avait privé après avoir choisi des adversaires à cette seule fin. Et soudain, en y songeant, ce miracle me paraît presque une imposture. Une chose de curé qui officie le dos aux fidèles pour leur faire croire aux miracles. Une inversion majuscule du toreo. On pense que José Tomas met le toro en valeur mieux que quiconque dans une tauromachie de grande pureté où son corps se fait oublier, et c’est peut-être l’inverse qui se joue. Ce toreo, austère comme temple protestant, ne met peut-être en scène que la puissance de l’homme à créer un toro qui n’existe pas, à faire surgir un fond de caste d’un adversaire qui en est dépourvu, comme le sourcier un filet d’eau d’un sol aride. Ce qu’il met en évidence, tel un gourou, avec un sens du dépouillement recherché et ostentatoire, c’est peut-être lui José Tomas, et lui seul, lui qui ne s’oublie jamais, qui se fait rare pour entretenir artificiellement la légende, lui qui évite désormais tout compagnonnage à la loyale, l’alea des sorteos et les toros à dominer. Oui, c’est cela, bien sûr : lui seul qui se donne à voir, l’homme qui tire leur fond de caste de toros perdus que les mystères de sa muleta paraissent avoir miraculeusement perfusés le temps d’une faena. Un génie et un ange noir qui annonce les temps eschatologiques de la fin des corridas. Ce n’est plus le toro qui est la jauge du torero ; c’est le torero qui fabrique un toro. Inversion du sens profond de la lidia, refus de l’altérité, épuisement interne de la tauromachie par une manière d’accomplissement absolu. Homme qui fait le toro, homme et toro à la fois, José Tomas ne combat plus qu’avec lui-même. C’est le Minotaure de Picasso !
NB : Mes lecteurs les plus fidèles comprendront que les morantistes m’ont méchamment jeté le mauvais œil ou quelque autre atroce maléfice à la fin de cette chronique. Rendez-vous donc avec José Tomas à Madrid ou Bilbao, pour l’exorcisme !