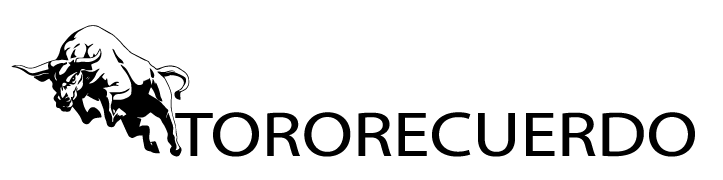Jeudi 24 mai 2012 – Paquirri, El Fandi, Juan Pablo Sanchez/
Torrehandilla
Cartel pas cher de temps de crise, mais une corrida peut toujours réserver quelques surprises… J’entends au réveil, depuis Paris, aux « Matinales de France-Culture», après un débat anxiogène entre économistes sur la sortie de la Grèce de l’euro, le pasodoble « Nîmeno ». C’est un signe ! On n’a pas le droit de déserter.
TGV, arrivée en gare de Nîmes sous grosse chaleur ; à 18 heures, public ensoleillé autour des arènes ; on retrouve les amis. Paseo.
Francisco avait dix ans au décès de son père, torero blessé à mort dans l’arène. Je me souviens de ce mois de vendanges 84 où le garde-champêtre du village passait, à mobylette, annoncer la mauvaise nouvelle de vigne en vigne. Paquirri est mort ! Les vendangeurs valencians en étaient si affectés qu’on a dû faire une pause, et même mon père n’a rien dit. On a saucissonné en silence en biberonnant du rouge. Si un torero de la trempe de Paquirri est mort dans l’arène alors c’est que le mektoub peut frapper quiconque à tout moment. Ambiance de grand deuil. Francisco est le fils de ce deuil et il a endossé l’habit de lumières. Qui l’a vu à Séville pour son alternative dix ans plus tard, et si souvent ensuite traverser lentement la piste, s’approcher du toril, se mettre à genoux la cape déployée devant lui, et attendre interminablement la sortie du toro pour une puerta gayola afarolada, celui-là s’interdit de rien dire. Francisco Rivera Ordonnez persiste, à 38 ans, à porter quelquefois l’habit de lumières, le plus souvent sur la Costa del Sol où les peoples peuplent le gradin, avant d’aller faire la fête avec leur torero, toujours aussi beau, cheveu jais, profil andalou, un peu paillettes, vidé désormais de toute caste torera mais encore du sang bleu dans les veines. Depuis quelques années, il a décidé de reprendre l’apodo de son père : Paquirri. Cela ne change rien car nous savions : on ne voit jamais Francisco sans penser à sa peine de gosse, inconsolable et glorieuse.
Aujourd’hui, nous l’avons applaudi affectueusement à la mort de son premier, qu’il a apprivoisé de loin dans une tauromachie fuera de cacho, après avoir planté les banderilles, puis nous l’avons sifflé un peu sur le quatrième, le seul toro de la course qui avait quelque présence. Sur celui-ci, Francisco n’a pas même tenté les banderilles.
Les Torrehandilla sont sortis très en cornes pour Nîmes. Faibles et pour la plupart sans présence, ils ont été plus que ménagés à la pique. Ce régime très allégé n’a pas suffi à entretenir la braise. De feu il n’y avait point ; et les toros se sont très vite éteints.
El Fandi, lui, est un ancien champion de ski reconverti dans la pose athlétique des banderilles. Il intéresse peu l’aficionado, surtout le romantique, mais attire un public qui aime les sportifs dans l’arène. Soyons juste, devant son premier, tardo, dispersé, il tire, ici ou là, trois naturelles bien dessinées ou un pecho alluré, et
de ce combat entre un toro et un torero également sans classe, aujourd’hui j’ai préféré le torero. Sur le suivant, il brillera aux banderilles, en plante quatre paires, la dernière al violin, un panama dans l’autre main avec lequel il torée la bête avant de l’arrêter à cuerpo limpio au centre de la piste. A la faena, le toro paraît se lasser
d’être toréé si mal.
Juan Pablo Sanchez est mexicain. La mine adolescente, la face large, et de drôles de fossettes qui lui tombent sur la bouche. Il a pris l’alternative ici il y a deux ans – c’était en septembre 2010- dans un vilain habit petits-poids, et nul ne s’en souvient. Sur les cartelitos que l’empresa distribue à l’entrée, il est même précisé sous
son nom : « Inédit en France». C’est bien la peine ! Si la vie devait être moins injuste, on devrait se souvenir de ses gestes du jour face à un noblissime adversaire, transmettant peu mais coopératif au possible. Des derechazos d’entame suaves, puis une faena gauchère, de passes longues, lentes, templées, qui se déployent au
ralenti, le bâton tenu à l’oblique, le tissu frôlant la jambe, une brise lente de toreo dans les zapatillas. Tout est si joli et délicat que l’on s’extasie comme d’un petit prodige qui, au piano, interromprait soudain ses gammes pour jouer un prélude. Le geste est sûr, appliqué, puis surprend, pend son envol, plein d’une fantaisie inattendue, comme cette volte du poignet où, de la main gauche toujours, le torero inverse la charge de son partenaire. Et avec ça, l’air sûr de son fait, concentré, offrant un toreo élégiaque et charmant, fleurant bon les joies de la terre. Une oreille méritée au petit Juan Pablo.
On relève sur le dernier la sûreté de ses doblones qui conduisent le toro des lignes au centre, le geste très décomposé, précis, limpide, efficace. Juan Pablo réduit le terrain, temple, parvient à enchaîner quelques passes, la tête sereine, puis le toro s’éteint. Le Mexicain sort sur les applaudissements. Et moi heureux de cette découverte qui confirme ses beaux gestes de la veille, salués à Madrid.
Vendredi 25 mai 2012 – Juli, Castella, Jimenez Fortes/ Garcigrande
Le plus influent club d’aficionados de la ville les « Ya plus rien qui vaille » en concurrence sévère avec l’insumersible « Ah ! De mon temps (soupir) II » nous interdiraient de dire la belle après-midi que nous avons passée.
Un lot homogène de toros qu’on épargne comme tous les autres à la pique en dépit du bon moral qu’ils manifestent ; intéressés au combat, la plupart mobiles ; tous ou presque avec un léger fond d’agressivité, de genio, qui nécessite d’être tenu et maîtrisé.
El Juli est de plus en plus cher ; du coup il paraît moins et c’est tant mieux ! Moins je le vois, mieux il se porte. A la tête de la mutinerie du G10, il a été puni d’avoir été trop exigeant à contre temps et par temps de crise. Privé de Valencia, de Sevilla, de Madrid, il réapparait ce jour à Nîmes dans une arène pleine, chaleureuse et disposée à la fête. Il porte un habit de haut-dignitaire, couleur d’époque, violet profond et noir. Aurait-il enfin compris ?
D’emblée souverain de cape sur son premier qu’il conduit par parones de la talanquera au centre exact de la piste, il livre au quite des chicuelinas baroques, très balancées, barque des Saintes-Maries sur les flots, avant une demi-véronique merveilleuse, sculptée, où mille vibrations s’échappent du tissu qui se replie. C’est que son toro a du jeu, et même beaucoup de gaz dont Le Juli ne tire pas profit aussitôt. Surpris lors du salut – le toro s’élance vers lui, il le torée de la gauche, la montera encore en main- Juli fait le choix de s’imposer en réduisant le terrain. C’est un peu dommage avec un tel adversaire. Juli le comprend, cite de loin, change de main en cours de série, sert une naturelle comme par inadvertance. Tout cela est d’un grand professionnel, mais pour l’heure le toro est le plus grand. La seconde moitié de faena change la donne et c’est alors – alors seulement- que la faena est d’évidence face à ce bel adversaire : derechazos en rond, interminables et dominateurs ; circulaires à l’envers qu’un changement de main prolonge. L’échec à l’épée prive Juli de trophée.
Sa très grand faena sera pour le suivant, d’emblée conduit au centre, tenu, mené d’une main ferme puis avec temple et liaison. Tant de dominio vide le toro qui désormais cahote – il n’a pas le tempérament du premier- et soudain se révolte méchamment d’un direct vers le visage. La corne assassine n’est pas loin mais ne touche pas. L’arène frémit, Juli reste en place et punit son adversaire de six ou sept naturelles, d’abord un peu lointaines puis vipérines. Il reste à gauche, tient définitivement son toro, temple et finit dans les cornes, inventant des enchaînements inouïs de dominio et d’aguante dans un mouchoir de poche. Et sur ce si petit terrain, les cornes si près, soudain à mes yeux, Juli est immense. Epée entière à effet un peu lent. Deux oreilles, ici pour une fois méritées.
Castella qui vient encore d’impressionner Madrid par son courage et cette manière d’intégrité obstinée et têtue qui, ici, lasse quelquefois, a l’air toujours aussi concentré sur soi. C’est sans doute cette discipline intérieure qui lui permet de servir 5 ou 6 statuaires près des barrières à son premier et, plus encore, 11 ou 12 passes les pieds joints, d’un très bel impact, sur le suivant. Hélas, ses faenas se ressemblent toujours un peu et comme El Juli a également ce jour terminé par la porfia, les tres en uno, les pieds dans les cornes sans bouger, l’impression de répétition dévalorise un peu son trasteo. Sebastien mande bellement à la fin de faena sur son premier comme s’il voulait tirer du vin à une pierre et tue avec décision – une oreille. Des cites de loin, beaucoup d’aisance, de jolies naturelles sur son
second, un toreo d’inspiration joyeuse qu’on lui connaît les jours avec – c’est alors du vent dans les oliviers-, puis il réduit le terrain, met, bravache, la jambe sous les cornes, provoque la charge, l’attend quelquefois interminablement, puis tue d’une autre épée parfaite. Sébastien irradie le bonheur retrouvé : il avait besoin de ce succès, ici un triomphe à deux oreilles, plus une pour son précédent combat, soit une Porte des Consuls dans la ville dont cet enfant pourrait être le prince.
Jimenez Fortes est de Malaga, mais il n’a rien d’andalou. Il est allé bravement prendre l’alternative à Bilbao en août dernier, a toréé devant sa mère, elle-même ancienne torera, et n’a laissé comme souvenir que l’intense soulagement que nous partagions avec elle de savoir son fils vivant à la fin de la corrida. Ce fut un peu pareil ce jour, mais un peu seulement. D’abord l’exaspération de voir ce jeune torero se livrer si ingénument. Puis la frayeur de le voir bousculé tant de fois, ici en pelote entre les pattes de son toro, là cul par-dessus tête, suspendu à la corne par la zapatilla, la muleta accrochée, encore et encore. Mais revenant, revenant toujours, comme si l’adversité n’avait pas de prise, choisissant le sitio du plus grand danger, la jambe offerte, sans recours mais avec un cœur qui impressionne. Alors, on s’en veut, mais tant de fermeté de caractère, de rusticité au mal, d’indifférence au ridicule, d’abnégation torera et d’impassible aguante finissent par exalter les sens et les mystères de la raison. On s’en veut, mais on se lève et on applaudit à tout rompre ce long jeune homme qui sait peu de choses mais n’abandonne jamais, orgueilleux de son rêve de gloire et prêt à en payer le prix.
A la fin de la course, Saul Jimenez Fortez traverse le ruedo, sans même claudiquer, le pas alerte, bien droit sous les applaudissements. On salue, épaté, le miracle. Castella et Juli sont portés en triomphe, Castella disparaît sous la Porte des Consuls, heureux comme un gosse de cette résurrection bienvenue, et une clameur immense accompagne le Juli jusqu’à la porte des cuadrillas.
Samedi 26 mai 2012 – Javier Castano/ Miura
Castano est inédit pour moi et je n’ai jamais beaucoup aimé les Miura, même du temps de leur redoutable splendeur. On dit qu’ils ont beaucoup baissé – entendre qu’ils seraient désormais toréables… Ce cartel me dit peu de choses, mais je me prends à rêver d’une surprise comme ce dimanche de 89 où on a failli prolonger le repas entre amis à Fons avant de se résoudre à aller voir le mano a mano Mendez- Nimeno face aux Guardiola . Et bien nous en a pris : la corrida fut historique.
Celle-ci ne le fut pas. Ce fut autre chose. Une bouffée d’antan, des souvenirs revisités, une malle qu’on ouvre dans un grenier et des émotions enfouies qui vous sautent au visage. Un émerveillé voyage dans le temps, en marche arrière. Ou du moins ce qu’on en imagine.
Le plus saisissant et le plus émouvant tenaient au soin mis à toutes choses : l’état de préparation du torero, d’abord, serein, la tête bien faite, une vista de la lidia qu’un geste ou un regard impose à toute la cuadrilla, tenue et disciplinée.
La sûreté des piqueros, ensuite, véritables triomphateurs de l’après-midi, cavaliers qui ont manié le cheval avec aisance, en appelant le toro de loin, usant de la pique avec orthodoxie, citant du bras, puis plantant la lance juste derrière le garrot, sans coup férir et sans se reprendre ; relevant la pique aussitôt dans l’attente d’une nouvelle rencontre ; réinventant cet office de testeur de bravoure qu’un picador ne devrait jamais cesser d’être.
Les peones de brega et les banderilleros, enfin, tous appliqués, sachant s’adapter à leur adversaire, le toréant, le rectifiant s’il y a lieu, posant les bâtons avec intelligence et brio, puis suspendant leur course en un desplante taurin, mi-statue de sel, mi-bailador flamenco.
Il faudrait citer ces piqueros : Placido « Tito » Sandoval, sec comme une trique ; sous la charge, debout sur ses étriers, la hampe le long du corps, le coude immobile comme en une image arrêtée ; Paco Maria, au troisième, seul en piste sous la présidence, dans l’axe central du ruedo, le toro à l’autre bout de l’ovale, cité de si loin et qui de si loin accourt à la rencontre, que la banda se met à jouer, comme à Séville, pour souligner le grandiose. Il faudrait citer les peones, si éblouissants à partir du
deuxième qu’ils seront invités à saluer tous ensemble, quasiment après chaque tercio de banderilles. Il y a là El Chano dans un élégant habit noir moucheté de blanc, lidiador hors pair, ivre de son métier, perfectionniste et plein de soi, que l’on sent d’un bloc ; David Adalid, une lame, tout en nez, qui piaffe d’impatience d’aller faire son quiebro ; Morenito d’Arles, toujours souverain à la brega et qui saluera aux banderilles au troisième.
Et avec ça, une camaraderie chaleureuse, une fraternité d’armes, une joie au combat complice : on s’encourage de la main ou d’une tape dans le dos, on salue l’exploit de son compagnon, on va au quite a cuerpo limpio dès qu’une poursuite hasardeuse mérite de prendre fin. On se parle ; on rit ; on se fait des signes ; et au plus fort de la bataille, quelquefois on s’embrasse. C’est une lidia et une fiesta ! Un jeu de mousquetaires que rien ne peut atteindre, préparés ensemble, ensemble aguerris et bataillant de concert, sûrs de leur réflexes, sachant tout les uns des autres, et déployant une lidia collective d’une précision d’horlogerie.
Oui, tout ceci est si beau à voir, ce plaisir des toreros d’être dans l’arène, la place première laissée aux toros, la science, la précision du geste, l’honnêteté de la lidia, cette clarté du jeu qui laisse voir les lignes de front, que l’on en pleurerait d’émotion et de rage, comme au souvenir du paradis perdu.
Il y fallait aussi des toros, et ces toros nous les avons eus. Bien sûr les aficionados du club « Ah ! de mon temps (soupir) II », précédemment évoqués, disent que ces Miura n’étaient pas des Miura. Peu m’importe ! Ces toros avaient une mobilité incroyable qui a fait le spectacle, un moral de seigneur, de la bravoure et une noblesse, sinon terriblement encastée, du moins exigeante.
Dans le détail, où se cache le diable, on précisera, en gage d’honnêteté, que le premier, long, efflanqué en dépit des 582 kgs annoncés, haut sur pattes, était fort laid et un peu faible, que les armures étaient dans l’ensemble correctes sans plus, et que le cinquième, de grande noblesse, était très faible également. Le 2, bravote et
avisé ; le 3, toro de vuelta, prendra quatre piques, la première avec grande puissance, les trois autres après avoir traversé le ruedo de part en part ; le 4, brave mais sans classe ; le 6, le plus beau de tous, mais à la course cahotante, tardo et pas clair. Nul monstre donc, plus de bonne volonté que de classe aux piques, tous toréables.
Et le torero, alors ? Eh bien, il nous reste des images.
Des cites de 40 mètres sur le premier que Castano embarque en le tenant dans sa muleta ; le toro n’humilie pas, alors le torero tente une passe à genou en s’enveloppant dans le tissu, cette fois-ci sous le mufle. Un cite à 8 mètres pour un recibir de feu, l’épée parfaitement en place qui foudroie le tio et fait tomber les deux oreilles (une eût été parfaite). C’est alors que nous nous dessillons !
Le deuxième, plus joli, plus compact et sans doute plus Miura que le précédent. Ce toro ralentit au passage, se retourne vite et cherche dans les chevilles. Castano, très sûr, l’aguante puis le feinte. C’est très beau. A la fin de faena, il fiche l’épée dans le sol, et sert alternativement des passes de main droite et de main
gauche, avec changement de main dans le dos. Mete y saca n’importe où, puis épée limpide d’effet immédiat. Une oreille (de poids)
Malospelos, 610 kgs, est le toro aux quatre piques, toro de grande présence. Castano commence la faena le bras sur la talanquera, puis enchaîne des séries
liées à de beaux pechos. Tue al recibir (deux oreilles). Vuelta al toro et vuelta triomphale du torero aux côtés de son piquero.
Verugo a la robe grise et un faux air de Vitorino. Javier incite sa cuadrilla à le faire citer de loin pour la pique, un peu comme le précédent, et le toro vient avec allant mais pousse peu. L’esprit de système commence à sévir, et Castano à fatiguer, qui se trouve en difficulté avant de tuer d’un volapie beau à voir mais pas conclusif.
Plusieurs descabellos.
On ressort une chaise pour le cinq, mais en plastique. Et qui ne servira à rien. Toro faible et noble ; toreo contemporain avec circulaires en tout sens, et bel aguante en fin de faena, avant les luquesinas, comme sur le deuxième, l’épée par terre, la muleta dans le dos. Epée trasera (une oreille).
Volador est le plus beau du lot, mais il vient sans doute un peu tard pour le torero, épuisé.
Castano va au centre de la piste nous offrir la mort de ce dernier toro. Ce geste qui ne vient qu’à son heure, une fois l’œuvre accomplie et le défi relevé ; ce visage éprouvé, marqué par les cernes, la tension et le doute de la dernière foulée ; cet homme qui n’a plus même la force de sourire à la foule et à peine celle de tendre sa montera; tout nous tire des larmes. Comme ce combat inachevé, presque de trop, face à un adversaire coriace, et ces ultimes descabellos qui retardent encore l’échéance.
Voilà c’est fini ! Castano retourne à la barrière, hagard, vidé de tout, indifférent aux cris, aux saluts, à la clameur. « Torero ! Torero ! Torero ». Broyé par ces travaux d’Hercule, mais vivant.
Ce un contre six n’était pas historique. Ce n’était pas Nimeno face aux Guardiola. NI le torero ni les toros n’ont touché à la gloire, mais notre exaltation n’était ni feinte ni exagérée. Elle était le fruit d’un saisissement face à la résurrection fugace d’une aficion possible a los toros.
Dimanche 27 mai 2012- Curro Diaz, Juan Bautista, Matias Tejela/ Fuente
Ymbro
Grand abattement sous ciel d’orage. Curro Diaz, dans un bel habit vieux rose et or, a été discret et sur son premier, avant de tomber sur une bûche, qui comme les autres a gratté le sol mais bougé moins encore. Juan Bautista, beau costume aussi, d’un gris lumineux et or, s’est trouvé en échec sur le deuxième, à la charge dispersée et qui a désorganisé sa cuadrilla ; quelques gouttes de pluie sur le suivant ont fait illusion : il s’est appliqué à faire quelques gestes et a tué fort bien (une oreille ?). Matias a sombré, devant le premier, incommode, à la charge courte et brutale, et devant le second, mobile, noble mais avec un fond de caste. Il portait un superbe habit groseille aux fines broderies noires.
Lundi 28 mai 2012- Ponce, Talavante, Daniel Luque/ Juan Pedro et 2 Palarde
Et soudain, la plaza se purgea de ses humeurs. C’était trop mauvais et depuis trop longtemps. Trois corridas successives sans émotion ni sentiment, sauf quelque fois
l’exaspération. Et, ce jour, trois premiers toros insignifiants de présence, ménagés à la pique et déjà éteints au tercio suivant, qui bougent à peine aux banderilles, des qui trébuchent, des qui fléchissent, des qu’on supplie qu’ils veuillent bien répondre aux cites, la muleta sous les yeux, promis !, des pour qui on met des cierges à Sainte Rita pour qu’ils tombent pas quand ils se retournent, des qui nous ennuient… et que c’est peu de le dire. Alors, mazette, épuisé par trois jours de fête, ayant noyé son latin et ses restes d’éducation dans le fino et le pastis, le public a hurlé ! Une bronca énorme, un terremoto à la sortie du toril du quatrième toro, lequel n’avait rien fait à quiconque mais devait payer pour les siens. Une clameur immense et inapaisée. Une grosse colère d’enfant gâté. Mal éduqué. Instruit, ici, depuis toujours, qu’il ne pouvait y avoir que des corridas réussies, pourvu que le producteur soit talentueux ! Et convaincu par ce dernier que l’aléa pouvait n’avoir aucune
place, les bricoles d’un organisateur inspiré pouvant y suppléer. Et dans la bourrasque, le voilà, le producteur de spectacle, qui sort dans le callejon et veut casser la gueule à la foule. On le retient par force. L’agualzil, homme de cape chargé de la police, tente une vaine médiation. Il crie, exaspéré, le producteur de spectacle, il se débat, il joue du poing et des épaules, dans le vide. On l’imagine dire à la foule « cass toi pauv’ con » et cela nous rappelle vaguement quelque chose. A cet instant, consterné, on songe aux Maestrantes de Sevilla.
Evidemment, ce quatrième toro sera le meilleur du lot. Il a un peu plus de présence et de mobilité que les précédents, un brin de jeu que le vétéran Ponce sait exploiter dans une faena à sa façon, une faena de fin de règne, ampoulée, affectée, majestueuse, boursoufflée, un toreo de feinte componction, relâché quand la corne est passée, une faena vaniteuse qu’on lui a vu mille fois ces dernières années et qui s’achève par ces drôles d’exercices d’assouplissement, assez peu heureux mais qui portent sur le public. Lequel avait tout oublié de ses états d’âme et lui a offert deux oreilles.
Quelques gestes de Luque et une fois encore rien de Talavante à Nîmes.