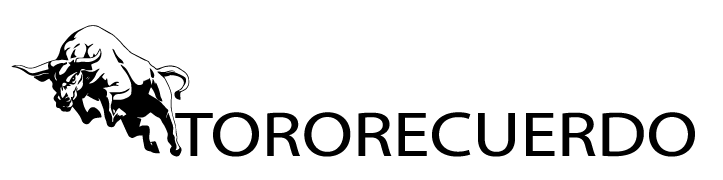Voir José Tomas à Valencia
On est rarement témoin d’une légende, alors on décide d’y aller. Deux, trois coups de fil pour s’assurer une entrada, réservation d’un billet d’avion, et on s’installera au Reina Victoria parce que Ian Gibson indique dans sa dernière biographie de Garcia Llorca que le poète y avait pris chambre en 1935. Puis on attend et on passe à autre chose. Mais le jour approche et avec lui des émois de jeune fille. On consulte dix fois la météo sur internet pour se rassurer ou se faire peur : le temps n’est pas si beau ; un vilain nuage noir tel jour ; quelques gouttes de pluie à la connexion suivante ; c’est maintenant un gros orage. Mince ! Et si la corrida venait à être annulée ? La veille des amis me téléphonent de Valencia pour me suggérer d’emporter une petite laine. Le retour de José Tomas en juillet comme un 11 novembre à Méjannes ? Je n’y crois pas…. Puis le jour arrive. On est plus nerveux qu’heureux ; on commence à douter. « Cela en vaut-il vraiment la peine ? ».
Dans l’avion, c’est le choc : des touristes ordinaires très encombrés de poussettes ou déjà en tenue de plagistes, quelques espagnols de Paris qui rentrent chez eux, mais pas le moindre aficionado apparent. A l’arrivée à l’aéroport de Valencia, la désillusion est complète, pas d’affiche de la féria, aucun portrait de José Tomas, et nul pasodoble de bienvenue. L’événement qui m’occupe depuis de si longues semaines ne donne aucun signe. Une bande de jeunes gens dans le métro, en espadrilles, sandales et keneppes, partagent le café d’un thermos et se prennent en photo ; on a du mal à deviner ce qu’ils fêtent. A la station suivante, une jeune fille les rejoint, quelques cerises dans un pochon de faux plastique mou tout ce qu’il y a plus développement durable. La bande applaudit joyeusement, en dépit de l’emballage, la perspective d’un tel présent à partager, on prend encore des photos, et un barbu gigote en chantonnant. On a l’air heureux d’un tel entre soi que l’on affiche avec ce prosélytisme de rupture des curés en soutane et des islamistes en qamîs. Une fille crie un slogan, je comprends : ce sont des « indignés ». Ce jour est celui de leur nouveau rassemblement Puerta del Sol à Madrid. La vie continue et je me sens un peu hors du monde.
A l’hôtel ce n’est pas mieux. Lorsque je demande au réceptionniste le chemin le plus court pour rejoindre les arènes, je m’entends répondre, avec une ironie sans charité : « Il y a des arènes ici ? ».
La plaza de toros est coincée dans la ville, entourée d’immeubles, à deux pas de la gare. Toute de briques, ajourée d’étroits balcons qui laissent deviner trois niveaux de coursives en galeries, cette arène a l’allure paisible de celles qui font fête aux toreros. Une statue de Montoliu banderillero, torero local et immense péon, tué dans les arènes de Séville d’un coup de corne dans le dos, qui lui a traversé le cœur, dit la modestie de la plaza et le tragique de la corrida.
Nulle nervosité autour des arènes, les derniers billets ont été vendus deux heures auparavant- l’empresa est tenue d’en conserver 5% à vendre le jour même-, et les revendeurs, placides, ont leur mine des jours ordinaires : une revente sûre mais qui ne décolle pas des 300 euros la contra-barrera sombra, une misère. Les aficionados sont rares autour des stands de breloques taurines. Non vraiment, il ne se passe rien. Et ce calme me dégrise. Je suis vraiment fou.
José Tomas est une légende et une légende n’a pas de biographie, regardez ces mythologies qui font tant de vies différentes aux dieux grecs, sans qu’aucune ne soit plus sûre que les autres. Sa légende, elle tient tout entière dans sa manière d’être dans l’arène. Car José Tomas ne torée comme personne. Non pas mieux que quiconque, mais comme nul autre. Le toreo est l’art de l’esquive autour d’un bout de tissu qui leurre le toro, et quand le tissu ne suffit pas, on recule un peu la jambe, ou on torée de profil pour que la passe soit plus longue, plus fluide, à la recherche de cet esthétisme du joli qui est l’ennemi du tragique. José Tomas n’aime pas l’esquive, ramasse le tissu au maximum, ne recule jamais la jambe, ne torée pas de profil. C’est l’homme de la ligne de front, toujours dans le terrain du toro, la cuisse exposée au plus près de la charge naturelle de l’animal. Son combat est de tranchée. C’est un preux, un torero de position, voilà pourquoi il est si saisissant à regarder quand il choisit son terrain, et Madrid applaudit cette recherche du sitio où il décide de provoquer le toro d’un toque. C’est un idéaliste, sa tauromachie est tout entière dans cette loyauté du combat, cette exposition géométrique et insoupçonnée de soi, et la recherche de la passe parfaite. C’est un dogmatique enfin, ne consentant à rien d’autre qu’à cette folle orthodoxie, quelquefois peu opportune. Alors, il advient que la passe soit accrochée, beaucoup plus fréquemment qu’avec d’autres toreros plus avisés qui reculent d’un pas ou toréent du pico. Et quelquefois, il se fait prendre car le leurre l’est trop peu, ou le corps trop présent dans le terrain adverse.
Voilà ce qu’est José Tomas. Ajoutez qu’il s’est vidé deux fois de son sang, à quinze ans d’intervalle, à Aguascalientes au Mexique, au point d’en mourir presque et de ne devoir la vie qu’aux aficionados présents qui se sont battus pour lui donner leur sang, qu’il a été triomphateur à Madrid trois saisons consécutives (97,98,99) avant de rendre les armes sans explications (2003), puis de revenir quatre ans plus tard pour les triomphes de Barcelone dont il a réinventé l’aficion, remplissant à nouveau des arènes longtemps désertées, avant d’écrire sa geste en deux après-midi de juin 2008 qui ont tiré des larmes aux plus aguerris des abonnés de Las Ventas.
Il parle peu et fuit les gazettes. Au Roi d’Espagne qui sollicitait drôlement la faveur de se voir un jour dédier un combat, José Tomas, qui passe pour républicain, aurait répliqué « On verra ». On dit qu’il aime marcher dans les bois et qu’il se retire seul en mer pour pêcher sans plus donner de nouvelles à son entourage. Il s’entraîne de salon dans une pièce tapissée de miroirs où il s’enferme comme un photographe dans sa chambre noire, et on s’étonne du choix d’une telle crypte, toute de transparence et de reflets de soi.
José Tomas est pâle, les traits souvent tendus. Il ne se gomine pas le cheveu, et ne flatte pas son allure dans l’arène. Il n’est ni beau, ni élégant et nul geste d’exhibition de soi ou d’arrogance ne ponctue jamais ses triomphes. Aveugle à la foule comme au danger, il a la gravité d’un officiant qui ne se laisserait distraire par rien qui ne serait la foi.
Telle est sa légende. Elle agace quelques amis. José Tomas est cher ; il évite fréquemment, sous divers prétextes, les arènes de première catégorie ; choisit ses partenaires de cartel sans jamais affronter les toreros punteros du moment, etc. Tout cela est vrai, mais qu’importe ? Une quête d’absolu ne se jalonne pas de comparaisons.
La corrida commence à 19 heures et une heure auparavant tout le monde est là pour Le voir arriver. Mais là encore, ça fait « pschitt » ! La foule est déférente et retenue, quelques applaudissements, des appareils photos tendus à bout de bras, bien sûr, mais rien de plus qu’autoriserait la manière d’être du torero. Nul débordement, aucune bousculade, pas de ferveur exaltée à la Sévillane. De dignes retrouvailles, c’est tout. Au paseo, il sort le dernier, dans un habit lilas, avec des dessins de croissants de lune blancs et de curieuses broderies de parements végétaux qui rappellent les décors ultramarins des églises baroques du siècle d’or. Lorsqu’il s’aligne aux côtés de ses deux compagnons de cartel, la clameur est comme embarrassée pour cet homme de silence. A la fin du paseo, on se lève pour applaudir, José Tomas sort du callejon, le visage très pâle, le cheveu en bataille, fait quelques pas, baisse la tête trois fois, sachant qu’il convient de remercier le public reconnaissant, et il le fait sans manière ni affectation, avec cette sobriété profonde qui est sa matière.
Ca y est, nous y sommes, la corrida commence.
Valencia, 23 juillet 2011- Victor Puerto, José Tomas, Arturo Saldivar/ El Pilar
Quand José Tomas vint s’aligner à côté de ses deux compagnons de cartel pour le paseo, la clameur fut comme un rugissement irrépressible, venu des tréfonds, un terremoto d’aficion. On avait un peu honte bien sûr de manifester tant d’exaltation, mais après on s’est bien comporté. José Tomas sait nous tenir à distance. Alors on l’a applaudi plus sagement une fois le paseo terminé, et il est sorti saluer avec sobriété. Il a baissé trois fois la tête, comme les grands hommes de théâtre qui savent n’en point trop faire, et a levé la main à mi-hauteur pour nous dire gentiment « ça suffit ».
On a fait mine bien sûr de s’intéresser à Victor Puerto, remplaçant insoupçonné de Juan Mora, annoncé chef de lidia mais blessé, et on a vu sortir un joli colorado, manso de peu de présence qui voulut sauter dans le callejon mais n’y parvint pas, et des chicuelinas serrées, conclues par une jolie demie, pleine d’effets. Durant le second picotazo, d’un rien – un léger étirement, les jambes tendues, le pas décalé d’un danseur s’apprêtant à un entrechat- on a senti que José Tomas se préparait à entrer dans le jeu. Il s’est avancé au centre du ruedo d’un pas décidé, et a servi des lances, mi-véroniques mi-delantales, près du corps, très lents avant d’abandonner lors du dernier passage et au premier tiers de la passe entrain de se faire, la cape d’une main, la véronique devenant larga, la moitié du tissu au sol et le toro à ses pieds, dans une évaporation d’art. Non sans une belle audace, Victor Puerto s’est alors présenté à nouveau face à son toro dans une competencia inattendue et un brin arrogante. Deux véroniques superbement dessinées et une demie ont hélas fait fléchir le toro que le chef de lidia a ensuite offert sans rancune à la star du jour, avant de soulever l’arène, au centre et à genou, par sept derechazos croisés et templés, puis un pecho saisissant où le toro s’arrête. Victor Puerto, toujours à genou, garde la position, exposé au possible, et toque. Le toro bouge à peine la tête. Toque encore, le toro maintenant le regarde, et Victor Puerto finalement parvient à l’embarquer et nous avec, l’arène, exaltée par tant d’aguante, debout, faisant fête au sobresaliente de dernière les fagots. La competencia au quite puis cette série laisseront le toro parado, et c’est désormais sans scrupules que l’on attendait José Tomas sur son toro.
Celui-là est petit (502kgs) mais très armé, les pointes astifinas. Le temple dès les véroniques de réception est inouï et la lenteur de la main conductrice fascinante à regarder. La mise en suerte au cheval est médiocre ; le toro, mal piqué, pousse cependant avec allant. Le quite sera au centre de la piste : José Tomas d’un geste gracile et joueur cite son adversaire, de profil, les pieds joints, en lançant la cape sur la droite, avant de dérober le tissu puis de le déployer derrière lui sur la gauche, à la manière d’une passe du cambio. Le toro suit à droite, puis passe à gauche, laissant l’homme au centre de ces arabesques. Sans bouger d’un pouce, José Tomas le cite à nouveau d’un lance de delante por detras et cela recommence quatre fois avant une demie dans laquelle le torero s’enveloppe avant de se libérer d’une larga pleine de toreria. C’est très beau. Mais aussitôt notre troisième homme, le Mexicain, rapplique pour des saltilleras ajustées et pleine de fantaisie. Quelle corrida !
José Tomas offre son toro à l’équipe médicale qui l’a suivi durant ses quinze mois de convalescence et on frissonne. Mais la faena sera moins sûre qu’espéré. Le sitio, beaucoup d’aguante, des derechazos puissants et la main toujours plus basse d’une passe à l’autre ; mais le toro sera récalcitrant à gauche et seules les naturelles aidées de l’épée seront fluides. Tomas, finalement désarmé – il le sera deux fois à gauche- reprend la main droite pour une série de grande puissance, en position de trois quarts, les jambes tendues, comme fichées dans le sol, plein de poder. Un cambio de espalda et il tente à nouveau à gauche mais en vain. Trois quarts d’épée. Saluts et applaudissements chaleureux, mais ce que nous venons de voir n’est pas à la hauteur du rêve. Nul ne le reconnaîtra jamais, sauf mon voisin, jeune mais incontestablement grand aficionado, et tout sauf tomasista, qui n’a pas l’air mécontent que tous les autres restent sur leur faim.
La surprise du jour fut le Mexicain, 21ans, qui n’a pas deux ans d’alternative, n’a toréé que quatre fois en 2010 mais a fait forte impression en ce début de saison à Madrid. Arturo Saldivar a certes hérité du meilleur lot mais ce torero, plein de sève, volontaire et de bel allant, a réussi à laisser son empreinte sur une journée qui était promise à un autre. Ayant alterné aux quites sur les deux toros de José Tomas, il a su faire face avec sûreté et envie à ses deux adversaires, nobles mais avec piquant, quelquefois surpris mais jamais débordé, le plus souvent avec à propos et aguante. Une faena allant a mas sur son premier – et avec l’épée il se jette comme un furieux dans les cornes (une oreille)- un début de faena à genoux sur son second qu’il torée au centre, avec des cites de loin et liant les passes dès la deuxième série avec décision, face à un joli toro noir de belle caste et très armé (une oreille).
La réception du cinq par José Tomas – un colorado très haut et très long- est d’anthologie. Des véroniques en parones au centre de la piste, et la cape est si près du corps et le geste si ralenti qu’on a l’impression de ne la voir plus, comme si le torero la dérobait à nos yeux et à notre raison, pour ne laisser voir que ce toro à sa taille. Une demi de mépris est de même nature- ce tissu qui se dérobe, comme la colombe dans la manche du magicien- et on hurle d’une telle illusion quand la colombe est un toro. Au quite, c’est une figure inversée que le torero nous sert par chicuelinas, les jambes fichées en terre, le compas largement ouvert, absolument immobile au passage de la bête, que seul le rebord de la cape appelle, dans un toque millimétré qui fait se replier un rien de tissu sur lui-même. L’absolue impassibilité de l’homme, l’économie du geste, cette cape soudain comme un ruban discret qui invite le toro à une telle contorsion rageuse sont d’un divin sorcier. Chicuelinas ? Cordobesinas ? Qu’importe ! TORERO ! Ebullition émerveillée dans le ruedo, c’est tout ce qu’on peu dire.
José Tomas offre ce toro à la tête haute et mobile, qui se révèle manso, distraido, fuyard et à la charge irrégulière, au public. Depuis le centre, il cite pour une statuaire à 30 mètres. L’autre accourt, voit l’étoffe et voit l’homme et choisit le torero, pris de plein fouet, voltigeant comme un pantin désarticulé, retombant inerte sur le sable, pris encore et soulevé cette fois-ci comme une poupée de chiffon. Clameurs d’effroi. C’est Aguascalientes. Ce corps allongé sans vie, comme le torero mort de Manet, mais sur le ventre, comme une chose molle, une baudruche. C’est peut-être pire qu’Aguascalientes. On accourt, on le ramasse, on le transporte vers le callejon. Soudain il bouge, on le remet sur les pieds en le tenant par la taille et les bras. On ne voit rien, trop de monde autour de lui. On n’ose pas se regarder les uns les autres, hypnotisés que nous sommes par la scène et abasourdis par le choc, honteux peut-être d’être là, d’imaginer le pire et d’oser regretter une faena dont on redoute de ne la voir pas ce jour, et peut-être jamais. Cela dure des minutes, des minutes interminables ; on s’écarte un peu de lui, ses aides se dispersent ; on lui verse de l’eau sur la nuque. On se dit « peut-être », « peut-être c’est bon ». Et on a honte encore, mais on espère. Sans s’interroger plus avant sur le motif d’une telle espèrance : lui, alors s’il survit qu’il arrête ! ou nous autres, pauvres pécheurs , s’il survit qu’il revienne…
Il revient. A l’avoir vu si léger dans les airs tout à l’heure, dans son costume lilas aux croissants de lune, comme une chimère de Chagall, je le trouve maigre soudain et pâle plus encore qu’à l’accoutumée. Et c’est d’une muleta vaporeuse et templée qu’il ramène le toro au centre, là même où il avait tenté de le citer pour son début de faena. Tant de douceur et de suavité sur un adversaire qui l’avait ainsi traité est proprement irrésistible. Les nerfs craquent. Mais pas les siens, qui sert une série de toreo grande de la droite d’où le toro sort mal, la tête haute et plus menaçante encore. José prend la main gauche, et soudain c’est indicible. L’homme est centré, la main basse, les passes liées et d’une lenteur à hurler. Le toro est à nouveau cité de 20 mètres, l’homme de trois quarts, un toque sûr et le toro s’engouffre, comme aspiré par tant de résolution. Cette série est grandiose de tout, poder, temple, sitio. Le toro se révolte de tant de dominio et fuit à la barrière. José va le châtier d’une trinchera qui le ramène aux medios, suivie de derechazos profonds. Le toro fuit encore à la barrière, alors José ne tente plus même de le sortir de sa querencia, se met face à lui, le compas largement ouvert pour des manoletinas de feu, la jambe contraire si puissante face aux cornes qu’on jurerait que le torero se croise, oui pour une manoletina ! – les aficionados goûteront le paradoxe ou le miracle.
Voilà ce que nous avons vu, et nous avons vu encore le torero se jeter dans les cornes de celui qui avait failli le tuer, dans un geste d’une grande pureté, un geste de brave, un geste de preux.
Peut-être l’épée était-elle légèrement caida et un peu trasera. Une oreille est accordée quand deux étaient exigées par la foule unanime. Bronca majuscule à la présidence. Et deux vueltas d’apothéose, le torero souriant accomplissant ses tours de pistes sans rancune à l’égard de quiconque, ni geste de désappointement à l’égard du palco qu’il a salué comme si de rien n’était. Et une fois JT revenu à la talanquera, et ayant retrouvé sa place dans le callejon aux côtés de ses compagnons de cartel , nous applaudissions encore et encore, sans pouvoir nous arrêter, sans plus protester contre la présidence. Nous applaudissions par pur plaisir à le faire, en criant « TORERO TORERO » car nous étions heureux et reconnaissants, et qu’on aimait dire ainsi notre passion pour la corrida et notre émotion pour ce qu’elle venait de nous offrir.